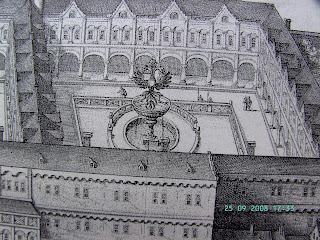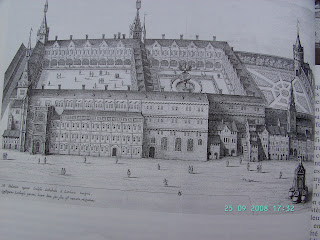Liège des révoltes: Un centre d’attraction mémoriel sur la façade du Palais Provincial
J’ai organisé déjà
quelques fois une balade « Liège des révoltes. Les braises de la Cité ardente».
Le problème avec une telle ballade est que les révoltes ont laissé peu de
traces visibles.
spectaculaire est encore le tracé des piliers de la cathédrale Saint Lambert,
et la place Saint Lambert tout court, là où s’élevait une des plus grandes
cathédrales du monde occidental, « démontée » en 1793 par les révolutionnaires liégeois, comme symbole de la
tyrannie de l’ancien régime. Il y a la collégiale Saint-Martin où plusieurs
dizaines de nobles ont péri dans l’incendie suite au Mal Saint-Martin. Dans le
patrimoine immatériel, le mal Saint-Martin a donné en 1316 la Paix de Fexhe, le
document le plus célèbre de l’histoire du Pays de Liège où elle prend la même
place que la Magna Carta dans l’histoire d’Angleterre. Pour le reste, nous
avons quelques plaques de rues. Charles Decoster décrit dans son Ulenspiegel
l’émeute des Rivageois en 1491. Les Rivageois ont
donné leur nom à une rue et à une Haute Ecole. En 1177 le concile de Venise
condamne Lambert le Bègue dont les propositions avaient selon l’historien catholique
Balau « un incontestable relent d’hétérodoxie». Une Paroisse Protestante
de Liège et une rue s’appellent Lambert-le-Bègue. Outremeuse a sa rue
Raes-de-Heers, à la mémoire du tribun populaire qui a dirigé le soulèvement
contre le prince évêque Louis de Bourbon et Charles le Téméraire, qui brûlera
la ville en 1468. En 1395 les hédroits,
ces « professionnels du désordre, qui écrivent avec l’épée un nouveau
droit« (G. Kurth) commencent leur lancent un procès contre révolte qui durera
dix ans, si on compte jusqu’à la défaite du peuple à Othée, en 1404, voire 23
ans si on compte jusqu’à la démission en 1418 du prince évêque Jean de Bavière, surnommé « Jean sans Pitié»…. La
seule rue des Hédroits se trouve à Seraing ; leur nom n’est même pas repris sur
le monument d’Othée ou des dizaines de milliers de Hédroits ont laissé leur
vie.
demi d’errance, la dépouille de Sébastien Laruelle se trouve toujours dans un
caveau d’attente à Robermont. Il a une rue à son nom. La
Ruelle est un leader des Grignoux. Le prince évêque Ernest
de Bavière est soutenu par les Chiroux. Derrière Chiroux et Grignoux il
y a la lutte entre Réforme et Contreréforme, commencé avec le concile de
Trente en 1563.
Peuple du Parti Ouvrier Belge a été détruite en 1977. Il nous reste comme trace
une rue de La Populaire.
Un aperçu des révoltes buriné dans la pierre
Les révoltes ont laissé peu de traces, mais
nous en avons un aperçu buriné dans la pierre. Il
faut juste une paire de bonne jumelles : en haut de la façade du Palais Provincial une série de bas reliefs retracent des événements marquants
de l’histoire liégeoise. Comme la province voulait une entrée d’apparat,
l’architecte a dû accrocher son ‘centre d’attraction mémoriel’ en hauteur. La passerelle qui rejoint la future gare du
Palais est plus ou moins à la bonne hauteur, mais malheureusement un peu loin…
résumé de l’histoire de la principauté est de la haute voltige politique :
on a discuté pendant trente ans sur ce qu’on allait y mettre. Cela mériterait
donc l’installation d’une passerelle. Une solution moins onéreuse serait de les
déposer et de les accrocher aux grilles…
révoltes. Mais le Mal Saint-Martin y est. Nous y trouvons aussi la Bataille des Steppes et la statue de
Hughes de Pierrepont qui remporta la victoire des Steppes; la sortie des 600
Franchimontois ; Vincent de Bueren
par Tombay et Goswin de Strailhe par Noppius ; la paix de Fexhe ; la
mort de La Ruelle par Joseph Antoine van den Kerckhove; la bataille d’Othée par Desenfants et
la mort de Louis de Bourbon par Alphonse de Tombay ; Lambert Le Bègue par
Noppius ; une statue de Henri de Horn, sire de Perwez qui périt à Othée
par Alphonse de Tombay ; Jean de
Wilde par H.Lambert ; l’élection des deux premiers bourgmestres par Henri
de Dinant et une statue de Henri de Dinant
Un Palais qui avait bien besoin d’une restauration en 1849
Cette Bande Dessinée en pierre date de la
restauration du Palais en 1849. Lors de la Révolution liégeoise de 1789 le
palais des princes-évêques – symbole de la tyrannie – avait subi pas mal de
pillages et dégradations. Les régimes français puis hollandais l’avaient
réquisitionné pour abriter leur administration. Après 1830, le bâtiment avait
été affecté aux services de la justice, et la première cour du palais a été le
siège d’un marché quotidien.
libraires et de bibelotiers se sont installées sous toutes ses arcades. Un
marché aux légumes se tient dans la cour. On voit les robes noires des
praticiens affairés passer au milieu des grands paniers pleins de choux rouges
et violets. Dans cette sombre cour se croise perpétuellement aujourd’hui
l’intarissable parole de l’avocat et de la commère, le bavardage et le babil»
(Le
Rhin, lettre VII, 1840).
aux légumes n’était pas mieux que l’utilisation actuelle de cette cour comme
parking…
de délabrement avancé quand la Province décide d’y installer ses services. Les
travaux du nouvel hôtel provincial commencent en 1849, et dès le départ l’architecte provincial Delsaux prévoit niches et bas reliefs sur la façade : 42
statues, des blasons des anciennes villes et des 32 métiers de la Cité ainsi
que 19 bas-reliefs rappelant des événements marquants de l’histoire liégeoise. Avec
ce ‘centre d’attraction mémoriel’ J- C Delsaux se voulait le
continuateur des bas reliefs ornant portails et tympans
des cathédrales gothiques : la bible des pauvres. Mais notre
pauvre Delsaux n’avait pas à sa disposition, comme dans les cathédrales, un
portail. Comme la province voulait une entrée et un escalier d’apparat il a été
obligé d’accrocher sa bible à dix mètres de haut. Delsaux ne se rend probablement pas
compte qu’il faudra trente ans pour que ces niches se
remplissent et que ces bas reliefs voient le jour. Et encore : s’il n’y avait pas eu l’échéance du
cinquantenaire de la Belgique en 1880 on discutait probablement encore…
Trente ans de
discussions : un choix mûrement réfléchi et pesé…
des sujets. En 1855 l’historien Mathieu Polain voulait
s’arrêter à Erard de la Marck. En 1865 l’architecte provincial Lambert Noppius,
successeur de Delsaux, espère présenter le canevas définitif. Les temps ne sont
apparemment pas encore mûrs à une époque où les tensions entre libéraux et
catholiques sont vives.
1878 le gouverneur libéral de Luesemans supervise
personnellement le travail d’une nouvelle commision, sous le dernier gouvernement
libéral Frère-Orban II. En 1879 les douze artistes liégeois sélectionnés
devront se dépêcher pour terminer le travail pour les fêtes du cinquantenaire
de la Belgique. Heureusement qu’il y avait cette échéance du
cinquantenaire ; sinon les débats auraient sans doute repris. Les tensions
étaient vives: nous sommes en pleine guerre scolaire qui mène en juin 1880 à la
suppression de la légation belge auprès du Saint-Siège !
A la trappe :
Saint Materne, Saint Servais, Sainte Begge, Sainte Julienne
est aussi intéressant de parcourir les sujets qui ont été évacués au cours de
ces 30 ans de débats. Saint Materne par exemple (l’un des 72 disciples les plus proches du Christ qui est venu évangéliser la Gaule entre vers l’an 42. D’où
son titre d’apôtre de la Belgique. Passe à la trappe aussi Saint Servais,
premier évêque du Civitas Tungrorum, et aussi
dernier des Saints de glace. Sainte Begge, fille de Pépin de Landen et
mère de Pépin le Jeune ; Sainte Julienne: Il y a au moins 16 saintes de ce nom, mais dans notre cas il s’agit de Julienne
de Cornillon (°1192 – †1258), vierge, prieure du monastère du Mont-Cornillon à
Liège, à l’origine de la Fête Dieu.
 |
| Monulphe par de Tombay |
réaliser un autre évêque de Tongres, Monulphe, qui s’arrête dans le vallon de
la Légia au VIe siècle en s’écriant : « C’est ici la place que Dieu a choisie
pour le salut d’un grand nombre, c’est ici que doit s’élever plus tard une
ville puissante». Et il y a aussi Pierre l’Ermite et Chapeauville, inquisiteur sous
Ernest de Bavière…
leur frère prince-éveque de Velbrück, « despote éclairé » et Fondateur de la Société d’Emulation, lieu de
rencontre de l’intelligentsia liégeoise. Contrairement à ses prédécesseurs,
‘son corps ne fut pas jeté à la fosse commune et son mausolée ne fut pas
détruit lors de la Révolution liégeoise’. Le prince Georges-Louis de Berghes qui
avait lègué sa fortune (un million de florins, un florin étant le salaire
quotidien d’un ouvrier qualifié) aux pauvres de la cité de Liège y a sa place
aussi. Son testament est à la base d’une révolte lors de la Révolution
liégeoise de 1789. Le 7 octobre 1789 la Conseil de la Noble Cité de Liège vote
un ‘Recès’ « au sujet des biens délaissés par feue S.A. le Prince
Georges-Louis : les Capitaux peuvent être aliénés et partagés entre
lesdits pauvres » (P. Baré, Herstal sous la
révolution liégeoise p.76).
Delsaux donne le
signal de départ d’un siècle et demi de travaux ‘inutiles’
qu’avec la construction du Palais Provincial il donnait le signal de départ
d’un siècle et demi de travaux ‘inutiles’.
La première victime est la plus ancienne des collégiales liégeoises , la collégiale Saint-Pierre, fondée dès 709
par l’évêque Hubert. Vers 1860 l’ingénieur Blonden fait cisailler
la colline Saint-Pierre pour dégager la vue sur le nouveau Palais de
Delsaux. En passant il élargit ce qui ne s’appelait pas encore rue de Bruxelles
mais portait toujours le nom de rue Neuve et qui était une voie plus de sept
fois séculaire. Liège avait gagné une façade, mais perdu une collégiale.
une ceinture ferroviaire. Les travaux d’aménagement du chemin de fer au bas de Pierreuse.
en fait notre gare centrale. Or, en 2011 le maigre budget pour une
nouvelle gare Palais, (le dixième du budget pharaonique pour les Guillemins), a
encore été divisé par deux!
autre blog !
Sources
Rhine-Meuse Region http://books.google.be/books?id=yWCYkrgALhgC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=de+Luesemans++Li%C3%A8ge+Palais&source=bl&ots=Kdg54UMcWk&sig=1sCv6JBj8VFSJfTRhVXSNEgiYY4&hl=en&ei=JO79TYzLOs7B8QPkzsGqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=de%20Luesemans%20%20Li%C3%A8ge%20Palais&f=false
Épisode des guerres d’Ambiorix
Prophétie de Saint Monulphe
Sortie des 600 Franchimontois
Notger répandant l’instruction parmi le
Élection des deux premiers bourgmestres
(Blason de la province de Liège)
Charlemagne offrant le gonfanon à l’église
Duel judiciaire d’Aynechon de Falloz
Mort de Louis de Bourbon
Exécution de Guillaume de la Marck
Érection du palais par Erard de la Marck
signalés
(numérotation de
Saint Monulphe
de Landen
Remacle
Lambert le Bègue
Rathère
Henri de Hornes, sire de Perwez
d’Outre Meuse
Jehan le Bel
Eracle
Van Eyck
Henri de Verdun
de Vyle
Pierre l’Ermite
Saint Lambert
Gertrude de Moha
Notger
Ambiorix
Henri de Dinant
Charlemagne
Albert de Cuyck
Berthe
Erard de la Marck
Godefroid de Bouillon
Charles Martel
Hubert
Gérard de Groesbeek
Georges-Louis de Berghes
Chapeauville
François Borset
Charles de Méan
Del Cour