61ième balade-santé au cimetière de Robermont.
 |
| photo J-P Remiche |
Notre 61ième
balade-santé du dimanche 14 novembre fait le tour du cimetière de Robermont.
Départ à 10h pile au croisement (genre de rond point) de la rue Trou Louette, rue
Ernest Malvoz et de l’avenue Joseph Merlot à Bressoux, juste après de l’église
Notre-Dame de Lourdes au Bouhay, ou à 9h30 devant notre Maison Médicale Avenue
F. Ferrer 26, à Herstal.
De la
rue Malvoz nous suivrons le Chemin des Sarts, un cheminement cyclo-piéton (ou
un corridor-vélo si tu préfères) tout frais (2019), le chaînon manquant entre
le Ravel 5 (ancienne ligne 38 venant de Fléron), les quartiers de
Grivegnée-haut et Jupille-haut et la gare de Bressoux, le futur terminus du
tram de Liège et le futur hall des foires. Ces 650 mètres c’est un budget de
180.000 €, subsidié de 50% par la Province dans le cadre du programme Liège
Europe Métropole. Et ne n’est pas encore fini : un second va relier le
Plateau de Robermont à la vallée (Amercoeur) via le Parc de l’Oasis et le Bois
Mangon. 220.000 € dont 100.000 € subsidié pare la Région wallonne dans le cadre
de son programme de promotion de la mobilité douce.
Des logements sociaux à l’ancien “parc auto” de Liège
Le dépôt de Trou Louette qui a hébergé le parc
automobile de la Ville et le service Hiver et Égouttage a été vendu au Logis
social qui va y créer ici 24 logements publics, puis, dans une deuxième phase,
après la démolition des les hangars, encore une cinquantaine (Marc Bechet La
Dernière Heure 22/11/2019) Un avis du marché de services d’architecture a été lancé en juillet 2020.
Robermont, un lieu de recueillement, qui invite à la balade
 |
| photo jp Remiche |
Le cimetière est avec ses 44 ha aussi grand
que le Père-Lachaise à Paris et que la cité du Vatican. Sans être taphophile,
littéralement « qui aime les tombes », Robermont est non seulement un lieu de
recueillement, mais aussi un lieu qui invite à la balade, douce et sereine.
La Ville de Liège compte douze cimetières sur
son territoire pour une superficie totale de 107 hectares. Il y aurait près de
850.000 personnes enterrées dans ces cimetières, y compris urnes et
columbariums. Mais ce chiffre n’englobe pas les défunts dont la concession
tombe n’a pas été renouvelée. Ces tombes sont alors réattribuées et les anciens
os placés dans un ossuaire (Luc
Gochel, La Meuse 2/11/2015).Et puis, les anciennes
communes fusionnées ne tenaient pas toutes un registre qui n’est obligatoire
que depuis 1983. Un chiffre précis peut-être donné pour le nombre
d’incinérations. Les cendres de 27.000 personnes ont déjà été dispersées sur
les pelouses de dispersion.
Au XIXe siècle, nos cimetières ont été conçus
comme des parcs, voire des arboretums. Robermont compte de nombreux spécimens
d’arbres remarquables La suppression des arbres, des fleurs, de la végétation
dans les cimetières, remonte à une période après la Seconde Guerre mondiale, avec
le développement des pesticides et autres herbicides…
Crématorium
Nous accédons à Robermont via sa partie la
plus récente : le crématorium. Inauguré en 1978, le Centre funéraire de Liège a d’abord été géré par la seule
Ville de Liège. En 1991, une société intercommunale s’est constituée grâce aux
villes de Liège et Herstal. Fin 2009, 50 nouvelles villes et communes adhèrent
à l’Intercommunale. Le columbarium extérieur peut accueillir 9.216 urnes ; pour
3.224 à l’intérieur. C’est un cimetière paysager avec quatre pelouses de
dispersion dénommées les peupliers, les saules, les bouleaux et les acacias et une
pelouse cinéraire pour l’inhumation des urnes, avec des dalles à même le sol. Ici
aussi les rites funéraires évoluent. En 2017 on a inauguré une nouvelle pelouse
d’inhumation où l’urne est enfouie dans le sol et un pied supporte un lutrin
qui peut présenter jusqu’à quatre mentions funèbres. La
cavurne est un mix de caveau et urne ! Comme pour les inhumations classiques,
l’espace disponible et la problématique des ornements souvent encombrants à
côté des urnes traditionnelles ont mené à un mini-caveau enterré qui permet
l’installation de quatre urnes.
Les parcelles musulmanes
 |
| photo dh O.Pirard |
Le culte musulman implique une inhumation en
pleine terre (sans fondation), l’orientation des tombes vers la Mecque.
Généralement les pierres tombales ne sont pas décorées d’autres signes
particuliers. Robermont a été un précursuer en Belgique, en 1970. Du coup, des
défunts de toute la région et même de l’étranger ont été enterrés là. Dès 2011,
l’espace était arrivé à saturation (500 adultes et 1.000 enfants inhumés). On a
alors créé un autre lieu d’inhumation au cimetière de Jupille-Bruyères, et le
règlement communal a un peu encadré l’accès aux parcelles liégeoises. En 2018
une nouvelle parcelle est créée pour 428 sépultures (La Dernière Heure/28/2/2018).
D’ici 2022, une nouvelle parcelle
multiconfessionnelle sera accessible au cimetière de Rhées à Herstal. Selon
Denise Bohet, échevine en charge des Cimetières, «la demande émane
principalement de la communauté musulmane, voire un peu juive également. Nous
arrivons à une troisième, voire quatrième génération de musulmans et certains
défunts n’ont pas spécialement l’envie d’être inhumés ailleurs qu’en Belgique. On
ne voulait pas faire de cet endroit une sorte de ghetto, donc il n’y aura pas
de haie, de grillage ou autre… Il sera totalement intégré à l’endroit».
En parallèle, une autre parcelle sera dédiée
aux « étoiles » (pour les fœtus mort-nés entre le 106ième et le 180ième jour)
et aux « anges » (les enfants jusqu’à huit ans). « Ici il y aura une
uniformité. À charge de la commune, une pierre bleue similaire à chaque tombe
évitera toute stigmatisation. L’on viendra aménager les lieux avec des pelouses
et des statues d’anges. »
Le carré militaire
A part
Blegny-Mine, «site minier majeur» notre Cité ardente ne compte jusqu’ici
aucun site repris au Patrimoine mondial de l’Unesco. En 2016 la Région wallonne
a lancé un dossier de classement du cimetière militaire de Robermont (Sud
Presse 23/11/ 2016). Elle a demandé à
Christophe Bechet un rapport d’expertise intéressant sur le « carré militaire ». En 2018 le
Conseil international des monuments et des sites (Icomos) a rendu un avis
négatif concernant la reconnaissance par l’Unesco des sites wallons, flamands
et français de la Première Guerre mondiale, mais cet avis ne clôture pas le dossier.
Les grognards de
l’Empire
Il y a,
pour commencer, les grognards de l’Empire. Beaucoup de
généraux de la jeune Armée belge ont commencé leur carrière militaire dans les armées
de Napoléon. Les détails qu’on retrouve aujourd’hui sur eux sont étonnants et
parfois émouvants !
Comme ce Grenadier de la Garde impériale BOTTI
Englebert, né le 16/04/1790 à Falle-et-Mheer (Val-Meer) + 14.05.1870 Liège (parcelle 24, 2e ligne, tombe 16). La
formulation de la plaque « grenadier
de la garde impériale de la période 1792-1815 » pourrait faire croire
qu’il a eu la médaille de Sainte-Hélène, mais les archives de celle-ci restent
muettes. Il a dû commettre une infraction grave (tentative de désertion ?) pour
être envoyé en 1811, au régiment de l’île de Walcheren.
BRIXHE, Louis Guillaume Martin (1787 + 1876 ; parcelle 33, rang 10, 1ère
ligne) est le fils du révolutionnaire Franchimontois Jean-Guillaume Brixhe. Il a
été blessé deux fois en Espagne, en 1809 et en 1812. Avec le 13e Hussards il
participe à la campagne de France de 1814 où son régiment termine avec 13
officiers et 70 cavaliers! Il change de bord et se retrouve Capitaine chez les
hussards belges à Waterloo. En 1830, il est membre de la commission de guerre de
la jeune Belgique. Il devient le premier colonel commandant la Gendarmerie
belge.
CROSSÉE, Eugène-Joseph-Victor (parcelle 38, rang 1, 1ère ligne, près du
rond-point) quitte le service de la France après la campagne de 1814. A
Waterloo il est probablement dans l’Armée des Pays-Bas. Il devient
Général-Major à l’armée belge en 1847, à 51 ans. Il décédé au camp de Beverloo,
le 27 août 1855.
Charles Eugène Ernest, baron de GOESWIN entame sa carrière militaire au service de l’Autriche. Il la poursuit au
service de la France. Après la chute de l’Empire il devient lieutenant-colonel
au royaume des Pays-Bas.
Jean-Charles Van Landewyck (parcelle 17, 1er
rang) prend son congé en 1814 en tant que sergent. Il monte brillamment les
échelons de la hiérarchie militaire et meurt entant que colonel du 6ème
Régiment d’Infanterie dans l’Armée belge, à l’âge de 55 ans, le 30 octobre
1847.
LEBOUTTE, Jean-François-Nicolas entre en 1804 dans la Garde impériale. Il est
blessé à Eylau d’un coup de feu au pied droit. A Essling il reçoit un coup de
feu la cuisse gauche. Lors de la campagne de Russie il est une nouvelle fois
atteint au pied droit encore, ce qui ne l’empêche pas de faire la retraite
jusqu’à la Berezina. À la première abdication de Napoléon, il reste dans
l’Armée française, et est fait Chevalier de la Légion d’Honneur par Louis XVIII.
Au retour de l’Empereur, il le suit à la bataille de Waterloo. Il est admis
comme Capitaine dans l’Armée des Pays-Bas en 1818. Il intègre l’armée belge en
1830 et a son cheval tué sous lui et est encore blessé d’un coup de mitraille à
la main droite lors de la Campagne des Dix-Jours de 1831. Il termine sa carrière
comme Lieutenant-Général, après avoir participé à 16 campagnes ! Il décède à
Liège à l’âge de 83 ans, et repose dans la parcelle 20, sur la gauche, non loin
du monument français de la Guerre de 1870-71 (des grandes dalles superposées en
forme de cercueil).
L’OLIVIER, Jean-Nicolas-Marie (parcelle 7 /
rang 9 / 1ère ligne) est cadet au service de la Hollande à 7 ans. En
1804 (à l’âge de 12 ans !), il s’engage comme volontaire au 112e Régiment de
Ligne. Il faut dire que c’est son père
qui avait été chargé d’organiser le régiment ! Après sa démission honorable de
l’Armée française en 1814 il est admis dans l’Armée des Pays-Bas comme
capitaine. En 1830, il est intégré dans
l’Armée belge avec le grade de colonel.
La guerre franco-allemande de
1870-1871
Lors de
la guerre franco-allemande de 1870-1871, qui s’est terminée sur la Commune de
Paris, pas mal de blessés des deux camps ont été soignés à Liège, et certains y
sont décédés. En septembre 1872 est inauguré un monument qui porte le nom de 14 soldats
français, blessés à Sedan, et internés et décédés à Liège après leur défaite. Ce
monument fut remplacé en 1890 par un obélisque. En octobre 1872, un monument a été élevé
à la mémoire de trois soldats allemands, également blessés à Sedan et
décédés à Liège. Les
Allemands de Liège se cotisèrent pour édifier le monument à l’aigle tournant la
tête vers le «Vaterland».On voulait aussi poser quatre petits canons au pied de
la colonne (une symbolique jugée agressive envers la France, d’autant qu’on
soupçonnait ces canons d’être du butin de guerre). A cette époque, la colonie
allemande de Liège était forte de cinq mille résidents, estime Lambert Grailet,
qui consacra en 1986 une notice historique au monument à l’aigle. En 1998, on a volé l’aigle sculpté en
ronde-bosse qui surmontait la sépulture (llb 1-11-2004 et LeSoir 19/2/1999)
Le Grand Mémorial
La majorité des soldats belges tués au cours
de la bataille de Liège ne furent pas enterrés à Robermont, mais dans des
cimetières proches des batailles pour les forts (Chaudfontaine, Boncelles,
Rabosée ou Rhées). Le carré belge compte beaucoup de tombes de soldats morts
sur l’Yser et rapatriés ensuite en terre liégeoise à la demande des familles.
9000 soldats belges ont été rapatriés à la
demande de leurs familles. Et parmi ces derniers, il en reste 6000 dont les
tombes, qualifiés d’oubliées, existent encore aujourd’hui, les autres ayant
disparu au fil du temps par défaut d’entretien ou en raison d’une concession
non renouvelée. Ces dernières ont été inventoriées par le War Heritage
Institute via un site Web. Il y en aurait 500 à Robermont et à Sainte-Walburge (Bruno Boutsen 23/5/2018 llb).
Liège autorisa également certaines familles à
ensevelir leurs fils dans le caveau familial. D’où les deux caveaux
remarquables (famille Hubens-Chabot et famille Dechesne-Barbay) dans le fond du
champ d’honneur. Le caveau familial du lieutenant général Bertrand, qui s’était
illustré pendant les premiers jours d’août 1914, est dans l’axe du mémorial et
du buste du Roi Albert auxquels il semble répondre. Le général a aussi sa
statue près du pont d’Amercoeur.
Le concours pour le “Grand Mémorial” est gagné
par l’architecte Victor Rogister qui dessine un hémicycle de soixante mètres
d’envergure. Avec même un triptyque sur la face postérieure avec l’aigle
allemand attaquant une femme sans défense. Les sculptures sont d’Oscar Berchmans.
La stèle centrale haute de 17 mètres, encadrée par deux colonnes cannelées,
porte l’inscription : « 1914-1918 AUX/ HEROS/ DE/ LA/ GRANDE/ GUERRE/
TOMBES/ AU/ CHAMP/ D’HONNEUR/ GLOIRE/ ETERNELLE ». Sous l’inscription, une
figure féminine en haut-relief symbolise l’Humanité. De part et d’autre, deux
murs incurvés ornés de hauts-reliefs avec les inscriptions : « POUR LA
PATRIE » et « POUR L’HUMANITE ». Le monument s’affaisse peu à peu
et toutes les pierres se descellent. La stèle a été démontée en partie en 2005.
Le cabinet p.HD préconise les
interventions suivantes : le démontage de toutes les pierres, les restaurations
de ces dernières, la création de nouvelles fondations et le remontage de
l’ensemble.
D’où viennent alors toutes ses autres nationalités ?
Mais Robermont a recueilli aussi les
dépouilles de nombreux soldats étrangers. Toujours selon la Commonwealth War
Graves Commission, il contient les tombes de 800 Allemands et de 700
prisonniers de guerre des pays alliés. Lors de l’inauguration de ce «petit
mémorial interallié » en octobre 1926, en présence du roi Albert, il y avait des
représentants de l’Angleterre, la France, l’Italie, la Pologne et le Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes. La Russie était absente car le gouvernement
soviétique n’avait pas encore été reconnu par la Belgique. Les Allemands n’ont
pas été conviés non plus. Les dépouilles des soldats allemands sont d’ailleurs
reléguées dans une autre partie du cimetière.
Mais d’où viennent toutes ses autres nationalités puisque la bataille de Liège (4
août – 16 août 1914) n’a vu s’affronter que les armées belge et allemande ?
D’abord Liège a accueilli une multitude de blessés allemands, puis des
prisonniers de guerre russes, italiens, serbes qui furent utilisés comme main
d’œuvre entre autres dans la construction et l’entretien des lignes de chemins
de fer stratégiques.
Des 48 tombes identifiées dans le carré
britannique, une trentaine appartiennent à des soldats décédés entre mars et
décembre 1918, soit de blessures graves, soit de maladies comme la dysenterie
aigue, la grippe espagnole ou la bronchopneumonie. On déplora encore la mort
d’un grand nombre d’entre eux après la signature de l’Armistice. Au milieu du
carré du Commonwealth, la croix du sacrifice, présente dans tous les cimetières
militaires du Commonwealth.
119 croix françaises encadrent la statue d’une
dame voilée fermant les yeux. Les anciens combattants français résidant à Liège
pouvaient être inhumés aux côtés de leurs frères d’arme. D’où des dates de mort
largement postérieures à la fin du premier conflit mondial.
Les Italiens ont connu probablement le sort le
plus dramatique. Leurs 347 sépultures dépassent largement les effectifs des
autres nations. Après la défaite de Caporetto en octobre 1917, 300.000 soldats
italiens avaient été faits prisonniers de guerre (PG). Une partie s’est
retrouvée dans des camps de concentration en Belgique. Les conditions de vie
des 300 italiens détenus dans les camps de concentration austro-hongrois
étaient désastreuses. Ils étaient considérés comme travailleurs forcés pour qui
la convention de La Haye de 1907 sur les prisonniers de guerre ne jouait pas.
Anne Morelli a soulevé le problème en 1978 lors d’un colloque sur les relations belgo-italiennes en 1914-1918,
sur base des dossiers des prisonniers italiens détenus à la citadelle. Quarante
ans plus tard, avec le centenaire de la Grande Guerre, qu’on se rend compte
que 67% des 548 tombes de soldats
italiens sur 9 cimetières en Belgique sont morts comme PG, entre la fin 1917 et
le début 1919. 182 soldats du Secondo Corpo sont morts sur le champ de
bataille, lors de la reconquête du Chemin des Dames en janvier 1918. A
Robermont il s’agit des troupes auxiliaires de la Secondo corpo. L’obélisque est
cerclé à sa base de faisceaux, emblèmes de l’Italie fasciste. Sur le socle on
lit : « Al soldati d’Italia morti
per la grandezza della patria. 1915-1918 » (Aux soldats d’Italie, morts pour la
grandeur de la patrie. 1915-1918). Or qu’après la défaite de Caporetto,
l’État italien considérait une grande partie de ses compatriotes prisonniers
comme des déserteurs “dans la mesure où
ils n’avaient rien entrepris pour se défendre”. Le gouvernement italien
bloquait même les colis de la Croix Rouge pour ces PG.
Accolé aux tombes italiennes, un aigle serbe perché
sur un amas de pierre monte la garde sur cinq tombes d’une extrême simplicité,
faites de béton et de graviers mélangés. L’aigle est de la main du sculpteur
liégeois Louis Gérardy.
Enfin, situé à l’autre extrémité du champ
d’honneur, le carré russe avec ses 146 croix de béton et une vingtaine de croix
en pierre. Les croix anciennes marquent l’emplacement des sépultures des
prisonniers de guerre. Les croix de meilleure facture correspondent aux tombes
d’exilés russes ayant fui la Russie soviétique. Leurs dates de décès sont
postérieures. Sur plusieurs de ces croix est repris le grade et l’ancien
régiment du défunt dans l’armée impériale, un ultime témoignage de fidélité à
la Russie tsariste. Quelques croix sont des exilés russes victimes des
bombardements en 1944.
Et il y a aussi un seul Hollandais :
Nicolaas Egidius Erkens, né en 1894 à Maastricht. Lors de la guerre 40-45 il
avait assisté des prisonniers de guerre, des pilotes alliés accidentés et des
Juifs, ainsi que fourni armes et explosifs. Fin 1942, il avait été arrêté et
fusillé à Utrecht, avec notamment le comte Raphaël de Liedekerke, du château
d’Eijsden et Jules Goffin du réseau Clarence. Son nom est inscrit sur le
monument de Rijnauwen (Utrecht). Mais comme il avait épousé une Liégeoise,
Bertha Hustinx, il a été ramené au cimetière de Robermont à la demande de la
famille de son épouse, dans une tombe marquée du drapeau belge. Plus tard la
famille a demandé un drapeau hollandais sur la stèle. Un monument évoque aussi la mémoire de cinq fonctionnaires du
cimetière. Deux d’entre eux ont été tués sur le champ de bataille, l’un est
mort en captivité et les deux autres ont été assassinés par les Allemands le 22
août 1914, sous prétexte d’une embuscade. Il y a aussi la sépulture de Jules
Hentjens, le capitaine du remorqueur Atlas V qui, en 1917, força les barrages
allemands pour faire passer des volontaires en Hollande.
Le monument allemand
En mai 1916 l’administration civile impériale
allemande exigea la concession à Robermont de la parcelle où avaient été
enterrés 360 soldats allemands, 56 belges, 33 français et 3 anglais, décédés la
plupart dans les hôpitaux liégeois. L’intention des autorités allemandes était
d’y édifier un monument mixte en l’honneur des « défenseurs de leurs patries ». L’autorité occupante proposait même
d’acheter la concession. Le Conseil communal accepta mais réclama que les
soldats belges et alliés soient exhumés et enterrés dans une autre partie du
cimetière. Elle refusa aussi la somme proposée.
La petite nécropole allemande compte
aujourd’hui 205 croix et deux stèles juives. Selon l’association pour la
sauvegarde des tombes de guerre allemande (Volksbunde Deutsche
Kriegsgräberfürsorge) 795 allemands sont enterrés à Robermont. En raison du
manque de place, les tombes renferment en moyenne quatre soldats.
Devant
le cimetière allemand il y a aussi un monument contenant des cendres de
Dachau.
Un bien noir ‘rendu’ aux hospices civils
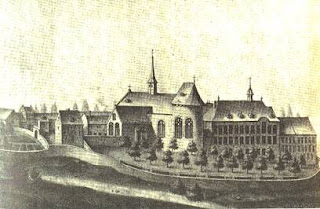 |
| abbaye robermont |
Nous sommes rentrés par la partie la plus
récente. Après les carrés militaires nous arrivons dans la partie historique. Le cimetière se trouve sur le site d’une
importante abbaye appartenant à l’Ordre de Cîteaux, établie sur les hauteurs de
Liège au 12e siècle. En 1792, l’abbaye est pillée par les armées françaises.
L’année suivante, le prince-évêque est rétabli et les religieuses reprennent
possession de leur bien. Pas pour longtemps : en 1794, les troupes
françaises dévastent les bâtiments. En 1797, une partie du couvent, à
l’exception du jardin, est vendue aux enchères. Les religieuses récupèrent une
partie de leurs biens via un homme de paille.
En 1799, le Conseil municipal affecte
provisoirement le jardin de l’abbaye à l’inhumation de militaires morts à
l’hospice des Écoliers. Puis le décret impérial de 1804 prohibe les inhumations
dans les églises et dans l’enceinte des villes. La dernière religieuse de
Robermont décède vers 1814 et lègue ce qui reste de l’abbaye à la Commission
administrative des Hospices civils.
L’enceinte primitive du cimetière correspond
au jardin clôturé de l’ancienne abbaye. Les allées principales convergent vers
l’ancienne morgue, construite en 1824. Le fronton triangulaire est orné d’un
urobouros enserrant un sablier ailé. Ce bâtiment sert aujourd’hui d’entrepôt.
Les monuments funéraires disposés en arc de
cercle devant ce bâtiment au centre du cimetière primitif, dans l’axe de
l’entrée du site, sont les sépultures de bienfaiteurs des hospices. Le monument
funéraire d’Isabelle Pansmay, veuve Remy, décédée en juin 1848, est érigé par
son neveu et les hospices de Liège. Le monument de 1844 à P.G. Lonhienne aussi
porte l’inscription : « Les hospice de Liège à leur bienfaiteur. Idem pour le
monument « à la mémoire de Madame
Denizet, bienfaitrice des pauvres RIP Bureau de bienfaisance ».
A partir de 1818, Robermont devient le seul
cimetière de la ville.
Des monuments surprenants
Selon Chantal Mezen, présidence de l’ASBL
« Les Cimetières liégeois », l’art funéraire est parti en 1804 du code
des sépultures de Napoléon, qui n’a été modifié chez nous qu’en 1971. Le code
permettait l’achat d’une parcelle en concession et les gens ont rivalisé dans
la mort comme dans la vie. Après la Seconde Guerre mondiale on a assisté à une
standardisation. Mme Mezen propose qu’on permette aux familles de restaurer à
l’identique une sépulture ancienne à l’abandon, qui serait cédée pour un franc
symbolique (La Libre Belgique7/11/2005).
Robermont est l’un des plus beaux cimetières
de Wallonie, avec ses grands arbres, des allées ombragées, quelques belles œuvres,
des monuments surprenants.
Lors des nombreux agrandissements on a une
évolution urbanistique «en quadra », comprenant des allées rectiligne et un
parcellaire parallèle. Le long de ces allées subsistent encore, autour de
tombes anciennes, des structures métalliques servant de support à
l’installation des dais funéraires et des couronnes lors des funérailles.
Classé comme site par arrêté ministériel du 24
septembre 2002, il abrite les sépultures de nombreuses personnalités. Un
intérêt architectural également attesté par la présence de sépultures de divers
styles : néo-gothique, néo-classique, éclectique, art nouveau et art déco.
Le site est divisé en trois zones avec des
prescriptions spécifiques. La zone A comprend des restrictions axées sur la
conservation de l’aspect général du site et de sa végétation. Les zones B et C,
intégrées dans la zone A, comprennent des prescriptions relatives aux
sépultures antérieures à 1930 et aux nouvelles interventions. Les zones C
concernent les ensembles les plus remarquables.
Les tombes repris dans l’Inventaire du patrimoine immobilier
culturel (IPIC)
Beaucoup de monuments sont repris sur la fiche
de l’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC). J’en reprends ici quelques uns.
L’imprimeur
Auguste Bénard (1854–1907 ; Zone A, parcelle 20) est le fondateur du
journal « la Meuse» d’où l’inscription « A AUGUSTE BENARD / LES
TRAVAILLEURS DE SA MAISON ». Le bas-relief en bronze est signé par Oscar
Berchmans. Le petit médaillon est attribué à Rassenfosse, qui fut un des
illustrateurs de son journal.
 |
| la famille bouvy sculpté par Brouns et Rulot |
Le Monument funéraire de la famille Bouvy face
à l’ancienne morgue centrale (Zone C, parcelle 17/19) est de l’architecte Paul
Jaspar. Le bas-relief en marbre blanc représentant la résurrection du Christ et
Piéta est l’oeuvre du sculpteur herstalien J. Rulot assisté par J. Brouns. Le plafond
est orné d’un vitrail polychrome, avec l’urobouros, un serpent avalant sa
queue, symbole du temps cyclique, entourant les lettres « SPES » (espoir). A
droite, un flambeau allumé droit et, à gauche, un flambeau renversé, symbole de
la vie qui s’éteint.
La porte en bronze du mausolée du peintre-décorateur
Pascal Joseph Carpay (1822-1892 – Zone C, parcelle 87) est décorée d’un
flambeau renversé, symbole de la vie qui s’éteint. La chapelle abritait un
buste du défunt, aujourd’hui disparu, sur un socle encore en place. Surmontant
la chapelle, second registre composé d’un cénotaphe entouré d’une colonnade
servant de socle à un groupe allégorique en bronze signé L. Mignon, composé
d’une pleureuse entourée de deux enfants et d’un ange autour de l’urne
cinéraire du défunt. Cette sépulture d’artiste conçue par des artistes est
unique en Wallonie.
 |
| Morren- photo androom |
La tombe Zone B, parcelle 36 est de Charles
Morren (1807-1858), professeur de botanique à l’ULg, fondateur du Jardin
botanique ; et de son fils, Edouard (1833-1886), professeur de botanique. Charles
a développé la fécondation artificielle de la vanille en 1836. Un manteau
d’académicien est posée sur une stèle ornée d’un rameau de « Morrenia odorata
Lindley ». Cette plante dédicacée à Charles Morren est souvent confondue avec
du lierre.
Le memorial « élevé par souscription
publique » du poète Defrêcheux (1825-1874 – Zone B, parcelle 42) est de l’Art
déco de l’architecte Bernimolin. Les inscriptions en wallon reprennent ses
poèmes « LE MÎZ M’ / PLORER » « LES / ORFILINS » « TOT / HOSSANT » « L’AVEZ V’
/ VEYOV / PASSER » « LI / CHARITÉ » « MES DEÛX LINGADJES ».
Le tombeau de Walthère Frère-Orban (1812-1896-
Zone C, parcelle 42) est un des édifices les plus remarquables de l’art
funéraire en Wallonie. Il a été érigé de son vivant, en 1891. Le monument est
conçu par l’architecte Charles Soubre en style néo-gothique. C’est une sorte de
testament de pierre. Une tour d’une dizaine de mètres se dresse au centre d’une
terrasse bordée d’une balustrade, délimitant ainsi un enclos préservé. Hérissée
de tourelles d’angle, de pinacles et de gargouilles, largement ajourée dans sa
partie supérieure à la manière d’un clocher, autrefois surmontée d’un ange, cet
édifice rappelle de prime abord le clocher des églises néogothique. Mais la
tour évoque en fait un beffroi, symbole des libertés civiles. Walthère
Frère–Orban fut l’un des fondateurs du Parti libéral en
1846, ministre et premier ministre à deux reprises ;
fondateur de la Banque nationale, de la Caisse d’Épargne et du Crédit Communal
et président de la commission des hospices civiles de Liège.
La tombe du sculpteur Léonildo Giannoni
(1880-1935 – parcelle 24) est de style moderniste de 1935. Sur le socle, très
belle allégorie du deuil théâtral, nu en marbre blanc importé d’Italie, portant
la signature du sculpteur.
La famille Hargot (Zone A, parcelle 131) a une
chapelle de style néoclassique orientalisant, coiffée d’un dôme couronné d’une
croix celtique.
La tombe de la famille Herman-Jodogne Zone B,
parcelle 110 est de l’Art nouveau, avec bas-relief en bronze attribué à Oscar
Berchmans
L’ imposant monument de 10 mètres de haut
situé dans l’axe de l’ancienne morgue, flanqué de deux lions couchés et couronné
d’un perron liégeois surmonté d’une croix, est de Louis Jamme (1779-1848), Bourgmestre
de Liège de 1830 à 1838 et député.
La colonne ionique brisée, dont la partie
supérieure est posée horizontalement devant celle-ci (la colonne brisée symbolise le pilier de famille disparu Zone A,
parcelle 131) est « IN MEMORY / OF
THE HONORABLE / COLONEL PETER JEFFERYS
LATE PRESIDENT OF THE ISLAND OF
NEVIS / DECEASED AT LIEGE / FEBRUARY 10TH 1859 / AGED 77 YEARS ». Notre
Gouverneur de l’île de Nevis https://en.wikipedia.org/wiki/Nevis#1800_to_the_present_day
(Caraïbes) le quitta en 1824 pour s’installer à Liège,
où il avait séjourné auparavant.
Le monument funéraire de Françoise Lanhay (Zone
A, parcelle 30/32) est un remarquable gisant en marbre blanc protégé par une
serre en forme de chapelle, signée par Jean Joseph Halleux, FRANCOISE CAROLINE
LEOPOLDINE / LANHAY / Enfant unique / NEE LE 07 AOUT 1846 / DECEDEE LE 07 AOUT
1864.
Le monument funéraire de la famille Loeser (Zone
B, parcelle109) est d’après les plans de l’architecte Paul Comblen, Art déco
ornée d’un bas-relief de bronze signé O. Berchmans et B. Verbeyst fondeur
Bruxelles. Allégorie du deuil représentée par une femme debout de profil, vêtue
d’un long drapé, levant au ciel une lampe.
La tombe Art nouveau de Gustave Serrurier-Bovy
(1858-1910- Zone c, parcelle 89-85) est orné d’un bas-relief en bronze attribué
à Oscar Berchmans. Six piliers de section carrée reliés par un grillage
délimitent la sépulture.
Zone A, parcelles 102 et 103, un ensemble de 5
chapelles des familles Laloux, Chaudoir, Guillemin-Pender et Delsemme-Troisponts
Dans l’une des premières zones
d’agrandissement de la Zone B on trouve des sépultures en chambre sur caveau,
en forme de chapelle généralement de style néo-gothique. Le vitrail en très bon
état de la chapelle de la famille C.Close (parcelle 64) représente saint
Jean-Baptiste et une Vierge à l’enfant ; les fragments d’une fresque sont
toujours visibles sur le mur de droite.
Célestin Demblon, Eduard Wagener, René Beelen etc.
Le monde
ouvrier a aussi ses tombes, comme celle de Célestin Demblon. Lors des élections
de 1894, le jeune instituteur révolutionnaire avait battu l’ancien ministre
libéral Frère-Orban (alors que le suffrage est encore plural). En 1918 la création de l’Union soviétique fait naître chez Demblon un
grand espoir: «Je suis pour la révolution russe, qui
constitue une forteresse pour la classe ouvrière du monde entier. Sans cette
forteresse, sans cette révolution, la bourgeoisie n’aurait pas fait de
concessions concernant la sécurité sociale au POB. Une sécurité sociale que la
bourgeoisie jette à la tête des travailleurs par peur panique du bolchevisme
dans notre pays, comme on jette un os à un chien dangereux.»
En 1921, il
soutient Julien Lahaut qui mène une grève à Ougrée-Marihaye pendant neuf mois. Au
bout de sept mois, lorsque d’autres dirigeants syndicaux annoncent qu’il n’y a
plus d’argent pour les grévistes, Lahaut envoie les enfants des grévistes dans
des familles d’accueil. C’est le moment que choisit le POB pour arrêter la
grève. Une commission du Parti Ouvrier Belge reproche sévèrement à Demblon son
soutien à Lahaut. Son rapprochement avec les communistes
ne plait pas à la Fédération socialiste liégeoise qui « constate » que Demblon « n’a
pas régulièrement payé ses timbres d’affiliation et s’est exclu de lui-même ». Selon J-M Dehousse, Célestin DEMBLON « se
prépare à opter pour le nouveau Parti Communiste lorsqu’il meurt de la grippe,
ce qui lui vaudra deux monuments funéraires ». Je n’ai pas retrouvé une deuxième tombe, mais
celle que j’ai trouvé reprend ce beau texte : « Les travailleurs révolutionnaires au grand socialiste, à
l’écrivain, au tribun qui donna toute sa vie à la cause prolétarienne ». Selon Jules Pirlot, la
tombe est adoptée comme monument par la Ville de Liège. L’inscription
ne parle ni de communiste ni de socialiste mais de révolutionnaire auquel le
prolétariat liégeois rend hommage (souscription pour la tombe) on dirait (hypothèse de J.P.) la main discrète du parti
communiste soucieux de récolter de l’argent chez les ouvriers socialistes de
gauche….
 |
| tombe Wagener photo jp remiche |
Nous irons
aussi saluer le cafetier Herstalien Edouard Wagener,
président des « Va-Nus-Pieds » (parcelle 90). Le 18 mars 1886 il
appelle à un grand meeting public en commémoration du 15° anniversaire de la Commune
de Paris. Ce meeting sera le point de départ d’une révolte qui balaye tout le
pays. Il reçut d’abord six mois de
prison pour bris de clôture, et la Cour d’assises le condamna ultérieurement à
cinq ans de réclusion pour excitation au pillage. Pour lui, la règle « non bis
in idem » ne comptait pas… Wagener décède en 1894. Un bonnet phrygien est posé
sur son monument funéraire. Je suppose que ce monument aussi a été payé par
souscription publique.
Il y a aussi la tombe de René BEELEN,
ouvrier d’usine, résistant, militant à la Jeunesse communiste, vice-président
du Parti communiste belge, conseiller provincial de Liège. Il décède à Moscou
le 15 février 1966, alors qu’il vient d’y prononcer un discours devant les
ouvriers d’une usine de machines-outils. Ses funérailles à Liège étaient
impressionnantes, avec un long cortège depuis le siège de la fédération
liégeoise du PCB sur le quai de la Batte, jusqu’au cimetière de Robermont, où
il est inhumé dans la pelouse d’honneur aux côtés de ses compagnons d’armes,
militaires et résistants combattant l’Allemagne nazie.
Il y a
aussi Ernest Burnelle. La participation à ses funérailles avait été massive,
avec des discours de l’ambassadeur d’URSS, un représentant du Parti communiste
français, Frans Van den Branden au nom de l’aile flamande du PCB, et Marc
Drumaux, vice-président et successeur d’Ernest Burnelle à la tête du PCB. Burnelle
a été un compagnon de lutte de Julien Lahaut. Permanent du PCB clandestin il
poursuit sa lutte au Borinage. Il deviendra président national du PCB en 1961.
Il a joué un rôle important lors de la scission du mouvement communiste
international. Un courant prochinois critique le révisionnisme du PCB et son
abandon du marxisme-léninisme. Pour Ernest Burnelle par contre, l’appel à
l’unité du mouvement communiste international est une invitation à isoler la
Chine. Burnelle est réélu député en mars 1968. En juin, il est frappé par une
hémorragie cérébrale, en plein discours, à Saint-Gilles, son quartier
d’origine, lors d’un colloque. Le 6 août, il décède sans être sorti du coma (JulesPirlot, « BURNELLE Ernest, Louis).
J’ai
encore connu personnellement Marcel Levaux, dernier bourgmestre communiste de
la province de Liège, décédé en 2007. Il avait adhéré au Parti communiste en
1942. Elu député communiste en 1968, il a siégé à la Chambre jusqu’en 1981. Élu
conseiller communal à Cheratte en 1970, il en devint le bourgmestre en avril
1971 à la tête d’une tripartite (PC, chrétienne et libérale) qui avait rejeté
le PS dans l’opposition. Il restera ainsi mayeur de Cheratte jusqu’aux fusions
de communes de 1977 (LS 12/06/2007).
La pierre, taillée de père en fils
A la sortie, la SA Latour qui taille les
monuments funéraires depuis quatre générations. Etienne Latour est à la tête de
la société Latour depuis 1997, à la mort de son père. En 1881, Etienne Latour,
l’arrière-grand-père… d’Etienne Latour, quitte Florzé où il travaillait déjà la
pierre, pour venir s’établir à Herstal, devant le cimetière de Foxhalle. Il
préférait amener le petit granit pour le travailler sur place. » A coté des
monuments funéraires, Latour faisait aussi des seuils ou des appuis de fenêtre.
Après il déménagea en Rhees, toujours à Herstal. Les quatre fils, Louis,
Joseph, Lucien et Léon, lui succédèrent dans le travail de la pierre. Etienne
Latour raconte : «en 1979 mon père Jean-Marie a ouvert à Robermont et, quelques
mois plus tard, à Sainte-Walburge. Il s’était recentré sur le funéraire ».
Etienne a à nouveau élargi sa gamme. Il taille des tables, des sièges, des
vasques, des bancs, des objets de salles de bains, et d’autres objets de
décoration. » (Charles Ledent La Meuse 2/11/2015).
 |
| photo jp remiche |
Sources
https://www.facebook.com/groups/Patrimoine.Liege.Cimetiere.Robermont/posts/2842686499348854
MEZEN CH., Le cimetière de Robermont, le
Père-Lachaise liégeois. Noir Dessin Production
http://hachhachhh.blogspot.com/2014/08/mes-coups-de-cur-pour-les-journees-du.html
Sur Demblon
http://hachhachhh.blogspot.be/2014/08/demblon-en-juin-1899-au-parlement-si-le.html
Sur Rhées https://hachhachhh.blogspot.com/2021/10/le-cimetiere-de-rhees-une-ville-en.html
https://ceserh.hypotheses.org/1328
Eugénie Bechoux Une sémiotique du simulacre dans nos cimetières. Le cas de
Robermont
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/fiche/index?codeInt=62063-INV-2499-01
Bibliographie suivante a été repris de la
fiche de l’’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) sur Robermont
BEAUJEAN J., 1999, Sur la piste des anciennes
gloires de la botanique et de l’horticulture à Liège, Visite du cimetière de
Robermont, Natura Mosana, p.82-92.
BROSE J., 1969. Deux grognards de l’Empire
enterrés à Robermont, B.S.R.V.L., no 167, p. 436-438.
BROSE J., 1976. Deux monuments liégeois,
souvenir de la guerre franco-allemande de 1870, B.S.R.V.L., no 195, p. 96-101.
DE QUATREBARBES E., BROSE J., 1978. La
mystérieuse pyramide de Robermont, La Vie Wallonne, no 364, p. 221-225.
O.D., 1974. Robermont : de l’abbaye à la
nécropole, La Vie Liégeoise, no 1, p. 4-15.
GOBERT TH. Liège à travers les âges. Les rues
de Liège, tome 10, p.189-217
GRAILET L., 1986. Un autre regard sur
Robermont, Si Liège m’était conté, no 100, p. 21-28.
HEXT G., 1997. Le cimetière de Robermont,
Liège.
B. LECOSTE, Quelques curiosités monumentales
et épigraphiques des nécropoles de Liège et des environs, dans Notes et
enquêtes du musée de la Vie Wallonne, t. 64, nos 409-412 (1990), p. 197-212.
B. LECOSTE, Promenade dans les cimetières
liégeois, sépultures de Liégeois célèbres et d’auteurs wallons, dans
B.S.R.V.L., no 254 (juillet-décembre 1991), p. 260-267
Beau reportage photo https://www.lavenir.net/extra/content/webdoc/webdoc-cimetiere/liege.html



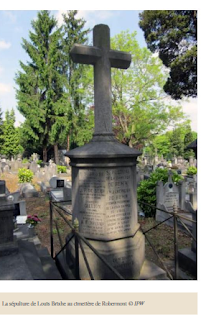

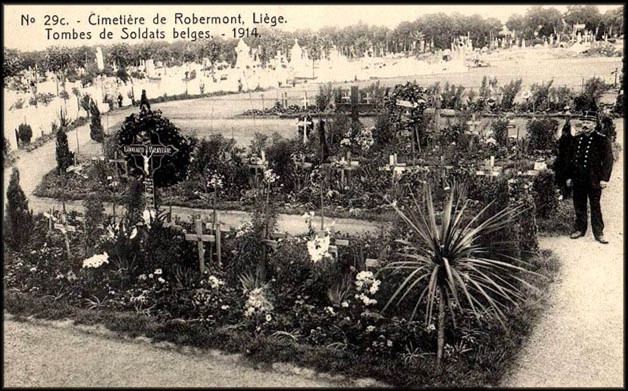


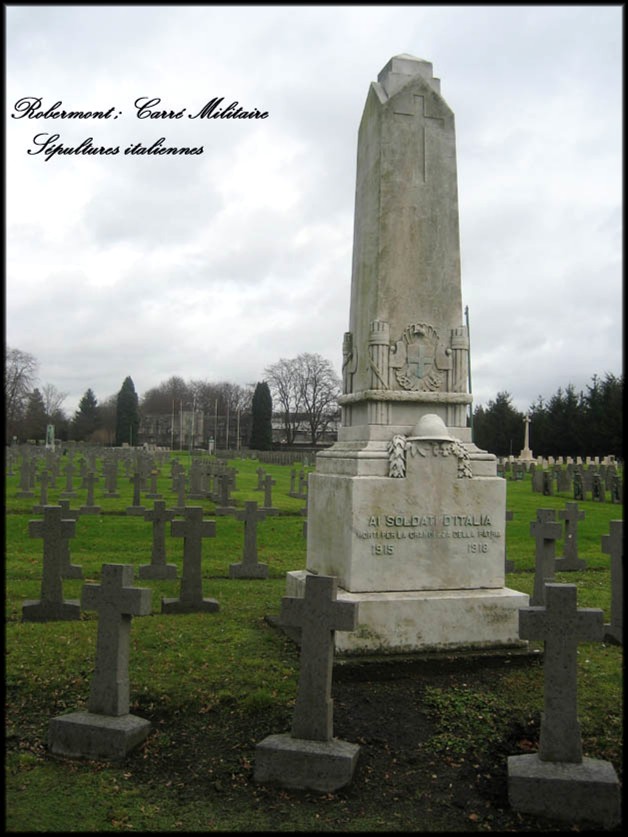
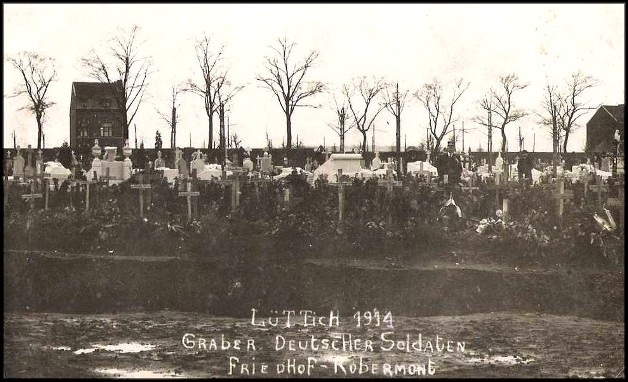




Madame Chapeau
4 ans agoMerci pour cet article passionnant et très instructif !!