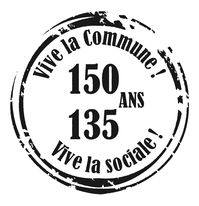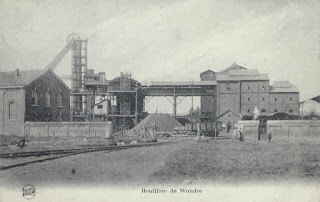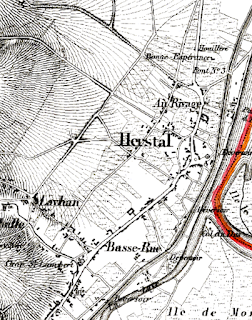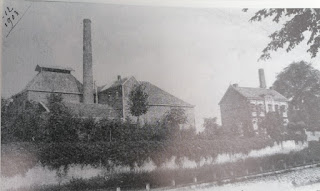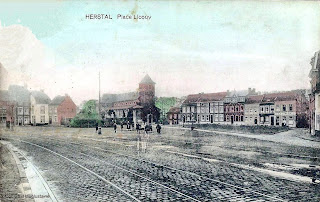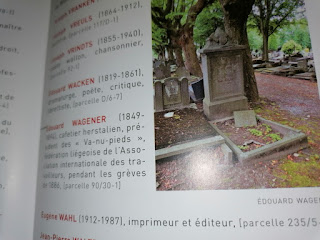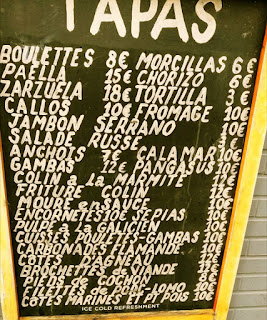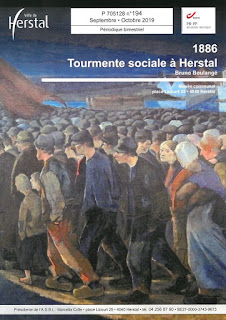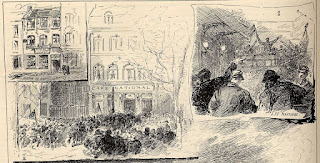Sur les traces d’Edouard Wagener, cafetier au Rivage
Le 18 mars 1886 Edouard Wagener, président des
« Va-Nus-Pieds », la fédération liégeoise de l’Association
Internationale des Travailleurs, avait appelé à un grand meeting public en
commémoration du 15° anniversaire de la Commune de Paris, suivi d’une
manifestation place Saint Lambert. Ce meeting sera le point de départ de la
bourrasque sociale de 1886. A Herstal le bourgmestre apprend que la même nuit une dizaine d’individus‘s’étaient promenés à Wandre avec drapeau rouge et bonnet phrygien. Ils avaient
chanté la Marseillaise, traversé le pont de Herstal-Wandre et étaient venus
manifester devant le café de Wagener, au Rivage. Malgré les ordres donnés, le café était
ouvert. Le bruit circulait qu’un meeting devait se tenir le soir place Licour.
Le commissaire de police en fit sortir ‘plusieurs
individus notoirement connus comme adeptes de Wagener. Ils furent conduits, sous escorte de police
et de pompiers, jusqu’au-delà du pont’. Le lendemain Wagener est arrêté; il
finira aux Assises.
La main tendue du ténor syndicaliste FGTB wandrien Gillon
Cette année 2021, à partir du 18 mars, des
commémorations sont organisées dans plusieurs villes, avec, entre autres, du 20
avril au 20 mai une exposition à l’espace Marexhe à Herstal (elle est du 18 mars au 18 avril au
PointCulture Bruxelles).
C’est dans ce cadre-là que je voudrais vous
proposer une petite balade dans les pas de cette dizaine d’individus qui, le 18
mars 1886, étaient venus manifester devant le café de Wagener. Je propose de la
commencer à l’œuvre monumentale
implantée à la sortie de l’autoroute à Wandre. En 2005, dix ans après sa mort, Maddy
Andrien a sculpté, dans un style figuratif très «premier degré», la main
tendue du ténor syndicaliste FGTB wandrien Robert Gillon, Il indique la FN où
il fit ses armes, littéralement et au figuré. Certains l’assimilaient au Che…
Il est vrai qu’il se disait intime de Castro et appréciait ses havanes. De
profil, la silhouette caricaturale de sa tête précède des troupes d’ouvriers
(métallos, on suppose). Il a démarré à la FGTB comme sectionnaire à la FN, en
1960. Puis il a été élu président des
métallos puis de la régionale de la FGTB.
Derrière la statue on voit le site de Chertal,
menacé en 2003 de fermeture par Arcelor; repêché par Mittal, jusqu’à la crise
économique de 2008, et puis mis sous cocon en vue d’un très hypothétique
redémarrage, jusqu’en 2019, …
Du premier au quatrième pont de Wandre
Le pont de Wandre qui a été témoin des
évènements de la nuit du 18 mars 1886 avait été inauguré deux ans avant, en
1884. Il a été dynamité en 1914. Rebelote pour le suivant en 1940. Et le
troisième a été remplacé pour le pont actuel, classé monument du patrimoine
historique majeur 6 ans après sa construction. Le concepteur René Greisch est
décédé en 2002 ; c’est son bureau qui a aussi conçu le pont de Millau :
deux kilomètres et demi au-dessus de la vallée du Tarn, en France.
Ce pont de Wandre est peut-être un monument,
mais ce n’est certainement pas un exemple à suivre pour la mobilité douce. Selon
le Plan Communal de Mobilité de 2006 « le Pont de Wandre est le seul ouvrage permettant de relier directement
Herstal à la rive droite de la Meuse. Il est donc un passage obligé pour les
cyclistes souhaitant traverser le fleuve et doit en ce sens leur permettre une
circulation en toute sécurité. Dans un premier temps, on pourrait partager
l’usage du trottoir sur le pont entre les piétons et les cyclistes; aménager
les bordures pour permettre aux cyclistes de
monter de façon confortable sur le trottoir partagé, voire aménager une
passerelle pour cyclistes accolée au pont (exemple du Pont Atlas à Liège) ».
Quatorze années plus tard, j’ai soulevé ce problème lors de l’enquête publique
sur la mise à double sens du boulevard Albert I. On m’a répondu que ce problème
est pour plus tard…
Nous prenons le trottoir à droite, qui descend
sur Intradel. Tout d’un coup, le trottoir s’arrête. Il faut marcher un peu sur
la route pour rejoindre le ‘beau’ Ravel qui contourne l’usine d’Intradel. Il y
a mieux comme vue, mais le passage sur le halage par où Intradel transborde les
ordures ménagères d’un peu partout est impossible.
Wagener et ses mineurs
La base de Wagener était des mineurs. La
Fabrique Nationale ouvrira seulement 12 ans plus tard. D’un côté du pont il y avait la houillère de Wandre ; de
l’autre l’Espérance. Et au bout de notre balade, à Milsaucy, il y avait aussi
une ‘paire aux houilles’. La zone industrielle et commerciale le long du canal que
nous voyons aujourd’hui est construite sur l’ancien terril de ce charbonnage.
Pour ces mineurs, ce pont de 1884 était un fameux cadeau. Avant cela, il y
avait là un passeur d’eau qui faisait le difficile, et augmentait ses prix, pour
les mineurs qui devaient traverser la Meuse (et le canal) très tôt ou très
tard, après une journée harassante.
Ceci dit, Wandre était relié à Herstal aussi en
sous-sol, depuis que l’Espérance avait repris une partie de la concession de
Wandre. Et il y avait même un transporteur aérien, entre le site d’Abhooz de
Basse Campagne et la gare de Cheratte.
Wagener n’a pas eu une carrière aussi lisse
que Gillon. Il avait été sous-officier, grâce à « une grande facilité de conception et d’élocution ».
Apparemment ces qualités étaient peu appréciées par l’armée : il avait été
ramené au rang de sergent, puis dégradé. Il avait monté à Liège une affaire de
galvanoplastie, puis travaillé à la Fonderie des canons. Il avait été négociant
et commissionnaire, avant de s’établir au Rivage comme fabricant de chaises et
cabaretier. Des gagne-pain qui lui permettaient de déployer son militantisme.
Les mines ne sont plus là. Mais on n’a jamais
eu autant de charbon que maintenant, avec le port charbonnier. Quant aux
métallos de Gillon, il reste encore un millier d’armuriers. Mais les
spratcheurs de tôle de Chertal sont aussi dans les décors de l’histoire.
Le quartier du Rivage, port de Herstal sur la basse Meuse
Le café de Wagener était au Rivage. Sur les
anciennes cartes, au Rivage, c’est tout le quartier qui allait de Milsaucy à la
rue Chera. Nous suivrons notre historien local André Collart, pour qui le quartier
ou hameau s’étendait depuis l’ancien pont n°4 jusqu’à hauteur du charbonnage de
Bonne Espérance.
Jusqu’en 1850 et le canal, le rivage était le
port de Herstal sur la basse Meuse, Coronmeuse restant le port de la Meuse supérieure.
De nombreux bateaux amenaient des pierres de taille, des bois de construction,
des bois pour charbonnages, de la chaux, des vins, des huiles, des perches à
houblons, etc.,etc. Ils emportant en retour des houblons, des houilles et
charbon de nos fosses. C’est là que touchaient les barques de Maestricht et les
nefs marchandes de passage. La rive n’était pas aménagée pour permettre
l’accostage à quai, càd à un mur d’eau bien établi en pierre de taille. Il ne
se trouvait là qu’un talus mal entretenu d’un abord tout à fait primitif, à
certain endroit taillé dans la roche. Ainsi les barques étaient-elles souvent
tenues, surtout pendant les périodes de sécheresse, de s’ancrer au milieu du
fleuve. Des allèges amenaient alors du rivage – ou inversement- les divers
chargements.
Au XVIIIième siècle l’importance du rivage
était telle que l’on devait établir une distinction entre le Rivage d’en haut
(vers la Roche et la Trappe) et le Rivage d’en bas (vers le passage d’eau et
jusqu’au Jonckay). Le Logis, quelque peu en aval du pont, était une auberge
très fréquentée par le monde du batelage. On y logeait ‘à pied et à cheval’ et
sa grande salle du rez-de-chaussée abritait souvent bon nombre de naiveurs et
de ch’volls ou loueurs de chevaux ainsi que des haleurs et des haleuses, gens
faisant profession de haler les bateaux. L’établissement possédait de vastes
écuries et les naiveurs pouvaient y trouver des chevaux de louage.
Le décor du café de Wagener
Avec le canal, vers 1850, le Rivage fut séparé
de l’agglomération. On y avait accès par la rue de la Chéra, la rue du Prince,
la ruelle Chefneux, la rue Graway, la ruelle Dosquet, la ruelle Fagard, la rue
de la Trappe, la rue Léonard Jehotte, une ruelle dépendant de la rue de la
Roche.
L’appellation ‘Rivage’ se déporte sur les
rives et les écluses du canal. Le quartier reste bien vivant, avec l’amarrage
des bateaux-mouche et des cafés qui fournissaient toutes sortes de services
pendant les éclusages.
En 1838 le charbonnage de Bonne-Espérance qui
venait de s’établir à La Chéra avait installé sur la Meuse en Rivage deux
bascules pour le déversement de ses charbons dans les bateaux. Avec le canal,
le charbonnage installe un port de chargement mais installe un pont tournant
privé avec chemin de fer à voie étroite permettant à ses trains de wagonnets
d’accéder aux bascules. Ces bascules furent supprimées en 1870 et en 1890.
En 1884 s’ajoute le double pont au-dessus de ce canal. Le passage d’eau –à câble noyé – était
toujours là, reporté à quelques 100 mètres en aval, avec une voie d’accès pour
charrettes. Ensuite le passage d’eau fut
muni d’un bac (une bâche) pour le passage des véhicules et renforcé d’un câble
aérien.
Le décor du café de Wagener, c’est ça.
Vers 1930 une autre partie du quartier du
Rivage disparaît avec le creusement du
canal Albert, y compris probablement le café de notre tribun. Ceci dit, le
quartier a des beaux restes qui justifient largement une balade. La rue Chéra
va néanmoins disparaître bientôt pour la construction d’une bretelle pour le pont, qui doit permettre au trafic
venant du pont de reprendre le boulevard urbain qui sera mis en double sens. On
espère ainsi décharger la rue Crucifix qui sera réservé à la desserte locale.
Une fresque sur la culée du pont de Wandre ?
En-dessous de la culée du troisième pont de
Wandre un bunker, vestige du ‘système des
Régions Fortifiées Permanentes’ (PFL) de l’entre-deux-guerres. En 1927 une
commission décide de re-fortifier la Meuse et le futur canal, pour obliger
l’ennemi à passer par la Hollande. En 1940, il est effectivement passé par
Eben-Emael qui d’ailleurs n’a pas tiré un coup de canon. Mais la PFL n’avait
même plus ses mitrailleuses, installées, lors du creusement du canal, dans
toutes les culées des nouveaux ponts (comme celui de Wandre). En 1939 la
Défense Nationale se rendit compte que le IIIe Corps d’Armée, occupant la PFL,
ne disposait ni d’effectifs suffisamment nombreux, ni d’assez de mitrailleuses
pour garnir cette ligne de front de 179 abris se développant sur 60 Km. On
décide alors de ne pas l’occuper.
L’entrée de l’abri n’est évidemment pas par le
chemin de halage: elle exposerait les occupants aux coups de l’ennemi. Elle se
trouve dans le mur de soutènement de la rue du Prince. Alors, l’abri pourrait
peut-être servir de passage aux cyclistes et piétons, pour rejoindre le
centre-ville depuis le Ravel ? Je rêve aussi de réaliser une peinture murale sur
cette culée, en évoquant Wagener, le quartier du Rivage disparu, et les
silhouettes de la statue de Gillon en bas du nouveau pont de Wandre.
Place Licour
L’école technique provinciale que nous voyons sur notre droite est à
l’emplacement de la brasserie Nève-Delame démolie en 1921. Peut-être là où
Wagener allait chercher ses fûts de bière …
Nous ne saurions plus prendre la petite rue de
la Trappe qui remontait en pente raide vers la Licourt. Déjà en 1850 les eaux
du canal ont recouvert une grande partie de l’ancien cimetière. Quant à la
morgue par contre, l’administration communale protestait contre « le
désagrément de recevoir – et les frais pour l’inhumation- des nombreux cadavres
retirés des eaux de la Meuse et du canal : « Notre position nous
cause le plus grand nombre de cadavres des malheureux qui tombent dans les eaux
par accident ou s’y jettent volontairement. C’est ainsi que du 1er
janvier au 31 août 1852 17 cadavres ont et retirés de la Meuse et du canal,
dont 13 sont restés inconnus (rapport communal de 1853).
Nous traversons la place pour prendre la
ruelle du Vieux Moulin, le neuvième alimenté par le Rieu des Mollins ou le Rida.
Nous longeons le Boulevard Albert Ier
par la bande de trafic local pour déboucher dans la rue de la Roche. Le pont
tournant N°3 se trouvait en face de la rue des Gris (aujourd’hui le rue R. Heintz : le pont n°4, était un pont-levis
en tête d’écluse).
Nous voilà au bout du hameau du Rivage. Quelque
part, probablement près d’une de ces deux écluses, le café de Wagener. Ce
n’était pas le café « Aux Quinze » qui faisait face au pont n°3 :
il logeait en 1869 la local du parti des bleus, d’obédience libérale, opposé à
d’autres libéraux, les rouges, qui administrait la commune. Ne vous fiez jamais
aux couleurs : ces bleus et rouges sont deux fractions rivales que l’on
retrouve encore aujourd’hui partout en Basse Meuse. Ces ‘rouges’ perdront après 1886 la majorité au Parti Ouvrier Belge.
Retour par le Ravel
Nous rejoignons notre point de départ par le
Ravel-Canal. Pour cela il faut traverser une nouvelle fois le boulevard urbain,
cette demie autoroute qui sera bientôt à deux sens tout le long, avec la réouverture
de la bretelle d’accès de l’échangeur n°35 vers Aix-la-Chapelle. Les experts du
Plan Communal de Mobilité Herstal ont mesuré en 2009 sur les boulevards 10.000 voitures/jour
dans chaque sens. Le PCM préconisait de profiter du réaménagement des
boulevards « pour y sécuriser les
traversées et relier Herstal-centre au RAVeL Les rond-point à la plupart des
carrefours avec les pénétrantes dans Herstal doivent présenter une branche au
gabarit cycliste vers le bord du canal.». Rien de nouveau sous le
soleil ? L’ancien canal était « bordé
de superbes ormes opulents qui invitaient aussi bien à la promenade pédestre
qu’aux randonnées cyclistes. Dès sa construction, 3420 ormes furent plantés le
long des berges, tandis qu’une deuxième plantation de 3950 arbres s’effectua
encore en 1853. De plus, une vois cyclable et un chemin de halage suivaient
fidèlement tout son tracé ».
Le long du canal nous avons l’île Monsin, Trilogiport
avant la lettre. On ne verra plus passer sur la ‘route du feu’, ou plutôt la route de la
fonte, les wagons thermos de l’Espérance-Longdoz qui amenaient la fonte des haut-fourneaux de Seraing vers se nouvelle aciérie et train à larges construite en 1963. Il y aura peut-être des trains chinois de la route de la soie du 21ième
siècle…
Le trou des chiens
A hauteur de l’église, en-dessous du boulevard
(et de l’ancien canal), à l’extrémité sud-est du cimetière, se trouvait la
partie réservée à l’inhumation des gens décédés en dehors du culte catholique.
Selon Pierre Baré, « les fanatiques
et les intolérants désignaient cette partie non bénite trou des chiens ou
encore coin maudit ou coin des réprouvés. Elle était séparé de la partie bénite
par un fossé, et restait tout à fait négligé : on y laissait croître
librement hauts herbages et orties. Bien que la loi du 23 prairial de l’an XIII
eut interdit dans les cimetières toute division non justifiée par l’existence
dans une ville de plusieurs cultes reconnus, le trou des chiens persista à
Herstal jusqu’environ 1880 ».
Notre cafetier Wagener n’a pas été enterré là.
J’ai retrouvé sa tombe dans le livre « dernier
domicile connu » : la parcelle 90/30-1 à Robermont. L’un de ces
jours, je vais le saluer là. Quant à retrouver une photo, il faudra fouiller
les archives de la justice: Wagener reçut d’abord six mois de prison pour bris
de clôture, et la Cour d’assises le condamna ultérieurement à cinq ans de
réclusion pour excitation au pillage. Pour lui, la règle « non bis in idem » ne
comptait pas… On peut néanmoins se faire une idée via cette description dans le
Bulletin de notre musée : il était « de petite taille et de corpulence
assez forte, avec sa grande barbe blond-châtain et coiffé d’un grand chapeau
mou à larges bords retombant sur ses yeux, muni de son drapeau rouge ».
Et si nous n’avons pas retrouvé son café, il y
a au 12ième de ligne le Camaron. Le patron José Cruz – fraichement pensionné – a pris en 2015 la
tête de la révolte des cafetiers de Herstal contre un autre couvre-feu pour les
cafés. Le nom du café réfère à Camarón de la Isla, chanteur de flamenco. En
1992,
100.000 de personnes assistent à son enterrement. En 2006, la Poste espagnole lui a consacré un
timbre commémoratif. Ecoutez-moi
ceci https://www.youtube.com/watch?v=1LO0ac6ynGs
Sources
Voir aussi mon blog sur la deuxième partie de la balade:
du Rivage à l’expo ‘Vive la Commune’ à l’Espace Hayeneux
https://hachhachhh.blogspot.com/2021/04/dans-les-pas-deduard-wagener-cafetier.htmlPierre Baré Herstal en cartes postales tI
Le
BULLETIN N° 194 DES AMIS DU MUSEE HERSTALIEN fait le récit de la
tourmente de 1886 à Herstal. Ce texte est basé – entre autres – sur le rapport
du bourgmestre de Herstal « sur les grèves du mois de mai dernier présenté en
séance publique du Conseil Communal de Herstal du 3 mai 1886 », déjà repris
dans le N°24 du « Musée Herstalien », ainsi que sur un livre de 1969 de René
Van Santbergen, « Une bourrasque sociale Liège 1886 ».
deux publications, Le Herstalien Wagener, cafetier au Rivage à Herstal, http://hachhachhh.blogspot.com/2012/05/un-herstalien-edouard-wagener-au-cur-de.html
http://hachhachhh.blogspot.com/2013/11/la-revolte-de-1886-herstal.html
avec extraits du‘Rapport au Conseil Communal’
du bourgmestre libéral d’alors Hypolite Grégoire (1882 – 1895). Une
antenne herstalienne du Parti ouvrier belge (POB), fut fondée le 8 juin 1886.
Il faudra néanmoins attendre 1896 pour avoir comme échevin ff. Bourgmestre un
des fondateurs de cette section herstalienne du POB.
Compte rendu très complet des Assises dans La
Meuse 11 août 1886 https://anarchiv.wordpress.com/2019/05/25/wagener-et-rutters-emeutiers-anarchistes-de-liege-aux-assises-9-aout-1886/
et
« La Commune de Paris a 140 ans, elle n’est
pas morte !? » par Micheline Zanatta, Présidente de l’IHOES Analyse n°80 – 12
octobre 2011 http://www.ihoes.be/PDF/Analyse_80_Commune_de_Paris.pdf
balade de la Place Saint Lambert au « Café
national » place Delcour, dans les pas des manifestants du 18 mars 1886.
https://hachhachhh.blogspot.com/2021/03/de-la-place-saint-lambert-au-cafe.html
https://www.facebook.com/Vive-la-Commune-Vive-la-Sociale-104025354991849/
https://unionisme.be/VAN_KALKEN_Les_emeutes_de_1886.htm
« Commotions populaires en Belgique (1834-1902) », par F. VAN KALKEN
(Bruxelles, 1936)
En mars 2016
Jonathan Lefèvre publie dans ‘Solidaire’ un article « 1886, première
grande révolte ouvrière en Belgique ». https://www.solidaire.org/articles/1886-premiere-grande-revolte-ouvriere-en-belgique
https://www.facebook.com/Vive-la-Commune-Vive-la-Sociale-104025354991849/
https://www.solidaire.org/articles/livre-la-commune-par-louise-michel
Extrait: En 1871, la Commune de Paris, véritable insurrection populaire, prend
le pouvoir dans la capitale française, il s’agit d’une des plus radicales et
abouties expériences révolutionnaires du 19e siècle. L’événement a notamment
beaucoup intéressé Karl Marx, qui a écrit à ce sujet La guerre civile en
France.