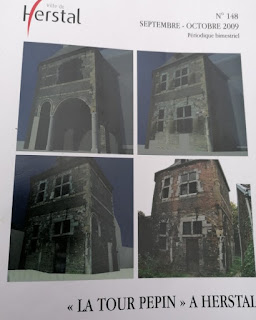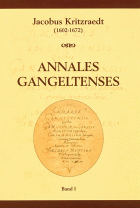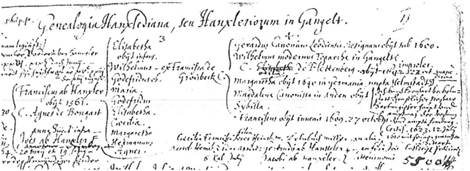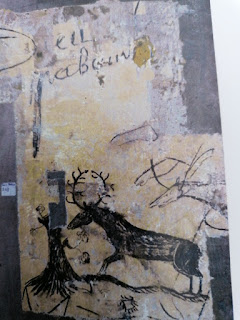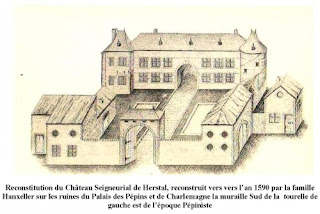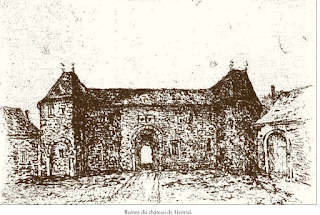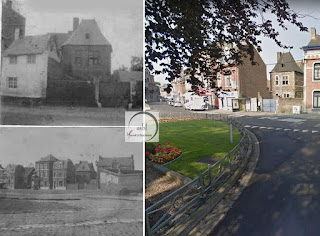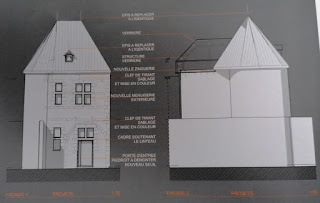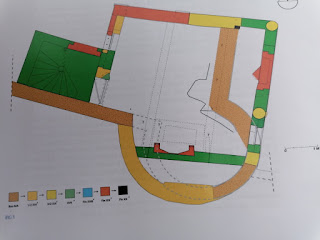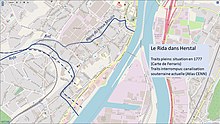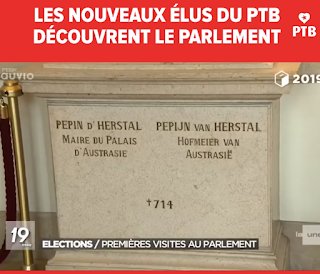Le château et les traces laissées par la famille Hanxheller à Herstal
Cette année, si tout va bien, Herstal achètera
ce qui reste du château des Hanxheller, sur la Licourt. J’ai décrit
l’historique dans un autre blog, en me basant sur un petit livre « La seigneurie de Herstal sous les Hanxeller
1558-1604 », de notre historien local André Collart. Ce demi-siècle sous les Hanxheller est
passionnante. Face aux Hanxheller il y avait les Princes d’Orange (aujourd’hui la famille royale hollandaise
porte toujours le titre de Seigneur de Herstal). Vers 1558
ce Prince, à court d’argent, met en gage sa seigneurie auprès d’un chevalier
allemand, François Hanxheller, qui s’installe dans une ancienne maison à La
Licourt. François décède deux ans plus tard. Un peu plus tard, Guillaume
d’Orange se tourne vers les protestants, et le duc d’Albe confisque tous ses
biens. La situation avec sa Seigneurie gagée auprès des Hanxheller arrangeait
très bien le Prince. La veuve Hanxheller et ses fils s’installent solidement à
Herstal, et construisent en étapes successives un château.
Lorsque vers 1595 le fils de Guillaume
d’Orange veut récupérer sa Seigneurie, une autre affaire surgit. Un demi-siècle
plus tôt, Charles Quint avait proposé au Prince-Evêque d’échanger Herstal
contre Marienbourg, dans le dos du Prince d’Orange qui détenait la Seigneurie,
et qui était encore mineur. Le
Prince-Evêque tient à cet échange, mais refuse évidemment à lever l’hypothèque de
26.000 florins due à la famille Hanxheller. Cette affaire trouve son aboutissement
en 1604 seulement.
Dans ce blog-ci nous suivons tes traces que
cette famille a laissées à Herstal. Vers 1605 les Hanxheller sont finalement dépossédés
de leur Seigneurie, mais restaient propriétaire de leur domaine de la Licourt.
Agnès, petite fille de François, avait marié un noble hollandais, et vend en 1658 le château à
un négociant d’Amsterdam. Exeunt les Hanxheller. Le manoir connaît alors une
histoire mouvementée, et mal documenté. Vers 1800 ce qu’on appelle alors la Vieille
Cour est dans les mains de Gilles Olivier, qui le lègue en 1814 à sa fille Anne-Cathérine
Olivier, épouse de Jean-Henri Courard et
ensuite à Jean-Michel Courard. Son petit-fils du même nom détruit le manoir en
1854 pour la construction de sa maison. Il ne laisse que la tour.
Nous retrouvons encore le château sur une
gravure des ‘Délices du pays de Liège’de
Remacle Le Loup. En 1883, un aquafortiste reprend «une
ruine très intéressante, qu’il a dessinée il y a 25 ans : le vieux château
sur la place Delcour a disparu depuis pour faire place à une construction
moderne ». Cette construction moderne est la maison que J-M Courard
construite sur les ruines du vieux château.
Sur la façade de la tour une pierre
rectangulaire porte les armoiries des Hanxheller. La pierre tombale recouvrant
la sépulture de la veuve de François Hanxheller, dans l’église de la Licourt, a
été vendu par le curé en 1872. En 1927
André Collart a encore repéré cette pierre à Hermée, à Grand-Aaz. Un cénotaphe
portant les blasons Hanxeler-Spies, provenant de l’église, se trouvait en 1927
au Musée d’Archéologie Liège. Celui-là,
on devrait pouvoir le retrouver.
Les armoiries
Les Hanxleden ont laissé leurs armoiries sur la tour et sur la pierre tombale d’Agnès, veuve de
François. « Franz von Hanxler/Hansseler, Herr der
Freiherrlichkeit zu Herstal und Amtmann zu Millen » porte dans ses armoiries un ancre mural (vous avez déjà remarqué qu’à l’époque on n’était pas très regardant sur
l’orthographe des noms. Ce que je ne ferai pas non plus, en fonction du
document qui les mentionne). Cet ancre, deux C
adossées et liées ensemble par des traverses, s’appelle en héraldique une anille.
L’agrafe qui servait à éviter l’écartement des murs, est associé plus tard à l’’anneau
en fer qui soutient la meule supérieure d’un moulin. Cet emblème était attribué
seulement aux seigneurs haut-justiciers qui avaient droit de moulin banal, où les
sujets étaient obligés de porter leur blé à ce moulin. Pour le chroniqueur
liégeois Jacques de Hemricourt les fers de moulin étaient jadis les marques qui
indiquaient une condition illustre. En 1641 ce blason
inspire un poème à l’auteur des Annales du village natal des Hanxheller.
« Il n’y a pas de bouclier qui exprime
mieux la sagesse.
Il y a des serpents dorés? La sagesse est toute
d’or lorsqu’elle reste constante.
Les serpents sont-ils entrelacés?
C’est la vraie intelligence sage liée par les
liens de la sérénité !
La
connexion est triple?
Telle est la sagesse: personne ne peut briser
une triple alliance.
Les
têtes sont-elles libres?
Si la prudence ne tourne pas la tête dans tous
les sens, elle se laissera surprendre.
Les serpents au milieu? La sagesse nait au
milieu du cerveau, d’où surgit la vertu munie de têtes ».
C’est cette anille gringolée
(terminée en têtes d’animaux) de François que nous retrouvons sur la colonne en angle droit
de la façade à rue de la tour de la Licourt. A gauche nous avons le chevron de son épouse Agnès. Ce chevron de gueules, accompagné de trois étoiles du même,
sur un fond d’argent, se retrouve chez petite-fille, une Agnès aussi. Les Van den Bogaert sont repris dans la bible de l’armorial d’Europe par J.B.Rietstap aussi
connu sous le nom « d ‘Armorial
général contenant la description des armories des familles nobles et
patriciennes de l’Europe ».
L’édition de 1861 reprend
ce chevron d’argent des Van den Bogaert ! (Pour la petite histoire, la dernière édition
du Rietstap a été édité à Berlin en 1937, or que la Constitution allemande de Weimar
de 1919 avait aboli les titres de noblesse, et interdit la création de titres
conférant l’apparence d’une origine nobiliaire, afin de garantir l’égalité de
tous les citoyens. Les nazis ont aboli Weimar ce qui explique que le Rietstap a
pu connaître une nouvelle édition en 1937).
Les Annales Gangeltenses
Voilà pour les armoiries burinées dans la
pierre de la tour. Il y a ensuite les parchemins des Annales Gangeltenses.
Trois siècles avant André Collart, vers 1640, le Jésuite Jacobus Kritzraedt écrit
le Stadtbuch Gangelt. Cette histoire du bourg de Gangelt est dédiée à Wilhelm
von Hanxler. Il commence ensuite les Annales Gangeltenses, en latin, là aussi
dédiées à Wilhelmus ab Hanxleden. Kritzraedt
n’a jamais trouvé d’imprimeur. «Ce qui m’a incité le plus souvent à jeter
plume et papier, c’est quand je pensais que ce que j’ai laborieusement
rassemblé ici ne serait jamais lu par personne », écrit-il à la fin de
son manuscrit. Or, en 2002, le Kreismuseum Heinsberg a
réédité ses Annales, dans le cadre
de la célébration de son 400e anniversaire. Il faudra qu’un jour je passe par
là. Le bourg de Gangelt est à cheval entre l’Allemagne et la Hollande. Un
cheval qu’on a même coupé en deux : le château est d’un côté de la
frontière et le village de l’autre.
Et comble de bonheur
posthume, les Annales sont sur internet, via la Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. L’intérêt pour la littérature en
néerlandais sont les passages en nederdiets (bas allemand). Comme ceci : “dat casteel van Herstall op de Mase tuschen
Ludich en Mastricht was dat hooff ende casteel van Brabant en hoort noch toe
den hertoge”.
Kritzraedt était né le
1 mai 1602 à Gangelt, où son père était bourgmestre. Devenu jésuite, il
s’installe dans son village natal, qui avait comme Seigneur Guillaume
Hanxheller. Kritzraedt y sauve les archives paroissiales qui étaient dans un
été lamentable. Il a aussi accès aux archives privées de la famille Hanxler. Il
avait partout des correspondants dont un historien réputé du diocèse de Liège –Jésuite
comme lui – Bartholomeus Fisen.
Le musée de Heinsberg a
traduit les parties en latin. Un liégeois, l’abbé André Deblon des Archives
diocésaines, a aidé à déchiffrer certains passages difficiles à lire. Il y
avait pas mal à déchiffrer d’ailleurs. Kritzraedt dessine aussi par exemple les
armoiries dans l’église paroissiale de Gangelt avec des légendes et des indications
de couleur. Mais le plus grand problème posaient ses notes dans la marge en
petits caractères minuscules. Et quand il n’avait plus de place, il diminuait
encore la taille de la police et utilisait
des abréviations.
Il y avait aussi des
notes – généralement des années – dans la marge intérieure. Ceux-là ont été
reprises entre crochets dans le texte. Mais les autres notes gribouillées ont été converties en notes de bas de page, sauf
lorsque ces notes n’ont pas pu être liées à un passage. Dans l’édition digitale
ces notes se retrouvent sur une autre page, ce qui rend la lecture difficile.
Domini de Herstal.
Tous les seigneurs de
Herstal, y compris les Hanxheller, on essayé de ‘prouver’ leur descendance avec
Charlemagne, à partir de Pepin. C’est pourquoi aujourd’hui encore la
dénomination ‘Tour Pépin’ a remplacé le nom de château de Hanxheller. Notre
jésuite aussi reprend dans ses annales les seigneurs de Herstal à partir
de 685, avec Pipinus Herstallus (Ansegisi Maioris Domus Franciae filius,
proavus Caroli Magni). Il nous apprend que Charles Martel était un fils
illégitime (722 Carolus Martellus Pipini
filius illegitimus. 1000 Anno circiter pertinuit ad Godefridum ducem Lotharingiae ;
Godefridus de Lovanio dominus Herstalli sub annum 1200 ; Joannes a Lovanio
qui olim fuit dominus Lovanii Herstalli et Gasbeque obiit 6 aug. 1324).
Puis il
switche vers l’allemand:“1458, Johann,
Graf von Nassau, nimmt als Lehen die hohen, mittleren und niederen Herrschaftsrechte
von Herstal an”.
Selon Kritzraedt,
les Hanxlers auraient reçu la seigneurie de leur oncle le Prince-Evêque de
Groesbeek en 1570 (Die Hanxlers scheinen
von ihrem Onkel von Grosbeck, dem Bischof von Lüttich, um 1570 mit dieser Herrlichkeit
belehnt worden zu sein).
En 1561, le recteur de l’école de Heinsberg écrit
l’épitaphe pour le sarcophage devant le maître-autel de Gangelt : « Le noble Junker Franz von Hanxleden,
espoir de sa famille, a trépassé dans la fleur de l’âge par le tuberculose au
château de Gangelt. Il fut enterré dans la tombe de ses ancêtres dans le chœur
de l’église ».
La même année 1561, « le noble écuyer Wilhelm von Hanxleden,
chef de famille, Seigneur de Herstal et chambellan du vénérable et distingué
prince Ernst, archevêque et électeur de Cologne et évêque de Liège, acheta par
zèle pour l’Église romaine, de vieux livres catholiques in-folio, comme
souvenir éternel de sa famille, afin qu’il n’y ait aucun danger d’hérésie dans
la région ».
C’est une anecdote, mais
j’apprends aussi dans cette chronologie qu’en juillet 1374, un rassemblement de
danseurs qui voulait tuer tous les chanoines de Liège a été battu et dispersé
dans le village de Herstal, à un demi-mille de
Liège. (‘Tänzer’, die alle
Kanoniker zu Lüttich umzubringen planten, im kaum eine halbe Meile von Lüttich
entfernten Dorf Herstal unterdrückt und zerstreut worden’). Kritzraedt a
trouvé ça chez Chapeauville (T3, chap. 9).
Le logis seigneurial dépossédé de son riche mobilier en 1675
Les Hanxheller avaient été dépossédés de la
Seigneurie vers 1604, mais restaient propriétaire de leur manoir. La petite-fille
de François, Agnès Hanxheller avait marié un noble hollandais, et n’habitait
plus là. Un acte du 3/12/1657 nous montre la maison Hanxeler occupé par un certain
Jean Bols. L’année après elle vend
le château à un négociant d’Amsterdam. Apparemment celui-ci
fait une très mauvaise affaire puisque seize ans plus tard, lors du siège de
Maestricht par Louis XIV, l’immeuble sert de caserne pour les armées de passage.
Lorsqu’en 2009 le département de restauration de peintures de
Saint-Luc a sondé
les enduits muraux, on a découvert certains dessins qui « s’apparentent à une caricature brossée avec grande économie de
traits, maladroits et brouillons ». Faits par les soldats ? Les graffiti
n’ont pas été inventés aujourd’hui !
Dans sa « Seigneurie de Herstal »,
André Collart renonce « à suivre les
destinées de l’immeuble aux siècles suivants. Il devient d’ailleurs de moins en
moins intéressant car le logis seigneurial avait été dépossédé de son riche
mobilier et dégarni de ses ornements de quelque valeur. Le 3 maye 1675 Wilhem
Ansillon cerarier de son arte déclare que peu avant l’arrivée de SEM le Compte
d’Estrades, gouverneur de Maestricht au mois de février 1674, il ait par ordre
du sieur Philippe Risach dépendu et osté de la maison que fut feu M. Hanxeller
les portes, verrières, fenestres et chassis de laditte maison et assisté à les
porter dans l’egliesse et maison du gendre dudit Resack et qu’auparavant on
avait aussy transporté de ladite maison les garde-robes, formes de lict,
peinture et tous autres meubles ».
Il nous apprend aussi qu’après une occupation
d’espèce et des dévastations, le manoir fut l’objet d’une expertise,
probablement en vue d’une indemnisation. «Laditte
maison a esté logé les ans 1672, 1673 et 1675 des garnisons provenant du Roy
très chrétien ».
Les Délices
Ceci dit, le château n’était pas à l’abandon
puisque vers 1740 Remacle Le Loup le reprend dans ses Délices du pays de Liège. Le modèle économique des Délices était en fait
celui de nos journaux publicitaires: les propriétaires étaient invités à mettre
la main à la poche, ce qui laisse supposer que le propriétaire avait des
moyens. Je n’ai pas réussi à retrouver la gravure, mais Remacle dessine ce
vieux château avec les autres constructions qui en dépendaient : « Il est situé au milieu d’un vaste enclos de
murailles qui renferment ensemble les bâtiments, les cours, les jardins et
plusieurs vergers. Quoique le château ne soit pas celui que le séjour de Pépin
a rendu illustre, sa construction fait connaître qu’il est ancien. Sa première
entrée est à l’occident ; de là, d’une première cour on aperçoit une
grosse tour carrée accompagnée de divers bâtiments irréguliers qui enferment
une seconde cour oblongue. Tout cet édifice est entouré d’un large fossé à fond
de cuve, traversé par un pont en pierre.».
La Vieille Cour vers 1800
Selon André Collart, soixante ans plus tard,
au début du 19ième siècle, le château était « en possession de Gilles Olivier, elle
comportait alors un corps de bâtiment appelé Vieille Cour, consistant en un
quartier de maître, un logement pour un fermier, deux cours, étables, écuries
etc. avec jardin et un petit bâtiment appelé la brasserie.
A sa
mort, le 27/6/1814, ses biens immeubles furent partagés entre ses
enfants dont Anne-Cathérine Olivier, épouse de Jean-Henri Courard (qui devient secrétaire
communal et second maire de ce nom) reçoit la propriété de la Licourt, et
Anne-Marie-Thérèse Olivier, épouse de Jean-Michel Courard, notaire (premier
maire de ce nom) obtint divers biens dont la maison ‘ditte delle jote’ ».
Nous parlons du premier maire de ce nom parce
que Napoléon a remplacé toutes ces vieilleries liées à la noblesse, comme la
seigneurie, par des maires avec au-dessus ses préfets. Courard a donc été maire
de 1802 à 1815. Il y a eu une petite interruption durant les Cent-Jours, pour
reprendre le mayorat de 1815 à sa mort en 1829. Une rue porte son nom.
Jean-Henri
Courard mourut le 21/7/1848 laissant 4 enfants dont Joseph, qui fut directeur
de charbonnage de Bonne Espérance, et Jean-Michel, avocat qui entra à la mort
de son père en possession de l’immeuble de la Licourt. Alors la propriété
seigneuriale des Hanxeller se trouvait ravalée au rang d’une maison de rapport,
délabrée, louée et sous-louée à une succession de ménages. Grandeur et
décadence !
En 1844, le ‘Guide du Voyageur sur la Meuse’ signale sur la place « dite Li Cour, les restes de l’ancien palais,
avec deux tours, de Pepin-le-Gros, à qui tous les histoires donnent le surnom
de Herstal, pour le distinguer de son aieul Pépin de Landen ». Les
Hanxheller sont oubliés…
En 1854
J-M Courard la fit démolir à peu près complètement pour la remplacer par la
jolie maison que nous y voyons. Le plan est de M. Cambier, élève de M. Delsaux,
architecte de grande valeur.
Après
J-M la propriété passa à son gendre Jean Vercheval qui la légua à son fils M.
Fernand Vercheval-Bury, l’occupant actuel.
Il faut croire que cette destruction se fait
dans l’indifférence générale. Mais la mémoire de la Révolution est encore
fraîche et le respect pour la noblesse se porte de plus en plus pour les capitaines
d’industrie pour qui ces châteaux et abbayes sont juste bon pour y installer
leurs industries naissantes.
Une gravure du manoir sur base d’un dessin de 1860
En 1883, Alexandre SCHAEPKENS, un lithographe
et aquafortiste formé aux académies d’Anvers et de Bruxelles, édite, sur le
modèle de Remacle Le Loup, des peintures romantiques de bâtiments et de
paysages de la région mosane. Il y reprend «une
ruine très intéressante, que nous avons dessinée il y a 25 ans : le vieux
château sur la place Delcour, à Herstal. Il a disparu depuis pour faire place à
une construction moderne. Notre croquis nous dispense d’une description de ces
précieux restes». La gravure du manoir n’est pas de la même qualité que le
reste du livre; peut-être parce qu’elle a été faite sur base d’un dessin
de 1860.
La pierre tombale dans l’église de la Licourt : vendue
Dans l’église de la Licourt se trouvait encore
la pierre tombale recouvrant la sépulture de Agnès Van den Bongaert. Le curé
l’a vendu en 1872, à l’occasion
d’ « embellissements »
(les parenthèses sont d’André Collart, qui a localisé en 1927 cette pierre à
Hermée, où elle servait de ponceau. Elle porte les blasons des Hanxeller et des
Bongaert. avec l’inscription : « Agnès
Van den Bogaert, veuve de François de Hanxler, seigneur et dame de la baronnie
de Herstal, âgée de 72 ans, est trépassée le 7 décembre 1595 ». Il y a
peut-être une petite chance que cette pierre a été sauvée lors de la
restauration du Moulin de la ferme du Château de Grand Aaz.
Dans cette même église était aussi un
cénotaphe portant les blasons Hanxeler-Spies avec leurs huit quartiers de
noblesse, et avec l’inscription « Noble
Seigneur Herman Hanxeler, Ecuyer, en mémoire de noble dame Cathérine de Spies
son épouse trépassée le 11 avril 1615 et ensépulturée au grand cœur de cette
église, en leur temps par engagère seigneur et dame de la baronnie de
Herstal ».
Ce cénotaphe se trouvait en 1927 au Musée d’Archéologie Liège. Celui-là, on
devrait pouvoir le retrouver.
2006 GP Consult
Ensuite, l’état de la tour n’arrête pas de se
dégrader. En 1948 Simenon évoque, dans ‘Pédigrée’, son grand-père Guillaume
Brüll, «habitant avec toute se famille
dans l’ancien château de Pépin de Herstal».Mais on sait que chez Simenon la
marge entre fiction et réalité est parfois floue, même dans une autobiographie.
Après avoir accueilli
des chambres pour héberger la nombreuse descendance d’un voisin, la tour a été
transformée en poulailler avant d’être à l’abandon.
Classé le 17 octobre 1962 par l’Institut du
Patrimoine wallon, elle est inscrite en 2002 sur la liste de l’Institut du
Patrimoine wallon pour trouver une solution à sa sauvegarde. Il y a une lueur
d’espoir en 2006, avec l’achat de la tour par GP Consult, une société qui se
prétend spécialiste dans la restauration
de monuments classés. Guy Paternotte aurait participé à la restauration de la
Collégiale St Martin, St Barth, la façade de l’ancien GB de Liège et la colonne
du Congrès. Il veut y aménager ses bureaux. Herstal propose même de participer
en adjoignant un éclairage.
L’évaluation archéologique
En 2007, la tour fait l’objet d’une évaluation
archéologique, dans le cadre d’une demande de certificat de patrimoine,
préalable à la réhabilitation en bureaux. Leurs conclusions déçoivent les
nostalgiques de Pépin : « Les
plus anciens vestiges mis à jour lors des sondages du sous-sol ne seraient pas
antérieurs à la fin du XVième siècle ou au début du XVIième. Durant la seconde
moitié du XVIième siècle, la construction est largement transformée : deux
niveaux y sont établis en ne conservant du volume turiforme qu’une portion de
440 cm de longueur sur son flanc sud ».
C’est dommage que nos archéologues n’ont pas
été gratter le mur d’une dépendance de la maison d’à côté où, selon André
Collart¸ jusqu’en 1905 une muraille était encore visible de la cour voisine :
« elle révélait une origine romane
bien caractérisée tant par les matériaux que par leur disposition. Un simple
coup d’œil attentif permettait de l’identifier à l’époque carlovingienne, ayant
donc appartenu au palais primitif. A ce titre elle était des plus intéressantes
et l’administration communale de l’époque (1906) avait visité les lieux.
Malheureusement son intervention se borna à cette visite et, peu après, elle
laissait bâtir tout contre une dépendance de la maison d’à côté. Par là-même,
le propriétaire acquit la mitoyenneté de cette intéressante muraille qui,
enduit de plâtras, perdit ses caractéristiques probants.
Ainsi
allèrent les choses : l’inconscience administrative laissait perdre un
précieux document historique ! »
Je ne crois pas trop à cette origine romane,
même si pour d’autres hypothèses comme les vestiges d’un pont romain André
était très scientifique. Et cette muraille est probablement toujours là. Rien
n’empêche d’aller vérifier.
Nos archéologues redécouvrent aussi « des armoiries gravées sur les tambours de la
colonne encastrée dans l’angle droit de la façade à rue, deux blasons qui symbolisent ce mariage. A dextre les armes masculines : une
anille (fer d’ancrage) gringolée (terminée en têtes d’animaux). A senestre les
armes féminines : un chevron. Les commanditaires de ces travaux seraient les
époux Hanxeller-van den Bogaert ».
Une autre ‘trouvaille’, une pierre
rectangulaire ornant une façade, se retrouve en photo – et en bien meilleur état
– dans la brochure de Collart sur les Hanxheller. La date sur cette pierre – 1597- remonte au décès de
Dame Agnes en décembre 1595, avec ouverture de son testament le 11/1/1596. Depuis ce décès Herman Hanxelaer est Seigneur
de Herstal.
Sur la pierre il y a deux blasons. A dextre
l’anille des Hanxeller, que nous connaissons déjà. A gauche (senestre) un lion
d’or couronné, à deux queues, tourné à gauche (lion du Palatinat ou du Brabant)
accompagné de cinq coquilles Saint-Jacques dorées. C’est les armoiries de Spies
de Büllesheim. Herman s’était marié en
1557 avec Catharina Spieß von Büllesheim. Les Annales Gangeltensi mentionnent Herman von Hanxler
comme “heer der freijer herligheit Herstall in 1596 und Catharina von Spies seine ehlige haußfraw ».
L’inscription en bas de la pierre ‘Courard 1854’ a été ajouté
ultérieurement. Le vandale a signé son œuvre !
Dégagement des enduits muraux de la tour
A l’occasion de l’étude archéologique, le département de restauration de peintures de Saint-Luc a sondé les enduits muraux, avec notamment au 1er
étage plusieurs dessins sur trois des quatre murs de la pièce. « Il y a une scène religieuse, une
scène fluviale, des symboles, monogrammes, inscriptions, représentation de
paysage urbanisé. Certains dessins s’apparentent à une caricature brossée avec
grande économie de traits, d’autres sont beaucoup plus précis et fouillés.
Enfin, certains sont maladroits et brouillons ». Une partie seulement de la surface murale a été mis à jour. Les Saint-lucistes
n’ont pas réussi à dater ces dessins. Et je n’ai pas l’impression que la
convention avec Saint-Luc a été reconduite pour mener à son terme cette étude.
Le projet de l’architecte Sonia Jost
En 2009 la tour est ouverte à l’occasion des
Journées du Patrimoine. L’architecte Sonia Jost, « auteur de projet pour GP Consult sprl » (selon linkedin) fait
un travail approfondi respectueux de son évolution complexe. Selon elle, la
superposition de 3 petits plateaux de 30 m2 ne permet pas la réhabilitation de
la tour en logement. Ca, on savait. Mais elle arrive à quelque chose de
cohérent, malgré les contraintes. C’est dommage qu’elle n’a pas eu connaissance
d’un détail très important pour
André Collart (H p.410): » tandis
que la côté extérieur décrit en saillie un arc de cercle très prononcé
atteignant presque la demi-circonférence, la face intérieure correspondante de
la tourelle est absolument plane. Il y a donc là un double mur avec un creux,
un segment vide. Pour tout contenu, il y a une grande quantité de briquaillons
et débris d’ardoises et de tuiles, provenant très probablement de réparations
de toitures. Agnès Van de Bogaerd, la
veuve Hanxeller, aurait donc, à la reconstruction, laissé exister le mir
primitif du palais sans l’utiliser pour la disposition intérieure de son
appartement. La voix populaire attribue généralement à Pépin de Herstal la
construction de cette tourelle ». Selon Sonia Jost, qui se base
probablement sur les fondations dégagées par les archéologues, il s’agit d’un
agrandissement du rayon d’une tourelle de la demeure de Hanxheller (cfr dessin). Je dis avec André Collart que c’est
un détail important que l’on pourrait encore éclaircir en vue d’une mise en
valeur.
2020 M. Paternostre rend son tablier
Sonia Jost fait donc des plans assez élaborés.
Fin 2013 il y a encore un retournement de situation dont je ne maîtrise pas les
tenants et aboutissants. Apparemment M. Paternostre voulait déjà abandonner son
projet de bureaux, puisque le budget communal 2014 prévoyait l’acquisition de
la tour Pépin.
Puis il ne se passe plus rien jusque début
2019, lorsque Paternostre prétend
relancer les travaux. Il met injustement le retard sur le compte des fouilles
archéologiques, alors que le rapport des fouilles a été publié vers 2010. «Je suis tombé sur cette tour qui m’a tapé
dans l’œil. L’ancienne propriétaire n’en faisait rien. Sa dernière occupation a
été un poulailler. Avant ça, des voisins qui avaient beaucoup d’enfants y avaient
aménagé des chambres. Je voulais y installer mon entreprise. Mais il a fallu
tellement de temps pour que le projet aboutisse que j’ai depuis remis mon
entreprise. Je vais néanmoins réaliser le projet et on verra bien qui
l’occupera » (source : La Meuse
5/2/2019).
Finalement, c’est fin 2020 qu’il annonce la
remise de sa société. Il est disposé à céder ce bâtiment à la Ville, pour au
moins 45.000 € afin de récupérer les différents frais qu’il a engagés. On peut
discuter sur la récupération de ces frais, pour un projet qui n’a pas abouti. Mais
cette somme correspond à l’estimation du Directeur-Président du Comité
d’Acquisition d’Immeubles. Et en partant du principe que celui qui n’estime pas
son histoire n’a pas d’avenir, cette valeur est incalculable. Encore faut-il savoir ce que l’on met dans
cette histoire. Si on y cherche des vestiges d’une tour Pépin qui n’a jamais
existé, on risque la déception. Si par contre on pourrait approfondir un peu
cette invraisemblable histoire du chevalier allemand Hanxheller, gagiste de
cette seigneurie de Herstal auprès du Prince d’Orange, cette tour est loin
d’avoir livré tous ses secrets.
Les Rieux
Il y a encore un dernier détail : la rue
Derrière les Rieux, créée par François Hanxheller. Mais où coulaient ces
rieux ? Les archéologues déduisent en 2009 de la carte de Ferraris de 1770
et de l’Atlas des chemins vicinaux de 1832 que «la partie circulaire au sud du château a pu flanquer un dispositif
d’accès lui-même bordé par un bras d’eau longeant le flanc méridional de la
propriété. Ce cheminement encore prégnant au XIXè siècle …est encore
perceptible à l’heure actuelle, au cœur de l’îlot. »
Ca vaudrait la peine de mettre en valeur ces
vestiges, puisqu’il s’agit d’un des nombreux bras d’un des deux ruisseaux qui
drainent Herstal : la Rida (le second est le Grimbérieux). Emilienne
Somers avance l’hypothèse que ce tronçon du Rida, entre la Voie de Liège et la
Large Voie, alimentait le vivier de la Ferme des Hospices (dont parle P.Baré),
puis alimentait le neuvième moulin, là où la rue du Chou s’élargit, et où il
reste une servitude très parlante entre Rue P. Janson et E.Tilman. Cet Oudon
Mollin a-il été un fouloir à draps, ce qui expliquerait le nom de Follerie
donné à l’endroit. Elle suppose qu’il longeait l’actuelle rue du Vieux Château
(Hanxeller !), qui s’appelait aussi ruelle Sauvage et est désignée comme «une vieille sale Rowalette» (dans un texte à propos d’une la tentative
de rachat par Hanxeiller ou sa veuve !). A partir de Derrière les
Rhieux, il y aurait eu 2 branches: une entre la propriété Mengels (l’actuelle
poterie) et Rissack (le sieur Philippe Risach qui en 1575 a « osté de la maison que fut feu M.
Hanxeller les portes et fenestres »). Cette branche a alimenté le
Moulin des Ecoliers (le no 10 ?) qui a donné son nom à la rue du Vieux Moulin. Une
autre branche, sans doute celle qui traversait la propriété Hanxheller,
alimentait le Moulin de la Trappe (le moulin N° 11 des cisterciennes de Vivegnis).
André Collart cite des actes de Herman Hanxeller qui acquiert de nouvelles
propriétés dont ‘certain cortil et jardin
extant près de bouchiron, d’aval à la rualle qui vat a Oudon Mollin et vers
Mouze a riwe des Mollins’
Lors du premier confinement un prof géographe
a commencé une belle page Wikipédia sur le Rida. La partie de Vottem jusqu’au
moulin Nozé est très bien documenté, mais les recherches sur la partie jusqu’au
Licour doivent être complétées. Emilienne, au travail ?
Pépin de Herstal tout craché
En guise de Post Scriptum encore un petit mot
sur Pépin. En 2005 les Editions Luc Pire ont sorti leur «Histoire du Belge (De
la nuit des temps à la Muette de Portici) ». Un ouvrage corrosif et
décapant, signé par Stéphane Baurins et André Clette, illustré par Jean-Claude
Salemi. Voici un petit extrait sur Pépin de Herstal. « Il eut un fils qui ressemblait à son père, c’était Pépin, tout
craché. On l’appela donc Charles. Moitié parce qu’il était fêlé, moitié parce
qu’il avait le bras long et lourd, le sobriquet évocateur de Martiaux lui fut
adjoint. On ne l’appela donc plus que Martiaux Charles, ou, plus
euphoniquement, lorsqu’on était sur écoute, Charles Martel. À cette époque,
pour un Charles-Martiaux qui rêve de prendre tout le pouvoir, la situation
internationale offre de belles opportunités; l’Islam est précisément saisi
d’une de ces fièvres exaltées, zélatrices et conquérantes qui saisissent
périodiquement les religions révélées, provoquant, chez les concurrentes tout
aussi révélées, une poussée proportionnelle de trouille verte, conseillère de
coliques pestilentielles.
Après
s’être donc mis Martel en tête, les Francs rencontrent les Arabes à Poitiers,
en octobre 732.
C’est le signal d’une belle boucherie arabe
et, pour Charles le Marteau, le début d’une ascension forgée certes à grands
coups de martiaux, mais surtout dans un alliage de ferveur des armes et de
haine religieuse dont la solidité – en matière d’escabiaux – ne s’est jamais
démentie.
Quant
aux rois mérovingiens, ils étaient tombés si bas qu’il ne fut même pas
nécessaire de les déposer.
Martiaux
Charles eut à sont tour un petit Pépin avant de mourir. Ce Pépin-là grandit et,
eu égard à la manière furtive et fugace dont il s’introduisait dans ses
multiples concubines, il fut vite appelé Pépin le Bref. C’est donc à la
surprise générale que le dit Pépin épousa Berthe le Grand Pied, dont le surnom
disait assez le tempérament extraverti.
De cette
union paradoxale naquit pourtant un bel enfant qui, selon toutes les
apparences, était de la graine de Pépin. Aussi l’appela-t-on Charles (L’Echo 19/7/2005).
Sources
Lien vers la première partie de mon blog sur
Hanxheller
https://hachhachhh.blogspot.com/2021/01/herstal-et-la-tour-hanxheller-dite-pepin.html
La seigneurie de
Herstal sous les Hanxeller. 1568-1604 / par André Collart. – Herstal : Alfred
Vool, 1923. – 64 p. La lecture de cette petite brochure n’est pas facile :
il recopie abondamment des notules de l’époque, dont des compte-rendus des
plaids un genre de conseil communal avant la lettre mais en ancien français,
d’une époque où il n’y avait pas encore d’orthographe normatif.
Collart-Sacré, La Libre seigneurie de Herstal,
éd. Thone, 1927 deux tomes
J.
Kritzraedt, Annales Gangeltenses, (ed.
A.M.P.P.Janssen). Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht /
Kreis Heinsberg, Heinsberg / Stichting Jacob Kritzraedt, Sittard 2005 https://dbnl.org/tekst/krit002anna02_01/krit002anna02_01.pdf
La Tour Pepin à Herstal, Bulletin du Musée
N°148 sept.-oct.2009 bilan archéologique des fouilles du Service de
l’Archéologie de la Province, avec l’analyse des blasons, des grafitis, et les
projets du propriétaire.
Bolle
C. & Léotard J.-M., 2010,
Herstal : résultats de l’évaluation archéologique de la
« Tour
Pépin », Chronique de l’Archéologie
wallonne, 17, p. 133-135.
Bolle
C., Léotard J.-M.,
Charlier J.-L. &Coura G., 2014. Herstal. La « Tour Pépin
». In : Bolle C.,
Coura G. & Léotard J.-M. (dir.), L’archéologie des bâtiments en
question. Un outil pour les connaître, les conserver et les restaurer. Actes du
colloque international, Liège, les 9 et 10 novembre 2010. Namur (Études et
Documents, Archéologie, 35), p. 340-343.
Henrard D., Léotard J.-M. & Marchal J.-
P., 2013. Herstal : fouille préventive à l’arrière du musée communal, Chronique
de l’Archéologie wallonne, 20, p. 179-181.
ALEXANDRE SCHAEPKENS, DESSINS & NOTES PRIS
DANS LE PAYS DE LIÈGE DU TEMPS PASSÉ – ANCIENNES HABITATIONS, CONSTRUCTIONS
CIVILES, MILITAIRES, RELIGIEUSES, ANCIENS CHÂTEAUX ET ANTIQUITÉS recueillis, dessinés
d’après nature et gravés avec texte historique, PREMIÈRE PARTIE 1883, illustré
de 123 eaux-fortes dont 32 imprimées à pleine page avec verso blanc. ENRICHI DE 16 DESSINS ORIGINAUX ou gravures
L’ archéologue et
héraldiste Paul Lohest de l’Institut archéologique liégeois a réuni une
importante documentation concernant les armoriaux anciens de la Principauté de
Liège Pp. 14 : Armoiries de Hanxeler, Van Den Bougart; Pp. 45 : Armoiries de
Hanxeler et Bongardt.
http://croasaintlucliege.blogspot.com/2009/05/chantier-de-la-tour-pepin.html