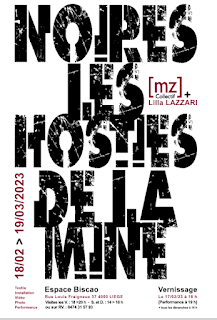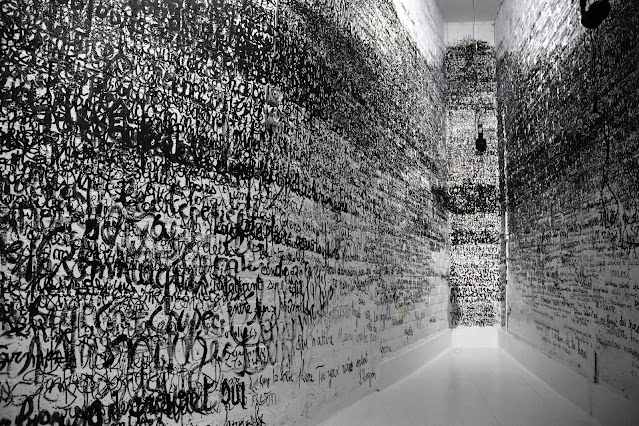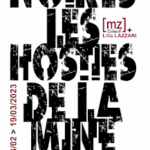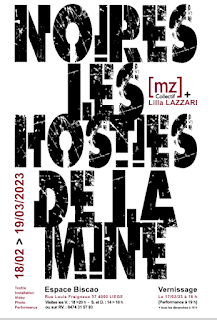73ième balade-santé MPLP : Le bois de Naimette et l’exposition «Noires les Hosties de la Mine»
 |
| photo frankyfix |
Lors de notre balade-santé MPLP du dimanche 12 mars nous avons parcouru le Bois Naimette, en
fait, un ancien terril à flanc de coteau.
A la fin de la balade nous avons été voir l’exposition «Noires les Hosties de la Mine» à l’Espace
BISCAO. Cette expo se veut « une plongée imaginaire dans les
entrailles mises à nu d’un des derniers témoins de notre passé industriel pour
observer et écouter ce que toute cette histoire accumulée a encore à nous
dire ». C’est le Collectif [mz] qui nous le dit. « Ils font
écho à un urgent besoin de prendre soin
de notre territoire, de le
respecter tel qu’il est, avec sa mémoire, son présent et son futur ». Du coup, notre balade se
doit de faire écho à ce passé minier. Le siège de Sainte-Marguerite
a fermé en 1965. Nous avons salué sa tombe en haut de l’espace Fontainebleau. Nous
sommes sur l’itinéraire pédestre de Cointe à Saint-Léonard, réalisée dans le
cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). Nous sommes aussi
sur le GR 579 qui va de Liège jusqu’à la cathédrale des
Saints-Michel-et-Gudule, à Bruxelles.
La tombe du charbonnage de Sainte Marguérite
Nous n’avons pas le
choix : pour arriver sur notre colline de
Naimette/Xhovémont inaccessible,
il faut traverser le nomansland de l’espace Fontainebleau,
avec sa voie rapide et son arrefour tentaculaire, traversées piétonnes et cyclables
particulièrement difficiles, paysage urbain dévasté, site Saint-Joseph et
parking Bas-Rhieux en attente d’une nouvelle vie. La tombe du charbonnage se
trouve de l’autre côté
du trou qui vaut le légendaire trou de la place Saint
Lambert. La houillère de Bonne-Fin remonte à 1759. Elle
a d’abord déversé ses stériles sur la colline de Naimette-Xhovémont. Lorsque le
siège se déplace à Sainte-Marguerite, au pied de la rue de Hesbaye, le
charbonnage installe un aérien qui sera prolongé plus tard jusqu’au terril des
Français au dessus de la rue Naniot.
Bonne-Fin rachète en 1840 le Bâneux, et 8 ans
plus tard l’Aumonier, à Sainte-Marguerite. En 1950, Bonne-Fin fusionne avec
Bonne Espérance (Herstal), Batterie et Violette (Chartreuse). Sainte-Marguerite
ferme en 1965.
Une fermeture où l’on a frôlé la catastrophe
Bonne Fin est un nom prémonitoire : quelques
semaines avant la fermeture on y a frôlé la catastrophe. Henri Delrée,directeur divisionnaire des Mines, raconte: «le Many devait fermer au mois de mai. On le prolongeait de semaine en
semaine et de mois en mois. Il allait fermer théoriquement fin 53 mais la
catastrophe est arrivée. A la Bonne fin, c’était plutôt des feux spontanés.
C’était des couches à feu. Cela a duré tout un temps. Il a fallu faire des
barrages. Ce qui a accéléré la fermeture du charbonnage ».
Le blogger Jean de la Marck nous raconte comment il accompagnait son oncle
Louis qui possédait une charrette à charbon au carreau du charbonnage. Son
oncle n’était pas marchand de charbon, mais il faisait des « chemins de charbons». Les mineurs recevaient un bon de 250 kg de
charbon par mois. À charge pour eux d’en effectuer le transport. Parfois ils
revendaient aussi les bons à son oncle. En entrant dans le charbonnage, on
conduisait la charrette sur la bascule pour le poids à vide. Puis on se
dirigeait vers les dépôts de charbons aux calibres 5/10, le 6/12, le 12/22, le
20/30. La charrette avait deux compartiments séparés par une planche. On
pouvait donc charger 250kgs de 5/10 « la gayette » et 250 kgs de 12/22.
Jean de la Marck raconte aussi comment, le 7 septembre 1944,
les allemands en déroute, firent exploser une chenillette de type « Goliath »,
bourrée d’explosifs, en plein milieu du carrefour, malgré le geste courageux de
Maurice Waha, qui au mépris de sa vie, tentait d’arrêter l’engin. Beaucoup de
personnes attendaient l’ouverture de la boulangerie afin d’obtenir un précieux
pain. De plus, c’était le changement de pause au charbonnage et de nombreux
mineurs se dirigeaient vers la sortie. On a dénombré plus d’une centaine de
morts ainsi qu’un nombre important de blessés.
De l’Ilôt Saint Joseph à l’Ilôt Légia
Lorsque le groupe CHC ferme l’hôpital de
Saint-Joseph au profit du Mont Légia, une rénovation urbaine est lancée pourFontainebleau. En attendant FEDASIL y a accueilli des réfugiés.
La Ville de Liège rachète la majorité des maisons
de l’îlot Légia, pour élargir la rue et recomposer les espaces publics en pied
de colline. Un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique est adopté
par le Conseil communal en septembre 2020. Cet élargissement doit réduire
l’emprise de la voie rapide, préalable indispensable à la reconnexion du
quartier à la colline. Le bureau d’urbanisme Baumans et Deffet étudie la
faisabilité urbanistique. Le Collège initie en 2022 un appel à projets pour la
reconstruction de l’îlot « Légia».
Vient s’ajouter le plan régional «
Infrastructures » 2020-2026 qui veut insérer un bus à haut niveau de service et
un itinéraire cyclable sur la N3, entre le Cadran et Burenville.
Matexi rachète l’hôpital et envisage une
démolition quasi complète de ces bâtiments imbriqués, construits par
ajouts successifs. Le promoteur demande un certificat d’urbanisme n°2 pour 240
logements. Chaque logement aura un espace extérieur (jardins privatifs,
terrasses) ou l’accès à des jardins partagés. Les circulations en surface dans
l’îlot seront piétonnes et cyclables. Matexi prévoit aussi quelques commerces
et bureaux ainsi qu’une fonction adaptée à la chapelle et au couvent
(coworking, restauration…).
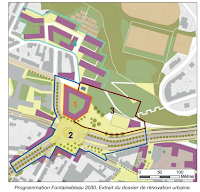 |
| Fontainebleau 2030 |
Le 12 février 2021 le Collège remet un
avis favorable. Mais la Ville prévoit déjà 650 logements parallèle à l’organisation
d’un axe fort pour le transport public et les modes doux.
A propos de mobilité, nous trouvons dans le
Salut Maurice N°77, la gazette de Sainte Marguérite, des réflexions intéressantes pour la reconversion
de la voie rapide: « faites-en un
parking. Cette voie rapide n’a plus aucun sens puisque le tram va bloquer
pratiquement tout trafic de transit sur la Place Saint Lambert. La mobilité
avec le tram rendra inintéressant ce trafic de transit qui jusqu’à maintenant
percole dans le quartier, et rend possible un plan qui décourage activement
tout ce trafic de transit. Maurice ne comprend pas très bien ce constat ‘qui
s’imposerait’ : « pour éviter une percolation dans les rues secondaires
du quartier, il faut conserver à cet axe Burenville-Cadran sa fonction de
voirie principale ». A moins de commencer dès maintenant des novènes pour
Sainte Julienne, cette voirie est condamnée par la configuration actuelle du
tram !
Cette
voirie était déjà une anomalie lors de sa conception : le rêve fou du
groupe l’Equerre (proche du PS, entre parenthèses) de traverser le cœur de la
ville avec une autoroute. Les travaux pour cette demie-autoroute n’ont pas
seulement laissé un trou de trente ans sur la Place Saint Lambert, mais coupé
en deux un des quartiers les plus vivants de la cité. Nous avons aujourd’hui
une chance unique pour recoudre cette cicatrice. Et pour cela, il faut, comme
disait Danton, de l’audace, de l’audace, de l’audace ».
Fin 2022, Matexi reçoit l’autorisation pour
démolir l’ancien hôpital à condition de verduriser la zone si, dans les six
mois qui suivent, la reconstruction n’a pas commencé, histoire de ne pas
laisser s’installer un chancre. La mixité sociale est une demande des autorités
communales et Matexi prévoit une petite vingtaine de maisons unifamiliales,
parfois avec cinq chambres.. Une nouvelle voirie va traverser le site du nord
au sud. Les autorisations pourraient être délivrées au printemps 2023, avant un
chantier qui devrait s’étaler sur trois ans.
Le patrimoine : l’hospice Saint-Charles Borromée et la
fontaine de la samaritaine
 |
| photo IPIC |
L’étude des incidences environnementales analyse
l’aspect patrimonial. La fabrique d’église voudrait conserver à la chapelle sa
vocation de culte, et de sauvegarder le home voisin qui forme avec elle un
ensemble architectural cohérent. Par contre, une belle bâtisse du dix-huitième,
en intérieur d’îlot, est condamnée, bien qu’elle soit digne d’intérêt : son
maintien aurait compromis la qualité de l’espace piéton prévu au centre des
futurs immeubles à appartements. C’est d’ailleurs là que devrait s’installer la
« Fontaine de la samaritaine » (Rtbf 25 nov. 2022).
Cette remarquable chapelle de style néo-gothique Rue de la Légia 7 est inscrite
comme monument. Les plans sont de l’architecte D. Joliet en 1883. Elle est
accolée à l’arrière de l’hospice Saint-Charles Borromée. Je cite l’Inventaire
du Patrimoine : « à l’étage,
tribune courant sur tout le pourtour de la nef et reposant sur des consoles de
fer forgé. Mobilier et décoration néo-gothiques formant un ensemble
exceptionnellement bien conservé : maître-autel, peintures murales (de A.
Tassin?), le vitrail, une composition abstraite de pavés de verre et un réseau
de béton, conçu par J.-M. Géron, dans la cafétéria de l’hôpital ». L’
hospice même, de style néo-classique, est de 1878.
La Ville de Liège « veillera au maintien de l’ancien couvent et de la chapelle, une
composante d’identité patrimoniale importante du site. Leur affectation à des
fonctions ouvertes au public, surtout au rez-de-chaussée, contribue d’autant
plus à la mise en valeur de leur singularité, et à leur appropriation par les
riverains et les visiteurs. Ainsi, l’organisation proposée valorise ces
éléments par la création de nouvelles perspectives dans les espaces qui seront
accessibles au public extérieur ».
Quant à appropriation par les riverains, la
CRU (Commission de rénovation urbaine) de Sainte-Marguerite, le Comité de
quartier et de nombreuses associations avancent fin 2022 une suggestion
intéressante. Comme la question de l’affectation de la chapelle reste en
suspens dans la demande de permis, la Commission avance la possibilité de
l’affecter en salle de quartier.
A part la fontaine et la chapelle, l’IPIC
reprend encore un intéressant bâtiment de style moderniste, Rue de la Légia 8
-12. Il s’agit des bureaux techniques de la société Bemat, construit vers 1935 d’après des plans de
l’ingénieur Victor Leclerc.
La Légia, un ruisseau fantôme
Via la rue de la Légia et la rue des Bas Rieux
nous montons la rue Toussaint Beaujean.
Le confluent de la Légia avec la Meuse est à la base de la ville de Liège. Mais
ne le cherchez pas : aujourd’hui le ruisseau est presque entièrement
couvert. Même sa source, au-dessus de la côte d’Ans, est en dessous d’un
bâtiment. On voit encore une résurgence en haut de la rue Coq Fontaine. Quant à
la fontaine de la rue Simon Dister elle est sur le tracé artificiel pour éviter
que ses eaux (presque propres) n’aboutissent pas dans une station d’épuration. La
partie à l’air libre, place Nicolaï, c’est en fait une reconstitution purement
symbolique, fonctionnant en circuit fermé.
La Légia aboutit à la rue du même nom via une
galerie de 2 800 mètres datant de 1697, pour alimenter le moulin Renson (d’où
rue des Moulins et plus bas la rue des Meuniers). Le mur de soutènement du
talus est constitué d’anciennes dalles qui recouvraient le ruisseau.
Cette galerie a été redécouverte en 2006, en aménageant
le vignoble des Coteaux d’Ans. La pelle mécanique a mis à jour le conduit de
curage voûté de Coqfontaine, les maxhais ou galeries et deux puits de 3 et 6
mètres de profondeur.
Si la Légia est un ruisseau fantôme la plupart
du temps, elle rappelle son existence de temps en temps par des crues remarquables,
comme en 1118, 1189, 1463, 1546, 1651, 1703, 1891, 1908, 1921, 1925… Un
important égout fut construit rue Saint-Séverin au début du XXième siècle,
mais, de nos jours encore, il n’est pas rare que le bas du quartier
Sainte-Marguerite et la place Saint-Lambert soient la proie des inondations. Je doute que la fontaine de la Samaritaine, contre le mur de clôture de la Rue
Sainte-Marguerite 208, réalisée en 1721 par le sculpteur Hallet, était
alimentée par la Légia. Quoique : le bas-relief représentant une femme
versant de l’eau, dans un décor de plantes et de rochers, est une allégorie de
la Cité de Liège. Le bac a été renouvelé après avoir été démoli
par un camion en 1963. La fontaine aussi est reprise à l’Inventaire du
Patrimoine immobilier culturel (IPIC).
Un Itinéraire pédestre à la découverte des espaces verts
Rue Toussaint Beaujean nous sommes sur un « Itinéraire pédestre à la découvertedes espaces verts, de Cointe à Saint-Léonard », une initiative réalisée dans le cadre du Plan
Communal de Développement de la Nature (PCDN ). Dans cet itinéraire Naimette-Xhovémont
est en zone de liaison.
A côté du n° 14 de nous montons le sentier qui
s’ouvre derrière la grille. Nous longeons une clairière de hêtres, marronniers,
tilleuls, érables sycomores ET un arbre à clous. Vous frottez le clou sur la
partie malade et vous le plantez dans ce hêtre exceptionnel, tant par sa taille
que par son allure. Si néanmoins pour l’une ou l’autre raison l’arbre
guérisseur ne prend pas le mal, consultez votre toubib.
Ce terril fut utilisé jusqu’en 1926. Nous
sommes +- sur le tracé du transporteur aérien qui servait à déverser les
résidus miniers à flanc de coteau (en pointillé, sur ce plan de 1930). Ensuite,
on prolongea le transporteur jusqu’au terril Saint Barbe. Ce transporteur a été
démantelé en 1959.
Nous sommes aussi sur un GR avec ses balises
rouge et blanc. À la sortie du couvert forestier, nous quittons le GR et prenons à gauche, vers la clôture du
stade provincial de Naimette-Xhovémont. Nous longeons celle-ci jusqu’au vieux
marronnier couvert de boursouflures, puis tournons à gauche pour rejoindre le
boulevard Léon Philippet.
En face de nous, le petit espace boisé entre
la rue Naniot, le boulevard Philippet et la rue des Neuves Brassines, restera
accessible au public. En 2021 le propriétaire des lieux avait voulu en
interdire l’accès. Une pétition des riverains avait été relayée au conseil
communal, par mon amie Sophie Lecron (PTB), entre autres. La Ville a décidé de
consacrer les sentiers qui le traversent en tant que servitudes publiques de
passage. L’un des chemins correspond au tracé d’un transporteur aérien.
Le parc Heuvelmans et le RUS Gold Star
A l’emplacement de l’école communale
Xhovémont-Philippet se trouvait entre les deux guerres un petit château et le parc Heuvelmans, avec
une grande pelouse en pente douce entourée de beaux arbres aux essences
différentes : frênes, hêtre pleureur, chênes, tilleul, ifs, houx, marronnier,
robinier, pommier, érables, ginkgo, séquoia. Le hêtre pleureur adossé au muret
d’enceinte de la cour de récréation est ce qui reste du parc. En 1944, une
compagnie d’infanterie de la célèbre division «big red one » y a dressé son
campement.
Sur notre gauche le quartier de ruelles pavées
et pentues qui recèle de superbes jardins privés est parfois appelé – à juste
titre – notre Montmartre liégeois. La Rue Xhovémont est une des plus anciennes artères de Liège La très ancienne rue pavée Naimette fort
raide fut déviée lors de l’aménagement
d’un terrain de rugby. Sa dernière partie est un chemin piéton, dans un petit
bois. La Rue Henri-Vieuxtemps était en 1923 encore une
impasse qui donnait sur la vieille ferme
L’ancienne rue pavée Isi Collin se
nomma tout d’abord la rue des Deux Marronniers (1940), le temps que les
autorités communales s’aperçoivent qu’il s’agissait en fait de deux
châtaigniers. Ce qui en fit la rue des deux Châtaigniers. Une souche est encore
présente aujourd’hui.
La Rue sans nom donnait accès au club de football la Royale
Union Sportive Gold Star Liège. C’était une rue privée jusqu’au début des
années 2000. Elle fut nommée rue de
l’Arbre Rouge en référence à un arbre mort passé au latex vermillon.
Je rends la parole à notre blogger M. Jean de la Marck. En 1946, quelques copains du quartier Sainte-Marguerite, mordus de football, créent
un club, avec un nom qui brille. Comme le « White Star » existait déjà, à
Bruxelles, ils optèrent pour « Gold Star ». Suite à un arrangement avec le
charbonnage, ils purent disposer du terril, qui devint au prix d’un nombre
incalculable d’heures de travail un joli terrain de football. Tout au bout d’une allée, longeant le terrain, on
aboutissait à la buvette au fronton de laquelle était écrit en lettres d’or «
Gold Star ».
Pendant
ce temps les « wagonnets » faisant toujours partie du décor défilaient vers le
terril. À la fin de la saison 52/53, l’US Liège, portant le matricule 40, est
expropriée de son terrain des « Bons Buveurs ». Elle fusionne avec le Gold
Star. Le terrain souffre le martyre tant il est utilisé : trois matches chaque
dimanche, deux le samedi, plus les entraînements chaque mercredi et vendredi :
l’herbe ne parvinet toujours pas à pousser, à croire que les hordes d’Attila
étaient passées par là. Hormis les quatre coins du terrain où il y avait un peu
d’herbe, le reste était noir charbon.
Le club est menacé d’expropriation suite au
projet pour un complexe sportif mégalomaniaque, avec piscine et patinoire
couverte aux dimensions olympiques, hôtel, hall omnisports et des terrains de
tennis, basket-ball, volley-ball, rugby, football et athlétisme. La montagne
accoucha d’une souris. Seule, une piste d’athlétisme fut construite sur le
terrain du Gold Star : le centre sportif actuel. Le petit club vert et blanc aménage, au
lieu dit de l’Arbre Rouge, trois terrains de foot. La RUSGS Liège aligne 14
équipes de jeunes, 19 avec les seniors. Le club put accéder deux ans de suite à
la Première provinciale et à la Promotion. Une montée trop rapide a eu raison
de notre petit club qui fidèle à sa tradition n’a pas voulu acquérir des
joueurs extérieurs au détriment de ses finances. Après une année au sein de
l’élite, il réintégra la Première provinciale. Actuellement, le club
évolue en troisième division provinciale.
Mine de rien, en février 2023 la Royale Union
sportive Gold Star Liège a battu le Football Académie d’Engis 15 à 0 un match
de Provinciale IV série C
Nous rejoignons le carrefour de Fontainebleau via
des escaliers se trouvant en face de la rue du Général Modard.
Voir aussi
http://hachhachhh.blogspot.com/2017/11/34ieme-balade-sante-mplp-naniot-sainte.html