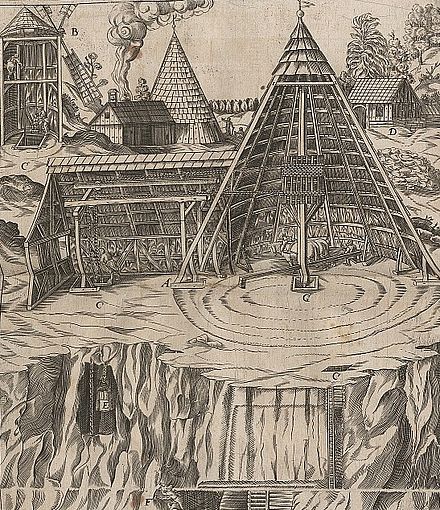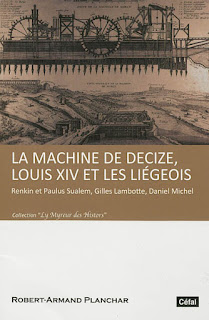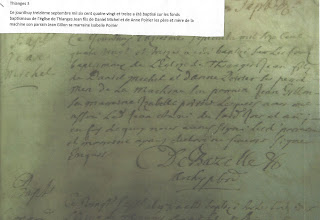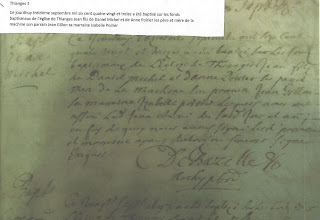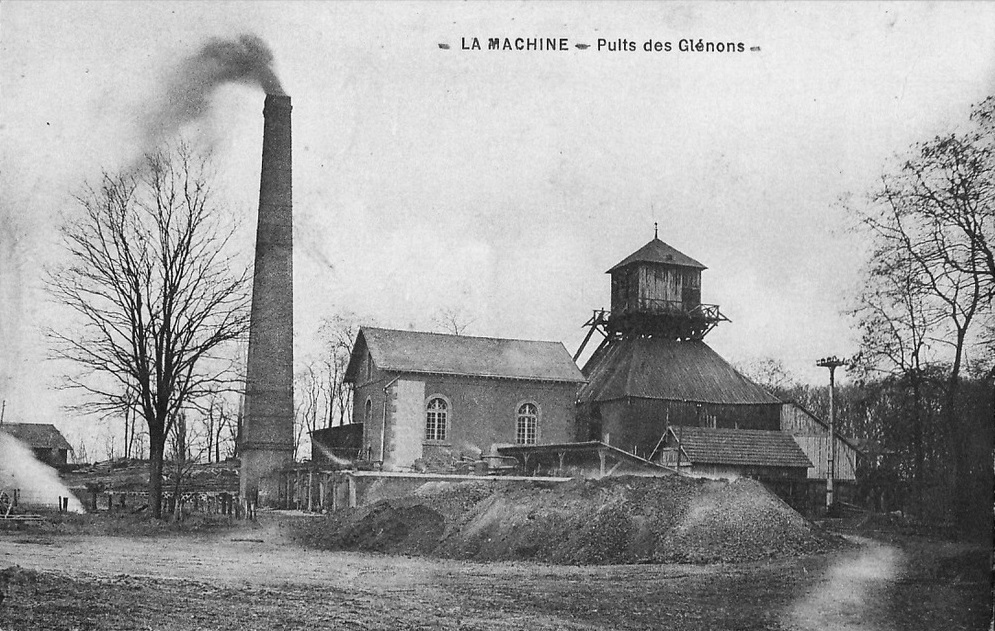Decize-La Machine : une machine liégeoise qui a donné son nom à la ville!
En 2019, quelqu’un
me suggère de contacter André Lavergne de la ville de La Machine, dans le
Nièvre. « La » Machine qui a donné son nom à la ville est un baritel
liégeois. DECAMPS écrit en 1889 dans
son « Mémoire historique sur l’industrie
houillère dans le bassin du Couchant de Mons » que «les
fosses plus importantes s’équipent d’un baritel (manège à chevaux ou herna)
doté d’un tambour vertical. Ce dispositif est une esquisse des châssis à
molette ».
En 1689 le
liégeois Daniel Michel installe donc un baritel-hernaz-harnais pour exhaurer la
mine de Decize. La ville qui se développe tout autour prend le nom de LA
Machine, aujourd’hui une commune de 4.000 habitants; une rue Daniel Michel y
commémore notre charpentier.
L’épouse
d’Andre, Paulette Godard, a été maire PCF de La Machine de 1989 à 1995. Elle
est décédée en 2013.
André et moi
avons quelques contacts mail à propos de cette ‘machine’. Depuis quelques
années je me passionne pour ces galeries d’exhaure des petits charbonnages d’avant
la révolution industrielle, comme on en a plusieurs chez nous. Mais je ne me
rendais pas compte qu’on utilisait déjà des pompes pour assécher les veines
en-dessous de ces areines et que les spécialistes liégeois de l’exhaure étaient
sollicités de partout.
Dans un
baritel un cheval entraîne la rotation d’un tambour de bois autour duquel un
câble de chanvre s’enroule dans un sens tout en se déroulant dans l’autre.
Chaque extrémité de ce câble passe par une poulie avant de disparaître dans le
puits : quand l’une remonte un tonneau rempli de charbon (ou d’eau), l’autre en
redescend un vide. Le sens de la rotation est ensuite inversé .
Suite à ces contacts par mail je publie en
2019 un blog qui reprenait un peu tout ce que je savais sur le sujet. Lors de
nos vacances ‘Loire à Vélo’ en 2020, j’ai poussé une pointe à Decize la Machine.
André nous a reçus comme des amis de longue date. Ou plutôt des camarades. André
nous a montré les réalisations de sa majorité communiste: l‘espace ‘Paulette
Lavergne‘, avec une enseigne qui fait 5 mètres de long. André nous explique en
riant que cette démesure n’est pas du culte de la personnalité, mais une
surprise de l’ouvrier communal de l’époque à qui on avait demandé une simple
plaque. Lors de l’inauguration on se rend compte qu’il a fait un bandeau de
cinq mètres. Il y a là-bas une belle guinguette et un étang, en fait l’ancien
bassin d’exhaure de la mine.
Paulette a aussi fait restaurer une cité
minière. Et nous visitons le musée de la mine, installé dans l’ancien siège
administratif des Houillères; à quelques centaines de mètres, une extension du
musée avec le chevalement et son carreau de la mine, son parc à matériaux, la
salle de la machine d’extraction et la lampisterie; et, sous le carreau,
l’ancienne galerie de mine-école transformée en lieu de découverte. En entrant
au musée on ne saurait louper cette machine liégeoise bien mise en valeur.
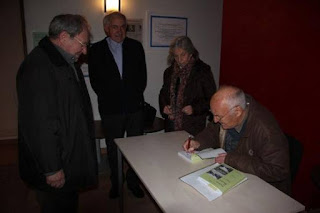 |
| dédicace ‘Paulette et Mouton’ photo journal du centre |
André me remet son livre « Paulette et Mouton », une
autobiographie émouvante d’un couple bien représentatif de ces générations de
municipalistes communistes qui se sont donné corps et âme à leur idéal. Il
dédicace un livre pour Raoul. Suite à cette visite je
reprends le sujet. Généviève Xhayet me suggère de lire « Histoire des techniques en Belgique: la période préindustrielle », une série commencée en 2015 sous la direction
de mon cama Robert Halleux. Je me rends directement compte que je suis en
terrain connu. Cette série des Éditions de la Province de Liège, approfondit
une série d’éléments que Robert avait déjà développés dans un cycle au Centre
culturel La Braise que j’animais à l’époque.
Et M. Lavergne me fournit une généalogie
qui me permet de structurer un peu mieux les liens familiaux entre Daniel
Michel, Rennequin Sualem et les descendants suédois des Kock mentionnés dans le
livre de Robert-Armand
Planchar « La machine de Decize,
Louis XIV et les Liègeois« . Ce qui n’est pas un luxe vu que ces noms
sont diversement orthographiés.
Rennequin Sualem et la machine liégeoise de Decize
Cette
machine est donc liégeoise. Daniel Michel et sa machine de Decize sont
évidemment moins connus que Renkin (diminutif
de Renard) Sualem qui a construit pour Louis XIV la machine de Marly. Mais c’est la même
famille. Or, la cour française connaissait les hydrauliciens de Liège bien avant les
Sualem. Certes, notre Sualem avait un beau CV. Sa
carte de visite était une machine à Modave Le château est d’ailleurs toujours la carte de visite de Vivaqua, la société
d’eau en Région de Bruxelles-Capitale, qui a un important captage à Modave.
Ebloui par Modave, le
prince de Condé le fait venir en 1678 pour son château de Saint-Maur. L’année
après Louis XIV le sollicite pour le château de Saint Germain-en-Laye.
Convaincu, il lui confie la Machine de Marly, sur la Seine. Elle est formée de 3 ‘étages’ de ‘machines de Modave‘ élevant l’eau de
155 mètres au moyen de 350 pompes en cuivre, laiton et fonte. En 1684 Renkin
devient « Premier Ingénieur du Roy ».
Pour la
petite histoire : en 1685, suite aux extensions de Versailles, la machine
de Marly fonctionne bien, mais ne suffit plus. Louis envisage de détourner les
eaux de l’Eure vers les étangs de Versailles, via un immense aqueduc de 4,6 km
et de 72 mètres de haut qui traverse les terres de la marquise et maîtresse du
roi, Mme de Maintenon. Ce projet n’aboutira pas.
De l’hydraulique industrielle vers
l’hydraulique somptuaire.
machine de Modave de Sualem n’est que le transfert de l’hydraulique
industrielle vers l’hydraulique somptuaire. L’antériorité de l’hydraulique
industrielle (1666) par rapport à l’hydraulique somptuaire (1678) a échappé aux
historiens d’autant plus facilement que le débat a assez vite dévié sur les
mérites respectifs du gentilhomme Arnold de Ville et du charpentier Renkin
Sualem. Cela les a empêché à analyser le corps de connaissances que les
constructeurs ont appliqué. Or, la machine de Marly n’est ‘que’ le transfert de technologies éprouvées dans l’industrie liégeoise, en changeant à la
fois d’échelle et de contexte. Certes, les constructeurs ont relevé le défi du
gigantisme, mais dans le fond ce n’était que la transition de l’hydraulique
utilitaire à l’hydraulique somptuaire. Et cette hydraulique utilitaire ne se
limite pas à l’exhaure. Gilles Lambotte par exemple, beau-frère de Renkin et
Paul Sualem (ils travaillent ensemble sur la machine de Marly) avait gagné ses
galons en construisant en 1678 à Many
(Poulseur) une scierie actionnée par l’Ourthe.
Vauban confirme cette antériorité en évoquant
en 1692 l’emploi d’un « engin dans
les charbonnages où qq particuliers mieux foncés en facultés de bien et
d’esprit en ont desja repris quelques unes, qu’ils ont fait vider avec une
machine semblable à celle de Liège qui a servi de modèle à celle de Marly, qui
n’est que la mesme en plus grand volume, répéttée plusieurs fois, par des
pompes dis-je. Ils ont trouvé le moyen de tirer ces eaux de 36 toises de haut
au dessous desquelles ils travaillent maintenant, sans y estre aucunement
incommodé ».
Les wallons et le renouveau sidérurgique suédois
Louis XIV
fait donc appel aux techniciens liégeois un demi-siècle avant sa machine de
Marly. Et il n’est pas directement impressionné par l’hydraulique industrielle,
mais par la supériorité des armes de son allié Gustave II Adolphe, fabriquées
en Suède. Et ces armes sont le résultat d’un renouveau sidérurgique du entre
autres aux wallons De Geer et Kock (là aussi la transcription du nom peut
varier. On les retrouve parfois aussi sous le nom de Cox).
C’est le liégeois R A Planchar qui a relancé cette
piste en 2013 avec son livre « La
Machine de Decize, Louis XIV et les Liégeois » (Editions CEFAL). Robert
Planchar est un ancien directeur du Port autonome de Liège. Les Planchar
étaient depuis le 15e siècle des charbonniers réputés à Montegnée. L’histoire
de la famille Planchar s’écrit au charbon : Daniel Michel et Daniel Kock
ont développé l’exhaure par les hernaz ; des siècles plus tard des
Planchar implantèrent dans les charbonnages liégeois des pompes à feu Newcomen.
Et l’auteur du livre, Robert Planchar, est peut-être à la base du port
charbonnier à Monsin, après le fermeture de nos charbonnages.
Mais Planchar
mélange un peu les pinceaux. Selon lui, Daniel Michel – l’homme de la machine
de Decize- serait né en 1616 de Markus Daniel Kock Constrom et d’Elisabeth Van
Eyck (p. 51 de son livre. La saga de la famille Planchar Lily Portugaels llb 13 septembre 2010 ).
Or, Markus
Kock est arrivé en Suède vers 1626, dix ans après la naissance de Daniel
Michel. Et Daniel Michel ne l’a pas accompagné là-bas. Et c’est la génération Kock suivante qui acquiert
le titre de noblesse Cronström.
Je reviens sur la
généalogie plus loin. Mais M. Planchar m’a mis sur la piste de la famille Kock.
Et via les Kock et l’Histoire des techniques, de mon cama Robert Halleux, je remonte
à Gérard de Besche, le
premier Wallon connu à s’expatrier en Suède. Dès 1614, son fils Guillaume y exploite
le fourneau de Finspong puis la fonderie de canons de Nyköping. A la même
époque, un autre Liégeois, Louis de Geer,
 |
| louis de Geer |
maître de forge d’un fourneau à Liège,
dans le quartier des Vennes, s’installe à Amsterdam, et y devient le principal
munitionnaire du jeune roi de Suède Gustave II Adolphe. A Liège, à la même
époque, vers 1600, un certain Jean Curtius devient «Commissionnaire général d’approvisionnements de guerre », pour
Philippe II et Philippe III d’Espagne, adversaires des protestants avec à leur
tête Gustave II. Curtius ramasse, comme De Geer, une fortune importante dans ce
business.
En Suède,
De Besche et De Geer obtiennent avec leur dizaine de haut-fourneaux et
fonderies le monopole royal de fonte d’artillerie. Louis de Geer, deuxième du
nom, se fait naturaliser suédois en 1627. Il devient en 1629 tuteur des enfants
de Guillaume de Besche, dont l’un des fils, Charles de Besche, épouse sa fille
Ida. C’est eux qui à leur tour recrutent
des dizaines d’ouvriers wallons dont les Kock.
Colbert recrute en Suède
Abraham de Besche pour ses fonderies de canon
Le premier
wallon que Colbert, ministre de la marine, recrute en Suède, en 1666, est Abraham
de Besche, fils de Hubert de Besche, frère de Guillaume, ‘fondeur
très habile de son art’, pour réorganiser la
production de canons pour les vaisseaux de guerre. A son sujet, Colbert
écrivait à l’intendant de la
 |
| statue Louis de Geer Norkoping |
Marine: « Pour
nos fonderies de canons de fer nouvellement établies en France, je fais venir
de Suède un nommé Besche qui est fils de celuy qui en a fait l’établissement en
Suède, que l’on dit estre fort habile ; il ira visiter toutes nos fonderies
pour les redresser en cas qu’il y ayt quelques défaut, et pour établir
luy-mesme un fourneau dans le Nivernois » (HARSIN Paul, «
Les frères de Besche au service de la métallurgie française », Revue d’histoire
de la sidérurgie, 1967, p.193-224).
Abraham de
Besche dirigera entre autres la manufacture de canons de Beaumont la-Ferrière
(en Nivernais !) qui travaille pour l’arsenal de Rochefort. Il est venu de
Suède avec la religion protestante. Pas de problème pour Louis XIV qui lui fait
don de la terre de Drambon, en Bourgogne, afin qu’il y établisse une
manufacture de canons pour la marine. Besche y fera donner le prêche protestant
en son domicile pour sa famille, ses domestiques et ses ouvriers, conformément
aux dispositions de l’édit de Nantes. Ceci dit, il s’agissait d’une ‘modération
vigilante’ par rapport à la religion protestante: le 9 septembre 1672, un
ministre écrivit à Dalies de la Tour au sujet des usines de Drambon : « J’ay esté informé que le sieur de Besche et
vous avez estably un presche public à Drainbon , où ceux qui professent la R.
P. R. (Religion Protestante Réformée) s’assemblent. Je suis bien aise de vous
dire qu’il est nécessaire que vous fassiez cesser cet exercice qui est
contraire aux ordonnances du royaume et que le roy ne veut point souffrir dans
les lieux où il n’est point permis par ses édits. Donnez donc ordre promptement
à ce qu’il ne se fasse plus aucune assemblée ni exercice de ladite R. P. R. ,
afin que cet établissement finisse sans y employer l’autorité de S. M. » .
En 1668 son
frère Hubert est recruté par le même Colbert pour développer la Compagnie des
mines du Languedoc. Il a à ses côtés comme administrateur Riquet de Bonrepos, le
créateur du canal du Midi.
Louis XIV
va donc chercher des descendants de Louis de Geer en Suède. Pourtant, De Geer
avait approvisionné en munitions et armes les protestants de la Rochelle, dont
son père Louis XIII avait fait le siège, de septembre 1627 jusqu’à la
capitulation fin 1628. On est ici dans la géopolitique. Pour affaiblir les
Habsbourg qui l’entourent, Louis XIV soutient la Suède dont le roi est le chef
de file des protestants.
Le roi
très chrétien Louis XIV comprend que c’est l’apport technique des de Geer,
Besche et Kock qui a fourni les armes avec lesquelles le roi Gustave II Adolphe
a révolutionné l’art militaire lors de la guerre de Trente Ans. A la bataille
de Breitenfeld, en 1631, les 42.000 soldats équipés –et soldés- par De Geer,
avaient écrasé l’armée catholique impériale jusque-là invaincue. Pour la
première fois dans l’histoire, le nombre de morts par armes à feu avait été
supérieur à celui des morts par armes blanches. L’artillerie de campagne mobile
sur le champ de bataille, avec ses révolutionnaires et terribles canons suédois
à tir rapide, avaient été produits dans la manufacture de Nyköping gérée dès
1615 par Guillaume de Besche, puis en association avec Louis II de Geer à partir
de 1626.
Louis XIII et Richelieu payaient
400.000 écus par an à Gustave Adolphe. Une partie de ces écus arrivaient dans
les caisses du commissaire général pour les fournitures des armées, le liégeois
De Geer. L’Espagne et Ferdinand II de Habsbourg sont approvisionnés par Curtius.
Notons qu’après un succès initial, Abraham ne pouvait arriver à une production de
qualité en France, à cause de la mauvaise qualité du minerai Nivernais (Histoire des techniques en
Belgique- la période préindustrielle Volume I, les éditions de la province de
Liège p.379). Et son frère Hubert
ne connaît pas le succès économique non plus.
Markus Kock et le
transfert de la technologie de la fenderie liégeoise
Une
branche de la famille Kock par contre prendra racine en France, après un
passage par la Suède. En 1626 Louis de Geer cherche à recruter Henri Daniel
Kock pour «tout l’ouwerage de fer qu’il
serat besoing et nécessaire pour faire tourner et besongner une fenderie à
fendre fer, tel que sont à pays de Liège». Avec cette fenderie, Louis de
Geer peut décupler sa production de fers en barre nécessaire à la fabrication
de canons de fusil. Aujourd‘hui nous parlerions de transfert de technologie. La
vallée de la Vesdre était connue pour ses canons damas qui se fabriquaient au
moyen de baguettes obtenues par
laminage de « masses ou lopins » composés de plaques et de tiges d’acier
mélangées à chaud et assemblées en proportions variables. Plusieurs baguettes, portées au
blanc soudan, sont alors martelées jusqu’à l’obtention d’un ruban régulier. Chauffé
à nouveau, ce ruban est enroulé sur un mandrin recouvert d’une chemise en tôle.
Plusieurs rubans, soudés bout à bout, sont nécessaires pour l’enroulement d’un
canon de fusil. Le canon ainsi apprêté est porté au blanc puis martelé pour
souder les spires. On fore alors l’intérieur du canon pour mettre celui-ci au
calibre désiré. On redresse ensuite le canon au marteau ou à la machine.
Henri
Daniel Kock n’est jamais parvenu en Suède. C’est son frère Marcus qui prend sa
place. Il obtient en 1627 le privilège exclusif d’établir sur les cours d’eau
des fenderies exemptes de tout impôt. Ses fils y font carrière et sont anoblis
par le roi Charles XI sous le nom de Cronström. Un petit fils de Marcus, Daniel
Cronström, est nomme ambassadeur de Suède en France, en 1702-1719. Il est à
l’origine de la fabuleuse collection Tessin-Harleman du Nationalmuseum de
Stockholm, laquelle comprend un dessin technique inédit de la machine de Marly.
Logique puisqu’au moment de son arrivée en France son cousin Rennequin est
depuis vingt ans premier maître charpentier de la machine de Marly.
L’Edit de conquête d’Ernest de
Bavière
Vous
commencez peut-être à vous demander quel est le lien entre ces fenderies, ces
canons de fusil et ces machines d’exhaure. Il s’avère que la famille Kock s’était
fait aussi un nom par l’exhaure, suite à
l’édit de conquête du Prince-Evêque
Ernest de Bavière. En 1939 Jean
Lejeune explique dans son livre « La Formation du capitalisme moderne dans
la principauté de Liège au XVIe siècle » comment cet édit de Conquête des
mines inondées a été une bouffée d’oxygène pour le capitalisme naissant. L’édit
prévoit que si le propriétaire des lieux est incapable d’en vider l’eau,
quiconque y parvient a le droit d’exploiter la mine à sa place, « comme le justifie son art, ses frais et ses
peines », mais moyennant une redevance, le droit d’entrecens ». Pour
la petite histoire, le Conseil d’État a
jugé que cet édit est toujours en vigueur au 16 avril 2013. Quant à l’exhaure, si
Liège n’a plus connu d’inondations graves depuis 1926, c’est grâce aux 42
stations d’exhaure de l’Intercommunale pour le Démergement.
En 1601 le
prince recrute David Kock, alias Remacle
qui avait inventé « certains
instruments et mollins tirant pompes en grand nombre, chose nouvelle et
inusitée en notre pays de Liège, à effet de tirer les eauwes hors des fosses et
ouvraiges de la montaigne de la Plumterie de Prailhon ». Il installe à
la Blanche Plombière une machine mue par l’énergie hydraulique (mollin)
actionnant par des chaînes ou tiges (tirants) des pompes situées au fond de la
mine. La mine de la Blanche Plombière
était la première mine de plomb de la région de Liège (Histoire des techniques en Belgique- la période préindustrielle Volume
I, les éditions de la province de Liège p.149).
Or, ces fers fendus sont aussi à la base des
tirants ou tringles qui transmettent l’énergie hydraulique ou l’énergie d’un
baritel vers une installation d’exhaure (ou une scierie ou un maka).
Pour leur machine
d’exhaure Daniel et David Kock introduisent à Liège la feldstange, la technique
de la commande à distance, mécanisme apparu au XVIe siècle dans les mines des
Fugger dans les monts Métallifères d’Europe Centrale. À Prayon, les pompes se
trouvaient à différents étages à l’intérieur de la mine, située à flanc de
coteau, tandis que les roues motrices étaient placées en contrebas, sur un
ruisseau. Ces ‘feldstange’ étaient fabriqués dans les fenderies.
Vers 1630, Daniel Kock engage Renard Sualem
pour assurer l’entretien de la machine ainsi que l’encadrement technique de la
mine et de son personnel. Dans un contrat d’embauche de dix-huit ouvriers et
mineurs, il est clairement précisé que les frais relatifs aux «hernaz et pompes à tirer les eawes, comme
[du salaire] de maître Renard Zualem, conduite d’icelle et des cordes
afférentes à leurs besoigne » sont à la charge des maîtres et associés de
la mine. Ce « vers 1630 »
est très approximatif, puisque
nous retrouvons en 1633 encore Renard dit
Renkin Sualem comme directeur à la Blanche Plombière. Et vers 1635, Renard et Paulus Sualem relèvent le métier
de charpentier de leur père. L’aîné, Paulus, est membre du métier des
houilleurs puisqu’il exploite comme comparchonnier (exploitant associé) la
fosse de charbon delle Platte Bourse, située au-dessus de Jemeppe. Avec son
beau-frère il exploite aussi la fosse de Leux, au lieu‑dit Pirmollin; c’est «un
grand bure» familial, juste située dans le champ derrière leurs maisons et
entourée de petits terrils « terrices », ainsi que trois autres petites fosses
à proximité. Son frère cadet est membre du métier des charpentiers et aussi,
fait inédit, du métier des charliers ou menuisiers. Toujours est-il que Renkin épouse en Suède Catherine Kock,
fille de David Kock. Leur fils Renkin Sualem junior développera la machine de
Marly.
 |
| captage d’eau dans la mine de Vedrin |
Les deux frères reprennent
la tradition paternelle de construction de machines d’exhaure, comme en 1662 et
1664, deux machines dans une mine de plomb à Vedrin. Le premier est une machine
hydraulique actionnant des pompes aspirantes, au moyen de roues à aubes
dressées sur le ruisseau de Vedrin. Le
second est un classique manège à cheval, un « hernaz », avec « grosse chaîne »
de fer et « tonneaux » pour évacuer l’eau et le minerai. En 1675 Paulus
construit une machine d’exhaure sur la fosse du Many, de l’abbaye du Val
Saint-Lambert, l’une des plus grosses entreprises d’extraction houillère
d’Europe (Le Many fermera en 1953, après une
explosion très violente le 24 octobre 195, qui coûte la vie à 26 gueules
noires, 12 Belges et 14 Italiens).
Une tradition ancestrale en matière d’exploitation houillère
qui fera la réputation internationale de la Wallonie.
Le volume I de l’Histoire des techniques enBelgique- la période préindustrielle, et notamment les Chapitres 5 (l’eau comme
ressource et comme énergie), et le
chapitre 9 (les énergies fossiles : l’exploitation des mines de charbon
avant la révolution industrielle) décrit très bien la genèse de ce savoir-faire
industriel. La morphologie du terrain houiller
wallon joue un rôle décisif dans la conduite
 |
| areine Richonfontaine en-dessous du Musée de la Vie Wallonne |
des travaux d’exploitation minière
en particulier sur les méthodes d’exhaure qui sont tributaires de la tributaires de la nature du
relief du sol. C’est sur ce terrain géologique, particulièrement complexe, que
s’édifie, en Wallonie, une tradition ancestrale en matière d’exploitation
houillère qui fera sa réputation internationale.
La problématique de l’exhaure a également des
incidences sur la structure des sociétés formées en vue de financer les
opérations onéreuses d’assèchement des travaux ; galeries ou machines à
feu ont en effet besoin de moyens financiers solides. Ces sociétés préfigurent
les sociétés capitalistes de l’ère industrielle.
Enfin, l’exhaure suscite une abondante
production juridique. La jurisprudence liégeoise et son corrolaire, la Cour des
Voir Jurés, font figure de modèles.
L’autre moyen d’évacuation des eaux dans
le pays de Liège consiste à aménager des galeries (xhorre, hore, ariene, araine).
L’on commence à travailler les veines de dessous, « non-xhorrées, pour
finir par celles au-dessus & que l’on nomme veines xhorrées ».
Sur l’exhaure, Decamps dit en 1889: «lorsque la Houillère est à portée d’un
courant d’eau, l’épuisement d’un bure se fait par un engin à pompe, de l’espèce
qui a servi de modèle à Rennequin Sualem pour la machine de Marli, &
peut-être aux machines qui sont employées pour la mine à cuivre de Suède,
lesquelles sont sur le même principe que la machine gravée dans le Dictionnaire
mathématique Physique Saverien. Les fosses plus importantes s’équipent d’un
baritel (manège à chevaux ou herna) doté d’un tambour vertical. Ce dispositif
est une esquisse des châssis à molette » (DECAMPS, « Mémoire historique sur l’origine et
les développements de l’industrie houillère dans le bassin du Couchant de
Mons », Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et
des lettres du Hainaut, 5e s., I, 1889, vol. H, p.189).
Contrairement aux historiens qui décrivent
l’histoire à partir d’ « inventeurs » comme Rennequin Sualem,
l’histoire des techniques nous montre qu’il s’agit de systèmes de production. Dans ce cas-ci une série de techniques
(exhaure, refendage) développées dans un contexte bien particulier d’un droit
de conquête sur les mines noyées et une évolution fulgurante des armes de
guerre dans un contexte de guerres de religion. Et l’ironie de l’histoire veut
que le prince-évêque à la base de ces progrès techniques voit se chiper les
meilleurs techniciens convertis au protestantisme. Ceux-ci se retrouvent de la
Hollande à la Suède, en passant par la Prusse, dans les églises wallonnes.
Le tableau généalogique Kock- Sualem
Mettons un
peu tout ça ensemble dans un tableau généalogique à partir de Kock dit Le
Serwyr Remacle (1541-1615).
Il a deux
fils, Daniel et David.
La branche
ainé de Daniel a deux fils, dont nous retrouvons l’ainé Markus Daniël Kock en
Suède (1585 Liège-1657 Avesta-Suède). Markus a 7 enfants dont nous retrouvons Daniêl
Michel Sr en France (né en Belgique- +1693 Thianges, en Nièvre). Il épouse Anne
Poirier à Grâce-Hollogne où nait l’ainé de leurs deux enfants, Daniêl Michel Jr
(1672 -1706 Champvert- Nièvre). La troisème génération nait à Thianges : Daniel
Michel III et Jean Michel le 11/9/1693; selon R-A Planchar, c’est lui qui prend
la succession de son père. Il serait recensé à Decize comme directeur l’engin
et ingénieur.
La branche
cadette de David Kock (1541-1615) nous mène aux Sualem. Sa fille Catherine
David Kock épouse Renard Sualem, charpentier de machines, fils de Paulus Sualem.
Il y a aussi des interims dans la famille, comme Jean Sualem, cousin de Paulus, ingénieur et maître d’engin
à Coronmeuse-Herstal, qui travaille en 1685 durant neuf mois à la construction
de la machine. Toussaint Michel, époux de Gertrude Sualem et gendre de Paulus,
menuisier tourneur, est le seul menuisier en poste à la machine, spécialiste de
la fabrication des boules de pistons pour les pompes.
André Lavergne
a réussi à avoir une copie de l’ acte de
baptême du 11/9/1663 de Jean Michel, fils de Daniel Michel et d’Anne Poirier
(voir pièce jointe). Leur fille Catherine Sualem aussi nait le 2/4/1665 à
Jemeppe-sur-Meuse . Elle décède en 1723 à Marly-le-Roi. Elle avait marié à
Jemeppe-sur-Meuse le maître charpentier
Gilles Lambotte (1652-1723).
Le
troisième de leurs quatre enfants, Renkin Sualem, nait encore à Jemeppe le
29/1/1645. Cathérine, son mari et son frère Paulus accompagnent leur père et
beau-père en France. Leurs enfants font
carrière là-bas.
Un de
leurs fils, René Lambotte, sera ingénieur charpentier du pont de Blois avec son
père. Suite aux inondations terribles qui balayèrent tout le cours de la Loire et
emportèrent le pont de Blois, Gilles Lambotte et son fils René, ingénieur du
Roi, se chargea de la charpente de la nouvelle construction.
petit-fils Pierre Lambotte fera en 1760 une chute mortelle à l’aqueduc de
Louveciennes.
Son
petit-fil Gervais Sualem s’occupera de la pompe de Notre Dame de Paris, puis de
la pompe royale dite ‘de la samaritaine’
alimentant le Louvre et les Tuileries.
Daniel Michel, parent de
Rennequin Sualem, ingénieur de la machine
Rentrons maintenant un peu plus dans le détail
de la machine de Decize.
Un contrat
passé en 1488 est le plus ancien document lié à l’exploitation du charbon qui
affleurait à Decize. L’exploitation se faisait par trous ou à flanc de coteaux.
Louis XIV cherche à développer ses arsenaux. Une compagnie créée pour exploiter
les mines de charbon de Decize doit fournir le charbon pour ses forges. La
compagnie remercie son roi pour le prêt de Sualem, ingénieur de sa
majesté : «On fit venir de Liège un
très grand nombre de travailleurs, d’outils, de chaînes & d’autres
ustenciles. Rennequin ingénieur de Votre Majesté à qui le sieur de Louvois
permit de se transporter pour cela en Nivernois, fit d’abord ouvrir deux
différents puits, et fit faire en même temps des machines d’une nouvelle
invention, pour mettre sur les puits, & en tirer les eaux &les charbons
en même temps. On ne parvint au grand heur de charbon, c’est-à-dire en plein
charbon, qu’à 34 toises de profondeur [66 m], au commencement du mois d’octobre
1689, après trois mois d’un travail continuel. On envoia aussitôt de ce charbon
à la Machine de Marly, pour y faire l’essai & rendre compte de sa qualité
au sieur de Louvois. Il y eut esté trouvé aussy bon que celui d’Angleterre».
A l’époque
de Daniel Michel plus de 200 mules assurent le transport du charbon vers la
Loire. Cette houille ne servait pas seulement aux arsenaux de la flotte, mais
fut donc aussi utilisée pour la machine de Marly : ses forges consommaient
80 tonnes de charbon de terre par an pour réparer les pièces de mécanismes.
Rennequin est intéressé au
bénéfice de l’entreprise à hauteur d’1 sol sur 20, soit 5 % des bénéfices
L’entretien de « la machine» qui allait donner son nom au site minier est
confié à Daniel et Toussaint Michel, le dernier étant le menuisier tourneur de
la machine de Marly.
La machine
que Rennequin monte à Decize est un puissant manège à chevaux tournant un arbre
vertical qui anime un va-et-vient de tonneaux d’eau fonctionnant comme un
ascenseur continu. A Liège on fabrique ce genre de machines dans toutes les
tailles : à Herstal par exemple il y avait un bure du lévrier, un bure du
bourriquet et une houillère Gaillard-Cheval. A Decize on les appelle les
baritels.
Daniel
Michel est cité comme « ingénieur de la
machine, de la ville de Liège ». Il s’établit en Nivernais avec toute sa
famille. Son fils, prénommé aussi Daniel, né à Grâce (fusionné avec Hollogne
aujourd’hui) le remplacera plus tard au même poste d’ingénieur et directeur
d’engin.
Gilles
Lambotté, gendre de Rennequin, est cité comme parrain du fils de Daniel II
Michel le Jeune et il est présent à l’enterrement de Daniel II Michel. Les
liens de solidarité familiale restent forts entre nos Liégeois (p._154-181 « Rennequin Sualem, ses parents et alliés, etla machine de Marly », Liège, 2007, p. 154-181).
Et que
deviennent ces houillères après les Michel ?
Une machine à vapeur est installée en 1782 mais la houillère, vite déficitaire,
est laissée à l’abandon. Lors de la Révolution française la mine est
nationalisée. En 1801, elle possède 8 puits qui descendent jusqu’à 80 mètres et
produisent 8 000 tonnes chaque année.
En 1816,
une Société anonyme des mines de houille de Decize installe plusieurs machines
à vapeur. En 1842, la production s’élève à 40.000 tonnes, onzième dans le
classement des houillères françaises. Un ouvrage d’art du chemin de fer
hippomobile unique dans le monde remplace le transport à dos d’ânes. Cinq
écluses sèches ou ascenseurs à wagons permettaient de faire descendre les
trains de charbon jusqu’au canal du Nivernais, à 6 kilomètres. Dans un système
de balance, le wagon chargé en descendant par son seul poids faisait remonter
l’autre wagon vide, sans l’appoint
d’énergie extérieure. C’était une alternative originale aux plans inclinés
répandus à l’époque, souvent équipés de treuils mûs par des machines à vapeur
fixes. En 1873 les écluses sèches sont remplacées par une voie ferrée.
En 1869, Schneider
du Creusot rachète la houillère.
Après la
Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille du charbon, toutes les mines sont
nationalisées. La Machine passe sous le giron des Charbonnages de France. Dès
1959, la retraite du charbon est lancée. En 1974, le dernier puits est fermé. La
production atteignait alors 270.000 tonnes par an. La ville perd la moitié de sa
population. L’Association Machinoise pour la Conservation du Souvenir Minier,
créée en 1970, ouvre en 1983 un musée.
Postface 1 : Rennequin, créateur de
la machine de Modave, dans les romans historiques à deux sous du XIXe siècle
Je ne
saurais terminer ce blog sans référer au débat sur la paternité de la machine
de Modave, lancé par Eric Soullard, professeur d’histoire-géographie, qui a
fait sa thèse de doctorat sur les eaux de Versailles.
« Ce n’est qu’à partir des romans historiques à deux sous du
XIXe siècle que l’on fait de Rennequin le créateur de la machine de Modave. A
cette époque, dans une pièce de théâtre de boulevard, on voit même le fils du
baron de Ville réparer les torts de son père en épousant la fille de Rennequin
Sualem, le pauvre charpentier illettré de Jemeppe. La littérature historique a
alors engendré bien des idées farfelues et légendes encore tenaces aujourd’hui » (Eric
Soullard, Rennequin Sualem, ingénieur,
la diffusion du savoir-faire liégeois à travers l’Europe aux 17e et 18e siecles ).
Soullard a publié
ce texte intéressant dans le cadre d’un colloque en 2004 «Minorités et
circulations techniques du Moyen- Âge à l’époque moderne », au
Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris).
Selon lui, cette machine
serait plutôt l’œuvre de Jacques Pierson, fontainier du roi à Bruxelles, selon les
archives de Modave. Mais en fait, peu importe que Rennequin se soit fait un nom à partir de
Modave ou à partir d’un son chantier pour le prince de Condé ; Rennequin a
surtout surfé sur une technologie d’exhaure développé à Liège pour les mines,
et appliquée ensuite sur les châteaux.
Postface 2 : les
Sualem en Russie après la mort de Louis XIV
En 1715, à la mort de
Louis XIV, les finances de l’État ont un déficit de un milliard huit cents
millions de livres. Le régent Philippe d’Orléans songe même à supprimer la
machine de Marly si coûteuse en entretien. La première génération de Liégeois
n’est plus de ce monde. Paulus Sualem est mort en 1685, son frère Rennequin
s’est éteint en 1708, Toussaint Michel – gendre de Paulus – est décédé en 1709.
Quant à Gilles Lambotte, il a quitté la machine en 1716 pour construire le pont
de Blois. Or, au même moment, le czar Pierre le Grand charge son agent à Paris
de recruter les artistes, ingénieurs et architectes pour à la fondation de
Saint-Pétersbourg. En 1716, une partie de la famille Sualem part en Russie pour
se mettre au service du czar. Dans le congé accordé pour aller près Sa Majesté
Czarienne délivré le 15 avril 1716 par le directeur général des bâtiments du
roi, on retrouve dans les «gens qui
partent par terre Girard Sualem, machiniste. Jean Michel menuisier». Parmi
les «gens qui vont par mer et qui doivent
se rendre à Charleville, Paul Joseph Sualem, compagnon machiniste. Edme
Pelletier valet dudit sieur Gérard Sualem. René Sualem, compagnon dudit sieur
Michel, menuisier ».
L’agent consulaire
français Lavie rend compte de l’arrivée d’un « ingénieur machiniste Girard Sualem, dont le père et l’oncle ont
fait la machine de Marly. Ils attendent quarante autres ouvriers qui leur
viennent par mer».
 |
| fontaines de Peterhof |
Tous
appartiennent à la deuxième génération de Liégeois, celle qui est née en
France, sauf l’ingénieur Gérard Sualem qui est le seul à être né au pays de
Liège. Fils de Paulus, neveu de Rennequin, il emmène avec lui son neveu Jean
Michel, maître menuisier à Paris, fils de Toussaint Michel (le menuisier de la
machine de Marly), et de sa sœur Gertrude Sualem. Puis deux des enfants de son
cousin Paul René Sualem, fils de Rennequin, à savoir René, filleul de Toussaint
Michel, et son propre filleul Paul Joseph Sualem, compagnon machiniste, âgé de
13 ans, qu’il a tenu sur les fonts baptismaux à Bougival.
Les
historiens russes font de Paul Sualem un fontainier à qui ils attribuent la
fontaine de la Pyramide, la fontaine des Fables, la Fontaine Française, la
fontaine mécanique de La Favorite et bien d’autres encore dans les jardins
impériaux de Petrodvorets près de la nouvelle capitale Saint-Pétersbourg.
Cette
crise financière en France est donc la fin de cette famille élargie des Sualem
en France.
Postface 3 : Les
Wallons en Suède
Par contre, en Suède, il yaurait actuellement 40.000 descendants de ces Wallons fiers de leurs origines.
Mille deux cents d’entre eux sont membres de la Société « Les Descendants des Wallons de Suède »
(Vallonättlingen) qui veut « rassembler les
descendants des Wallons qui ont émigré en Suède au dix-septième siècle,
contribuer à la conservation de la culture wallonne en Suède et de créer un
contact permanent avec la population de la Wallonie». Plusieurs livres sont
sortis, comme Vallonska rötter ou Vallonerna.
Pendant l’été 1948, 41
enfants belges de la région liégeoise ont passé 5 semaines chez des hôtes
suédois. Un demi-siècle plus tard « La Meuse » a réussi à repérer certains
de ces enfants qui ont maintenant atteint l’âge de 60 ans
Tout ça a donc commencé
avec De Geer et Guillaume de Bèche (ou Besche) en 1595. Mathieu de Geer avait
été le plus gros fondeur de la Terre de Durbuy, possédant les fourneaux de La
Forge sous Mormont et Roche-à-Frêne, ainsi qu’un quai et des entrepôts à
Barvaux (« Sur la Gère »). Ils ont fait venir des ouvriers wallons pour leurs
forges de Nyköping et Finspang. La Guerre de Trente Ans offrira un débouché
intarissable pour ces ouvriers wallons exilés aux Pays-Bas (alors Provinces
Unies) pour des raisons religieuses. Entre 1620 et 1640, ils seront cinq mille
environ à répondre à l’appel. La région d’Uppsala compte vingt-trois bruks ou
villages de forges.
La mine de fer de Dannemora
existait en 1481 et probablement à la Préhistoire. On y a extrait du minerai
jusqu’en 1992. Cette mine à ciel ouvert présente au visiteur ébahi un trou
d’une profondeur de cent mètres. En 2001, la Ville de Durbuy et la commune
d’Östhammar célébraient leur jumelage dans cette mine. Un an plus tôt, la même
cérémonie s’était déroulée en la salle Mathieu de Geer à Barvaux.
Österbybruk a restauré une
forge wallonne. A Östhammar, le bruk avec son manoir et un superbe parc anglais
est propriété de la société Forsmarks Kraftgrupp qui gère la centrale
nucléaire. Les anciennes maisons des forgerons sont habitées par les
travailleurs de la centrale.
Postace 4 Les Eglises wallonnes
Je n’ai pas encore été
jusqu’à Uppsala, mais j’ai déjà visite une dizaine d’églises wallonnes, à
Magdeburg (qui a existé jusqu’en 1950, lorsqu’elle a fusionné avec une autre
église protestante), Potsdam, Berlin. Des communautés wallonnes qui ont fui
l’Inquisition et qui ont été accueillis à bras ouverts par les rois de Prusse
ou de Saxe. Il y a aussi des Waalse Kerken à Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft,
Eindhoven, Maastricht et Middelburg.
Sources
https://www.academia.edu/26844769/_Rennequin_Sualem_ses_parents_et_alli%C3%A9s_et_la_machine_de_Marly_actes_du_colloque_Les_Wallons_%C3%A0_Versailles_tenu_au_Ch%C3%A2teau_de_Versailles_5_d%C3%A9cembre_2007_Li%C3%A8ge_2007_p._154-181 « Rennequin Sualem, ses parents et alliés, et
la machine de Marly », actes du colloque Les Wallons à Versailles, tenu au
Château de Versailles, 5 décembre 2007, Liège, 2007, p. 154-181.
« Les
Planchar, maîtres de fosses dans la Seigneurie de Montegnée », par Robert
Planchar, Éditions du Céfal, 264 pages, format 16 x 24 cm, 23 euros.
http://www.librairiewb.com/9782871303503-la-machine-de-decize-louis-xiv-et-les-liegeois-renkin-et-paulus-sualem-gilles-lambotte-daniel-m-robert-arm-planchar/
Planchar, R.A. »La
Machine de Decize, Louis XIV et les Liégeois ». Éditions CEFAL. 2014.
Robert Planchar a mené sur
place une longue enquête en 2011 et 2012, afin de retrouver les traces
éventuelles des descendants de tous ces Liégeois qui choisirent de rester à La
Machine où qui y furent enterrés, après avoir fait souche.
Collectif,
L’histoire de la mine de La Machine, Mémoire de la mine, Collection Études et
documents, CD58, 2014 p.98-102.
AMACOSMI,
La Machine, une ville, une association, un musée, Conseil Général, Nevers,
2002, 115 p.
Mémoire de
la mine, collection photographique du musée de la mine de La Machine, Musées de
la Nièvre, Études et documents n03, 2000, 85 p.
Maurice Fanon, « Les
Wallons de Suède… en Terre de Durbuy », in Terre de Durbuy n° 20, 1986
Philippe BASTIN, Terre de
Durbuy.
André
Lavergne est un soixante-huitard, comme moi. Son livre « La Nièvre et 1968, Histoire, déroulement, acquis, retombées,
enseignements », sorti dans le cadre du cinquantenaire des mouvements
de 1968, retracé l’histoire de la Nièvre à travers les révolutions de 1789, de
1830 et de 1848.
André
Lavergne a créé à l’usine Céramique de Decize un syndicat CGT, avant de devenir
secrétaire général de la Fédération nationale CGT de la Céramique.
http://ulsn.reference-syndicale.fr/voyage-a-cuba-par-andre-lavergne/
http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article141366
Né en 1935 il participa au quatrième festival de la jeunesse et des étudiants
pour la paix et l’amitié à Bucarest en août 1953. Il fit partie de la première
délégation de 113 jeunes français en Union Soviétique en 1954.