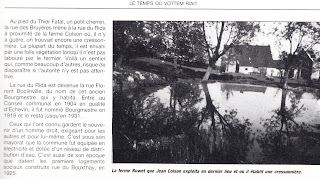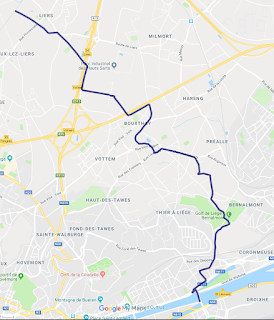58ième balade-santé MPLP Herstal : le Rida
 Notre 58ième
Notre 58ième balade-santé MPLP Herstal du dimanche le 8 novembre part à 10h dans le
tournant de la rue de Boclinville, à hauteur du numéro 133, près des panneaux « Rida ».
Ca sera évidemment dans le respect des règles de confinement. Nous vous
donnerons les détails d’ici-là. Nous avons aussi notre rendez-vous habituel à 9h30 devant notre
Maison Médicale Médecine Pour le Peuple, Avenue Francisco Ferrer 26, à Herstal,
d’où nous partons en covoiturage. N’oubliez pas le masque !
Nous continuons la balade précédente, que nous
n’avons pas su terminer dans les temps, devant les explications passionnantes
de notre prof de géographie Jan Nyssen dont la page wikipedia sur la Rida a été
la base de notre balade. Nous avons fait en octobre la première partie du Rida,
du clos du Val jusqu’à la source – ou résurgence ? -de la rue de
Boclinville.
Cette fois-ci nous continuerons jusqu’au
Patar.
La ferme Ruwet et son étang très poissonneux
A l’endroit même de la source se trouvait la
Ferme Ruwet, toujours visible sur les plans cadastraux en 1958, même si sa
démolition remonte à 1953. La ferme se
trouvait au fond de vallée, or que l’on construisit en général plus haut pour
éviter l’humidité. Notre prof géographe a une hypothèse intéressante à ce
propos : c’était au départ peut-être un moulin à eau. En effet, il y a
juste à côté un étang qui aurait pu servir de réserve d’eau pour le moulin. En
effet, le Rida n’avait pas le débit suffisant pour alimenter un moulin en
continu. Le dernier fermier, M. Colson, y a exploité encore une cressonnière.
L’étang a été remblayé. Le cresson sauvage qui y pousse a disparu à la fin de
notre été très sec de 2020.
En 1985 notre historien local Raymond Smeers décrit
ainsi ce fond très humide et marécageux de la rue Boclinville, sur l’ancien
territoire de la commune de Vottem, située au pied de la légère côte vers
Hareng et Milmort, dans sa ‘Petite
Histoire de la Préalle’ (éd
Charlemagnerie) : « A
gauche de la route, encaissée entre deux mamelons de prairie, s’érigeait
autrefois une ferme aux murs passés au lait de chaux et son soubassement en
goudron noir.
Vers
1850, la ferme appartenait à Mr. Hougardy, avocat à Liège, à qui elle servait
de seconde résidence. Peu après, M. Ruwet en faisait l’acquisition et le
dernier occupant en a été M. Colson, fermier et laitier de son état. Isolée de
la route, abritée derrière un rideau d’arbres fruitiers, elle n’était pas
bien grande, assez vieillotte mais charmante sous son toit de tuiles rouges.
Coquette, elle se mirait dans les eaux claires d’un étang très poissonneux,
situé légèrement en contre-bas.
L’étang
était alimenté par de nombreuses sources. Le trop-plein, qui descendait en
pente douce longeant le chemin de terre de la ferme à la route, donna naissance
au ruisseau du Rida. Il alimentait le hameau du même nom.
Malheureusement,
la chute d’un V1 et d’importants dégâts miniers ont précipité la disparition de
la ferme. Elle fut démolie en 1953, l’étang remblayé et, sur son parcours à
l’intérieur de la propriété, le ruisseau canalisé ».
M. Smeers ne parle pas d’un moulin à eau, ce
qui ne veut pas dire que l’hypothèse de notre Pr Nyssen est fausse.
Valoriser les parties encore à ciel ouvert du Rida : fluet, limpide, gazouillant discrètement ?
De la rue Boclinville nous descendons le
Sentier Muraille, officiellement Sentier n° 33: Le Schéma de Structure Communal de 2013 propose
de valoriser les parties encore à ciel ouvert du Rida. Et bien, nous y
sommes ! Le Rida s’écoule le long du sentier. Pour le valoriser, il suffit
de recréer la situation que M. Smeers a connue en 1985 : « Nous retrouvons le Rida de l’autre côté de
la route, fluet, limpide, gazouillant discrètement, se cachant quelques fois
sous les hautes herbes qui ondulaient au moindre souffle du vent, suivant les
méandres capricieux des rives pour aboutir au fossé Launay.
En ce
coin isolé, une piste, mal tracée parmi les prairies, partait de chaque
rive ; celle de droite, traversant le sentier Muraille, aboutissait rue du
Bouxthay, l’autre remontait en direction de Hareng. Cette dernière prairie
abondamment arborée de cerisiers, aujourd’hui disparus, ressemblait, au
printemps, à un immense bouquet de fleurs ».
Voici comment notre prof géographe décrit le
même paysage : « Une partie du
sentier est labourée, et « poussé » vers la parcelle voisine. On
observe l’alignement du sentier par la position de la clôture du pré. Un jour
le fermier laboura le chemin en laissant toutefois un passage non labouré à la
limite de son champ. Certes ce
détournement du tracé initial est de bon sens, sauf que dans quelques années on
pourrait ne plus reconnaître le caractère vicinal (s’il en est) du chemin comme
ce fût le cas lors du détournement du Coq Mosan… »
Sur notre droite, au bout de la prairie, se
trouvait en 2017 encore une borne minière. Elle a disparu et sur les photos que
j’ai prises à l’époque on ne distingue pas la concession. C’est dommage pour
notre patrimoine minier. Selon notre ami Walthère Franssen, la législation
concernant le maintien des bornes de concession, même après la déchéance de la
Concession, doit être très sommaire. En dehors de l’obligation de bornage des
concessions, et des PV de bornage il ne trouve rien ! Qui est le
propriétaire de ces bornes de concession placée sur les terrains
d’autrui ? On peut supposer que tant que la Concession est établie les
bornes sont et restent la propriété du charbonnage. Et lorsque la Concession est déchue, les bornes
abandonnées sont-elles la propriété du propriétaire actuel du terrain ? Walthère ne trouve dans
les archives des charbonnages ni trace d’indemnisation au propriétaire de
surface pour l’établissement de servitude, ni trace d’achat par le charbonnage
des quelques décimètres carrés de terrains nécessaire pour le placement de la
borne. Et puis, qui sait quels Concessions sont actuellement déchues ou pas? Si
aucune législation ne protège les bornes de concession, la seule solution pour
en assurer la conservation serait d’en demander le classement en tant que
« Petit patrimoine populaire wallon ».
Ce qui signifie que ne pourrait être classées que les bornes répondant à
certaines conditions de visibilité et d’accès public.
A gauche, le Sentier du Meunier traversait le
Fond de l’Ônè (le fond de la vallée) et montait à travers cette prairie
bocagée. Nous arriverons bientôt au Pasay des Meuniers. Et nous terminerons par
la rue des Meuniers. C’est à nous faire tourner la tête. Ne cherchez pas :
il n’y en a pas un de ces moulins qui reste !
La fosse Launay et ses écrevisses et crevettes d’eau douce
Nous continuons dans les pas de Raymond Smeers:
« En quittant la fosse Launay, une
dénivellation du terrain augmentait la vitesse du courant permettant à l’eau
dans ses remous des perles à profusion pendant que dans les taillis et les
arbres voisins, les oiseaux tentaient de mettre au point un chœur à deux ou
trois voix brillamment orchestré par une grive musicienne.
A
hauteur de la double rangée de saules
trempant leurs vertes ramures dans l’élément fluide, le ruisseau s’élargissant,
accueillait, dans son lit, écrevisses et crevettes d’eau douce ».
Nous ajoutons écrevisses et crevettes d’eau douce à la palette
culinaire de Vottem, avec le cresson et les fraises. Mais où se trouvait cette
fosse Launay ? Launay=
L’Aunaie ? Les aulnes croissent dans les bois humides ou marécageux, ou
encore en bord de cours d’eau. Les aulnes forment des futaies appelées «
aulnaies ». Aurait-on urbanisé une zone marécageuse, en créant cette rue de
l’Aunaie ? Toujours est-il que lors d’un gros orage sur un sol asséché,
les riverains en bas de la rue d’Aunaie ont vu le Rida passer dans leurs
livings. Quand on voit le relief, le Rida ne coule plus dans le point le plus
bas, le thalweg, qui se trouve au milieu du champ. En cas d’orage le ruisseau
reprend probablement son cours d’origine. Les riverains ont dû construire à
leurs frais un mur d’orage. En ‘récompense’ on les a augmenté leur revenu
cadastral ! Et la ville a installé une pompe pour éviter que ces eaux y
stagnent.
Et là, on voit à quoi pourrait servir un
contrat rivière. Herstal a cru faire l’économie d’un contrat rivière Meuse Aval
(CR), subsidié pourtant en partie. C’était trop cher, car beaucoup d’habitants
et peu de ruisseaux. Cependant, sans CR, la Ville devra quand-même faire les
mêmes tâches sur leur propre budget…
Maintenant, on peut dire que, sans le vouloir,
cette fosse protège en quelque sorte le Patar, un peu plus bas, contre une
inondation sérieuse, et toutes les maisons en aval.
Un siphon et un égoût
Le croisement de la rue de l’Aunaie et la rue
Verte aussi est souvent sous eau lors d’un orage. On comprend pourquoi en
analysant comment les égoûts et le siphon du Rida s’y croisent. Le Rida
continue son chemin par les terrains très marécageux de la ferme du Patar. Nous
faisons un petit crochet par la rue du même nom. A la fin de l’asphalte, à gauche, une coupe géologique qui permet d’observer le
cailloutis de la terrasse principale de la Meuse. Ne vous faites pas d’idées lorsque par temps
de Covid on évoque une terrasse. Nous sommes ici dans la géographie. C’est le
pr. Jan Nyssen qui le dit.
Nous ne suivrons pas ce chemin qui devient
ensuite un chemin de terre, tout à fait praticable, et qui rejoint la Rue
Bonne-Foi. Nous ferons le tour de la concession Bonne-Foi Hareng lors d’une
autre balade-santé.
Nous nous limitons à regarder sur notre droite
les ruines de la ferme historique du Patar. La ferme même n’est pas une ruine.
Elle est très bien restaurée. La grange par contre est plutôt en mauvais état.
Vers 1860, le docteur Emile Muraille (bourgmestre de Herstal de 1878 à 1882)
propriétaire de cette ferme, donne son nom au sentier Muraille que nous venons
de quitter, une servitude qui traverse ses terres. Le sentier existait bien
avant que le fermier-docteur ne le baptise (source Alain Budin et R. Smeers, A Herstal, l’ombre
d’un empereur, éd. Charlemagnerie,
p.83).
Ce que nous ne voyons plus, c’est le premier moulin
des neuf moulins de Herstal actionné par le Rida. Il n’y a jamais eu des
moulins plus haut, le long de la rue des Meuniers que nous arpenterons un peu
plus loin. Une charte signale l’existence de ce moulin déjà en 1341. Il
appartenait à l’Hôpital Saint Mathieu de Liège.
Il portait aussi le nom le moulin dit de
Villers ou de Moulin aux Hayes de Brouck. Je laisse la parole à notre ami
Smeers : «Il y a environ un
demi-siècle, certaines vieilles personnes prétendaient que, lors de la
construction du chemin de fer en 1863, on y avait découvert une fondation qui
aurait pu provenir du vieux moulin. A la fin du 16ième siècle, ce
moulin était encore en pleine activité. L’exploitation charbonnière, le
creusement de nombreux burs, tout en tarissant les sources, ont permis l’assèchement,
le défrichement et la mise en culture de ces terres. Bien avant les travaux des
houilleries, plusieurs ruisselets descendant de Rhées et de Milmort ainsi que
les sources qui jaillissaient du sol, en bouillonnant, rejoignaient le ruisseau
du Rida à l’endroit de l’actuelle voie ferrée, à une bonne centaine de mètres
en aval de la ferme. Cet important apport d’eau a dû être un argument
déterminant pour établir à cet endroit la construction du moulin ».
Malgré l’assèchement par les charbonnages, l’endroit
reste très humide. Dans le Schéma de Structure de notre ville, elle est
reprise, à juste titre, dans la bande verte. La ville a reculé devant la
difficulté de protéger cette bande verte contre une urbanisation excessive. Il
aurait fallu pour cela modifier le plan de secteur. Mais elle a réussi (jusqu’à
maintenant) de bloquer l’urbanisation du Patar parce que la zone est inondable.
La rue Verte = Pasay des Meuniers
Nous revenons sur nos pas pour suivre la rue
Verte qui fut connue au temps jadis sous le nom de Pasay des Meuniers. L’ancienneté
de la dénomination est affirmée par le cartulaire de l’abbaye du val Benoit du
8 septembre 1332. En 1871 elle portait
encore le nom ‘Chemin des meuniers’
parce qu’elle conduisait au moulin de la Préalle. Mais la dénomination la plus
ancienne est ‘Voie des Hayes de Brouck’.
Ces haies partaient du hameau du Rida, longeaient l’actuelle rue du Patar, et s’étendaient
jusqu’au carrefour des rues de la Limite et de l’Agriculture.
Nous descendons la rue de la Baume. Nous
aurions dû avoir ici un passage sous-voie. La Ville a jugé que c’était plus
utile d’affecter les fonds à un passage sous-voie en face du café de la Petite
Bacnure, où il fait doublure avec un passage au-dessus des voies. Soi-disant
pour faciliter le passage aux personnes à mobilité réduite. Le résultat est à
pleurer : même en chaise roulante on a plus facile de passer par le pont
que par le bas, tellement qu’il y a des escaliers. Nous verrons le résultat en suivant
le Ravel Rail jusqu’à la Place César de Paepe
Place César de Paepe la première école de La Préalle
A l’emplacement de l’ancienne
école/bibliothèque, la pharmacie Carlier-Thonet bouche l’accès à la paire de la
Petite Bacnure où il y a eu à l’époque un projet de logement social.
En 1844, 47 % des hommes et 62 % des
femmes étaient analphabètes. La première
école de La Préalle, Place César De Paepe, était une école d’initiative privée
subsidiée par la Commune. En 1846, une
première école officielle est créée. Les
bâtiments de l’école primaire communale sont de 1899.
En juillet 2018 la ville a décidé de
concentrer l’activité à l’école Jacques Brel 1, qui aujourd’hui regroupe les
classes maternelles et les classes de 1ère, 2e et 3e année primaire. A Brel 2,
sur la place De Paepe, il y avait les
4e, 5e et 6e primaire. Les deux implantations causaient des problèmes de
sécurité (e.a. trafic) et de surveillance aux familles qui ont des enfants dans
des niveaux scolaires différents.
Le budget est de 4 millions d’euros, dont 2,8
millions de subsides. Une salle de gym permettra tous types de sports et un
préau sera construit. Il y a eu
unanimité pour la concentration et la rénovation de Brel 1. Mais avec ça on n’a
rien dit sur le bâtiment de la place César De Paepe. Ce bâtiment de 1899 a des
qualités architecturales indéniables, même si je n’ai pas (encore ?) réussi à
identifier l’architecte.
Rue Rogivaux 15: La
Coopérative socialiste.
En 1868 La Préalle avait une des 42 sections
belges de l’Association Internationale des Travailleurs. L’AIT développe des magasins de denrées
alimentaires pour pouvoir maintenir une grève. Le nombre d’adhérents de La
Préalle au Parti Ouvrier Belge, créé en 1886, fut toujours plus élevé que dans
les autres quartiers de Herstal. Une
Coopérative Socialiste, succursale de La Populaire de Liège, s’installa en 1898
rue Rogivaux, à l’emplacement de l’actuelle pharmacie. En 1921, le premier
bâtiment devint Maison du Peuple qui subsista jusque la fin de la guerre. La
coopérative disparaît dans les années 70. W. Franssen a interviewé en 1982
Madame Champagne, qui habitait le quartier depuis le début du siècle :
« Avant 1914, dans mon entourage, on
allait tous à messe. On avait peur de
l’enfer [dit-elle en riant]. Puis avec
la Maison du Peuple, la Coopérative et le Syndicat, les hommes ont commencé à
parler entre eux. On n’a plus été à
messe et on a défendu nos droits.
Regardez, actuellement, comme on est bien logé et mon mari a une bonne
pension« . Ce qu’il en reste
actuellement n’est donc pas le bâtiment à l’abandon de cette coopérative mais
une sécurité sociale aujourd’hui fortement menacée !
Rue de la Bance
Nous remontons le rue Rogivaux pour prendre à
gauche la rue de la Bance. En face, une baraque du Fonds Albert mise aux normes d’isolation du XXI ième
siècle en 2019.
La rue est toujours en travaux. C’est un des
derniers chantiers d’égouttage à Herstal. On a commencé le « Plan Communal Général d’Egouttage » en 2003 ! Avec ça Herstal
sera égoûté à 98%. La rue de la Bance n’a pas eu de la chance. Les
raccordements n’étaient pas toujours évidents, dans cette rue ancestrale avec
une situation cadastrale compliquée. On avait prévu 95 jours ouvrables. Mais des
fissures sont apparues dans les maisons. La campagne de la Bance est un
gruyère : le charbon affleurait en si grande abondance qu’on parlait d’une
« montagne de charbon ». Au
bur ‘delle Banse’ on montait la houille par manne (banse). En novembre 2019 les travaux ont été arrêtés. On
espère la fin avant le démarrage d’un autre chantier autrement plus important
que nous verrons un peu plus loin.
Un bassin d’orage au-dessus d’une veine de houille
L’AIDE (Association
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la province
de Liège) a prévu 3 millions d’euros pour la construction d’égouts dans les
rues de la Houillère, Campagne de la Banse et Henri Nottet. Il y a aussi l’aménagement
d’un bassin d’orage rue Campagne de la Banse, au pied du terril, sur une partie
de la paire acquis par l’AIDE. Dans la rue Campagne de la Banse on creusera un
puits de 8 mètres d’où partira une canalisation en béton jusqu’à la rue H.
Nottet.
Notre histoire s’écrit au charbon. Cela est
vrai aussi pour ce bassin d’orage. Voici l’avis technique de la direction des
risques géologiques et miniers : « la moitié nord du bassin d’orage se trouve au-dessus de la veine de
houille ‘Maret’ qui vient à l’affleurement, sous les limons, un peu à
l’intérieur du périmètre. Cette veine était une des plus épaisses du bassin,
pouvant atteindre 2m d’ouverture. Il convient de s’assurer de l’absence de
zones déconsolidées sous le fond du bassin d’orage, liées à d’anciens travaux
miniers dans la couche Maret. Nous n’avons pas d’informations précises quant à
la localisation d’anciens travaux souterrains, de vieux puits ou d’autres
ouvrages miniers de faible dimension, résultant de l’exploitation de couches ou
de gîtes de houille superficiels, non concédés. La pose de cet égouttage peut
modifier au niveau local des nappes qui peuvent exister au sein des dépôts
quaternaires (rabattement, modification des conditions de drainage) et
pourrait ainsi influencer la stabilité
du pied du terril. Il est prudent de faire un suivi piézométrique du chantier.
Les
parcelles du projet sont affectées par des zones de contrainte géotechnique
majeure autour des puits.
192090
Bure de Chorre
Idem
puits sans nom
192092
Bure Lingin
192091
Bure delle Sereine
Idem
puits sans nom
192201
Bure
192093
Bure Alle Chavée
Idem
puits sans nom
Ces
puits ont été remblayés, mais, dans la grande majorité des cas il est
impossible de garantir la stabilité à long terme des remblais et donc des
parois et des abords des puits ».
Lors d’une réunion d’information, en septembre
2020, l’AIDE m’a assuré que les sondages n’ont pas révélé des problèmes
particuliers.
Le Ravel de liaison Meuse-Liers
Nous arrivons bientôt sur le Ravel de liaison Meuse-Liers,
sur notre droite. D’ici on se rend bien compte comment le terril de la Petite
Bacnure bouche une partie du vallon du Rida. Selon Raymond Smeers, « un petit ruisseau, un Ri en provenance des
sources de Vottem, partait de la rue de Herstal près de l’immeuble 88,
descendait entre deux terrains cultivés et passait ensuite sous un chemin de
campagne. Ce vieux chemin, partant de la rue Henri Nottet, face à la
Charlemagnerie rejoignait après maints détours la rue de la houillère. Ce
chemin et le ruisseau, comblés par le terril, ont disparu en 1930 » (Petite
Histoire de la Préalle, p.12 et 32, éd
Charlemagnerie). Ce ruisseau a disparu, mais son
thalweg est toujours là. Est-ce l’explication pour les eaux de ruisselement qui
descendent par fortes pluies jusqu’à certaines maisons ? A la réunion
d’information sur le chantier deux riverains se sont plaints, mais, Covid
oblige, je n’ai pas réussi à les contacter après pour demander des détails.
Et plus haut, les habitants de la Rue
Lavaniste Voie aussi ont régulièrement leurs caves noyées lors de fortes
pluies. Et TPalm sollicite actuellement un permis d’urbanisme pour construire
septante et un logements Lavaniste Voie, juste à côté du golf… Les travaux de
cette nouvelle « cité » pourraient commencer au printemps prochain. Ce
qui pourrait aggraver les problèmes d’égouttage. On m’a répondu que cette rue
est liégeoise, et que les égoûts aussi sont sur Liège. Mais quid des problèmes
de ruisselement, lors de gros orages ?
Le Ruisseau
du Bouxthay
En montant le Ravel, sur notre gauche, dans un
petit bois, les ruines du Château du
Bouxthay, avec un arbre remarquable, un if. Pour les chercheurs du Schéma de
Structure Communal ce site est le plus beau de notre ville. Ce terrain est
public. A l’époque, la commune de Vottem a acheté la propriété de M. Peeters ;
Herstal avait acheté le site du château, et en restant propriétaire de la ferme
et des ruines de la chapelle, a cédé le
reste à la SRL.
Dans les champs coulait jadis le Ruisseau du
Bouxthay ; aujourd’hui il traverse ce fond de vallée dans un pertuis
souterrain. Les sources se trouvent dans une prairie, parallèle à la Rue des
Fontaines. Je donne la parole à notre prof en géographie : « Ås fontinnes donne une impression du
paysage rural d’origine de toutes les têtes de vallée voisines. Dans ce
ruisseau on cueillait jadis le cresson. L’écologie aquatique convenait au
cresson: une eau claire et peu profonde, non acide, à courant lent. Les
habitants des environs venaient récolter ce cresson par sacs entiers, et le
revendaient à la criée de Vottem.
Actuellement,
cela reste un ruisseau et un paysage inattendu dans un environnement largement
urbanisé. On observera une xhavée en amont des sources, sur les craies, et puis
un ruisseau aux eaux claires. Les débits ont sans doute diminué fortement en
raison de l’infiltration moindre, et le cours aura été rectifié pour drainer
les prairies. Ås fontinnes subsiste comme un paysage semi-naturel.
Dans la
zone de sources, plus en amont, se trouvait dans années 1970 un élevage de
truites ».
J’ajoute ces truites à palette culinaire de
Vottem, avec les écrevisses, crevettes d’eau douce, cresson et fraises.
Entre Ås fontinnes et le Bouxthay, en bas de
la Chaussée Brunehaut, L’AIDE creusera prochainement un autre bassin de
temporisation qui vise à « délester
l’égoût de la Chaussée de Brunehaut qui se met régulièrement en charge ».
Mais quid des eaux de ruissellement qui traversent la chaussée? Selon l’échevin
qui présidait la réunion d’information sur le chantier qui vient de démarrer,
ça ne concerne pas l’égouttage. Si l’inondation ne provient pas des égoûts,
c’est un problème privé, à régler avec les propriétaires des prairies ou des
champs d’où proviennent ces eaux.
C’est écarter un peu facilement un problème
qui n’est pas nouveau mais qui prend une nouvelle dimension avec le
réchauffement climatique, marqué par un accroissement des phénomènes
météorologiques. Pourtant, la Cellule GISER (Gestion Intégré Sol Erosion
Ruisselement SPW-DGO3-DRCE) est en train de définir sur WalOnMap la carte des
zones à risque d’inondation par ruissellement et/ou de coulée boueuse. Cette
carte représente les axes de concentration naturels des eaux de ruissellement,
qui correspondent aux thalwegs, vallées et vallons secs. Cette carte présente 3
classes de risques définis par la taille des bassins versant. J’hésite néanmoins
sur l’interprétation. Il faudra que j’en parle à notre prof géographe.
La Rue des Meuniers, son Ravel, et le Sentier du Meunier
Nous montons la Rue des Meuniers. Comme j’ai
dit plus haut, c’est la rue Verte qui mériterait le nom de Pasay des Meuniers. Nous
sommes ici toujours sur le Ravel. On peut se demander s’il n’y avait pas un
trajet plus intéressant que cette rue avec son trafic automobile quand même assez
important ?
Nous remontons jusqu’à la rue Boclinville pour
retrouver notre point de départ.
Je n’ai pas osé prendre l’itinéraire de la promenade ‘Sur
les sentiers des maraîchers de Vottem’ du Pr. Nyssen. Pourtant,
elle est intéressante : elle visite cinq sentiers de Vottem. Mais il faut traverser un champ vallonné. S’il n’y a pas de cultures, et si le temps
est assez sec, ça peut aller. Mais il faut aussi passer « en-dessous
d’un simple fil barbelé » et ça, je n’oserais pas avec un groupe un
peu important.
Voici quand même un extrait, pour vous mettre
l’eau à la bouche : « la
densité de sentiers s’explique par le maraîchage, stimulé par la proximité de
la ville. Le travail intensif de la terre nécessitait beaucoup de déplacements
à pied; le produit était transporté par les femmes (les cotîresses) et par
charrettes à bras. La superficie totale vouée à la culture maraîchère et
fruitière à Vottem était de 102 ha en 1929 et 28 ha en 1958: légumes, fraises,
fleurs, arbres fruitiers. Si la culture des fraises a marqué les esprits, elle
n’en constituait pourtant qu’une petite partie (six hectares en tout et pour
tout, bon an, mal an »).
Le trajet de Jan emprunte un Sentier du
Meunier ou encore Pazê dè Moûnî en wallon (vous me direz : encore un
meunier) qui commence dans la Rue du
Bouxthay. « Il vient d’être
entretenu par les services communaux en mai 2020. Officiellement c’est le Sentier n° 32: Au
départ le sentier est bien balisé, entre deux clôtures de fil de fer. Le
panneau d’interdiction qui se trouve l’arrière du terrain de football concerne
le terrain de football, pas le sentier. Passez en-dessous d’un simple fil
barbelé. Légalement, il devrait se trouver ici une chicane ou un tourniquet.
Marchez dans la prairie, tout en longeant l’arrière du terrain de football. Chaque
année, la commune l’entretient jusqu’ici (190 m). Ensuite, cette servitude
traverse un champ vallonné. S’il n’y a pas de cultures, marchez tout droit sur
200 mètres. S’il y a des cultures, longez la limite du champ en direction du
Sentier Muraille ».
Le tracé GPX de cette
promenade peut être téléchargé gratuitement ici :
https://www.openstreetmap.org/user/jnyssen/traces/3462144
La carte d’ensemble et
les feuillets des promenades A, B et C sont disponibles ici : https://www.dropbox.com/sh/ynm0ap685350deu/AADzY5shyHE2vQfdNv68MIl5a?dl=0
Voir aussi
http://hachhachhh.blogspot.be/2014/02/balade-sante-vottem-un-ravel-la.html
entre la Place César de Paepe et le Bouxthay
nous sommes sur https://hachhachhh.blogspot.com/2020/01/55ieme-balade-sante-mplp-herstal-la.html