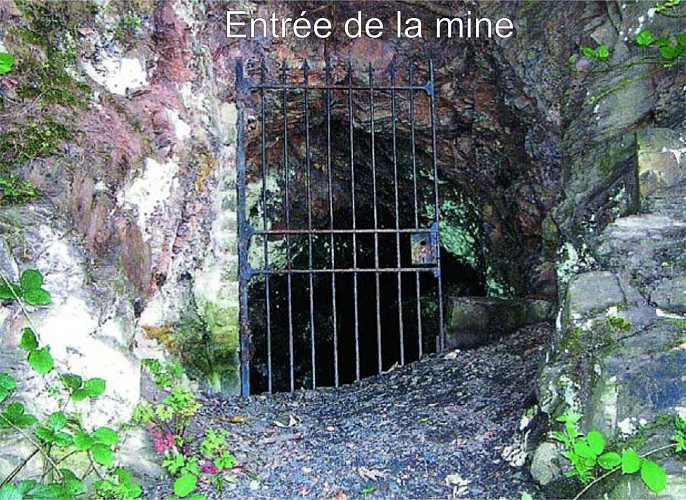Les vestiges du Canal de l’Ourthe le long du Ravel
 |
| cheval halage angleur photo L. Bruck |
Au bout du Ravel Meuse, au Pont de Fétinne, commence
le Ravel Ourthe. A deux reprises on a essayé de faire un canal qui reliait la
Meuse à la Moselle, via l’Ourthe et la Sûre. Il en reste des traces qui peuvent
agrémenter un tour en vélo.
Sans remonter mille ans en arrière, « Mille ans de navigation sur l’Ourthe »
de R Dalem et A Nelissen m’ont servi de
référence pour ce blog.
Guillaume I veut une jonction Meuse- Moselle
Le premier projet de canalisation de l’Ourthe a
été lancé par Guillaume I, premier (et dernier) roi du Royaume Uni des Pays Bas.
Certains prétendent que le terme officiel en français était royaume des
Belgiques. Pour trancher cette question il faut aller voir le texte du congrès
de Vienne de 1815. Guillaume avait une stratégie très personnelle avec ce canal:
le Congrès de Vienne l’avait aussi nommé Grand-Duc de Luxembourg et il voulait
relier son duché à son royaume par un canal. En 1830 il est resté Grand-Duc mais
il a perdu la Belgique qui a directement abandonné le projet après son
indépendance.
Il n’y avait pas assez d’arguments économiques
pour continuer ce canal. Certes, l’ AR du 1/7/1827 de Guillaume I accorde à la ‘Société du Luxembourg’ au capital de 10
millions de florins une concession pour une jonction Meuse- Moselle par une
canalisation de l’Ourthe et la Sûre. Et il avait engagé pour
 |
| Remy De Puydt |
son projet Remy De Puydt. Celui-ci travaille aussi
sur une canalisation de la Meuse, un canal de Mons à Alost ainsi qu’un canal de
Mons à la Sambre. Le roi Guillaume le charge du projet de percement de l’isthme
de Panama, dont la concession avait été accordée à une compagnie hollandaise. La révolution de 1830 compromet tout l’avenir de ses entreprises. Depuydt
persiste et signe, jusqu’en 1839, en tant que commandant en chef du génie de
l’armée, en parallèle à une carrière parlementaire.
En 1841, le roi Léopold 1er choisit encore De
Puydt comme négociateur pour une colonie dans l’État du Guatemala. L’affaire
aboutit à un désastre.
Ce taux d’échec assez élévé n’entame
aucunement le dynamisme de Depuydt qui commence
la jonction Meuse- Moselle sur le chapeau des roues, avec des chantiers à trois
endroits en même temps: de Liège au confluent des deux Ourthes, de
Wasserbillig sur la Moselle à Hoffelt, et un tunnel de 2,5 km entre Hoffelt et
Bernistap, au partage des eaux Meuse – Moselle.
Malgré ces investissements conséquents, la
Belgique indépendante suspend les travaux trois ans plus tard, en septembre
1830. Ce qui ne décourage pas ces investisseurs de se présenter en 1846 ‘porteurs de toutes les actions de l’ancienne
Société de Luxembourg’ pour relancer le projet. Sans Guillaume I…
De cette première version ne nous sont
parvenus quelques-unes des seize maisons
éclusières entre Liège
et Barvaux et deux bouts de tunnel à Hoffelt- Bernistap. Aux Aguesses on voit encore
l’amorce de l’ancien bras initial qui se dirigeait vers le quai du Condroz
et celui des Ardennes, en coupant l’usine des Conduites d’eau.
Selon un
inventaire des travaux exécutés, dressé en 1834, les piles et culées de 16
barrages-déversoirs en lit de rivière étaient construites, les dérivations pour
l’établissement des écluses étaient presque toutes creusées à profondeur voulue ;
la maçonnerie des écluses était fort avancée, ainsi que celle de plusieurs
ouvrages d’art. Les 16 maisons éclusières étaient mises sous toit, le chemin de
halage entre Barvaux et Chênée était praticable sur presque tout le parcours.
Robert Dalem
a fait une recherche pointue de ce qui reste. Des 16 maisons éclusières il y
avait en 1970 encore une près de l’écluse N°2. La onzième, exhaussée en 1848, a
été utilisée pour le canal de 1859. C’est la seule de toute la série à avoir
reçu cette destination.
M. Dalem a
retrouvé au lieu-dit Grandpré à Comblain-au-pont des traces d’une écluse
ébauchée et des pierres travaillées sur les berges rive gauche.
Et j’oublie
presque La Résidence « Au fil de
l’eau » sur la place de Tilff. Elle a hébergé l’Hôtel du Casino qui
s’appelait en 1840 l’Hôtel du Canal de l’Ourthe. Le 8 juin 1837 le propriétaire
annonce que sa Grande Barque, couverte de zinc, part régulièrement tous les
dimanches à 8 heures du matin, du Rivage des Croisiers (aujourd’hui Quai Van Beneden)
et arrivera à 11h à Tilff…
La Grande compagnie du Luxembourg
 Il y a un nouveau départ en 1846, lorsque
Il y a un nouveau départ en 1846, lorsque
Closmans et Cie, ‘porteurs de toutes les
actions de l’ancienne Société de Luxembourg’ demandent une concession pour la Grande
Compagnie du Luxembourg (GCL) qui s’engage à terminer la canalisation de
l’Ourthe jusqu’à La Roche. Mais Closmans vise en fait le chemin de fer. Il
demande en contrepartie la concession de la ligne de chemin de fer de Bruxelles
jusqu’à la frontière Luxembourgeoise. De Puydt envisageait la canalisation de
l’Ourthe, de la Woltz, de la Wiltz et de la Sûre, par l’édification de barrages
garantissant un tirant d’eau suffisant pour de petits chalands ou hernas de 40
tonnes de charge, nettement supérieure à
celle des anciennes « bètchettes» de l’Ourthe. A chaque barrage était associée
une écluse latérale.
La GCL par contre propose vingt ans plus tard un
canal latéral, avec certaines portions dans le lit même de la rivière. Une des
raisons était que les nouveaux excavateurs à vapeur facilitaient le creusement
d’un canal latéral. En plus, un canal latéral réduisait les dangers des
courants et des hauts fonds de la rivière ; et sur les eaux calmes du canal, le halage des bateaux exigeait beaucoup moins d’énergie.
La CGL s’aligne
pour la 1ère section
Liège-Chênée sur les autres canaux projetés par Léopold I. Dans un rapport
intitulé « notes détachées relatives
à la canalisation de l’Ourthe dans sa partie comprise entre Laroche et la
Meuse», édité en 1848, la CGL dit que « la
première section qui a reçu un commencement d’exécution, sera construite
d’après les dimensions du canal de jonction de la Meuse à l’Escaut : 10
mètres de large, tirant d’eau 2,10m. Les écluses auront 50 m de longueur de sas
et la largeur entre les bajoyers (murs latéraux de l’écluse) sera de 5,20 m »
(Dalem op.cit. p.147). Ce canal de jonction Meuse-Escaut qui
fait référence, et qui sera remplacé un siècle plus tard le canal Albert, était
greffé sur le Zuid-Willemsvaart, à Bocholt, contourne le plateau de la Campine
par Lommel et descend à Herentals où la navigation se prolongeait jusqu’à
l’Escaut, par les Nèthes et le Rupel.
 |
| canal de l’Ourthe à Angleur © Philippe Vienne |
Le mouillage de 1,20m est obtenu au moyen de 11 barrages fixes en
rivière; quatre sont des barrages usiniers établis longtemps avant le canal,
aux Aguesses, à Sauheid, à Campana et à Colonster. Les 7 autres barrages sont
en aval de l’île du moulin à Tilff ; face aux usines de Monceau à
Méry ; à Lhonneux, en aval du pont d’Esneux ; en amont de la
Gombe ; à Brigaton, entre Chanxhe et Rivage et à Douxflamme (Dalem p.163).
Dans ce nouveau concept les travaux entamés par Depuydt ne
servent plus à rien.
Ces barrages
fixes sont encore visibles par basses eaux. Le barrage des Grosses Battes aux
Aguesses a été rehaussé récemment et a aujourd’hui une chute de 3,95 m. On y a inauguré en janvier 2021 une centrale hydroélectrique. Lors des inondations
de juillet 2021 ce barrage a été accusé de dévier les inondations vers le canal
de l’Ourthe. On voit sur certaines photos comment l’eau déborde en venant des
quartiers entre l’Ourthe et le canal.
La CGL n’a jamais dépassé les carrières de Sprimont.
Les travaux de la CGL sont interrompus par la
crise de 1848. Ce ne fut
qu’en 1852 qu’on se mit sérieusement à la tâche pour la terminer en 1854. Ce canal n’a jamais dépassé les carrières de Sprimont. En 1862 la
Compagnie obtient une concession pour une ligne chemin de fer de
l’Ourthe et est exonéré de la poursuite de la canalisation de l’Ourthe. En
1873 l’Etat racheta toute la concession.
Un AR du
1/8/1876 fixait le droit de navigation à 0,0075 centime par tonneau et par km à
percevoir par quatre bureaux situés à Douxflamme, Esneux, Tilff et Angleur. En
1892 le gouvernement parle de désaffectation, le produit des droits de
navigation n’étant pas en rapport avec les dépenses occasionnées par son
entretien. En 1913 il y avait encore 13 éclusiers et 3
éclusiers receveurs. En 40-45 on naviguait encore jusque Tilff. Le premier tronçon – plus
large- a été utilisé jusqu’à la fermeture des Conduites d’eau.
Quand on fait du vélo le long du le Ravel
Ourthe on retrouve donc à gauche et à droite des vestiges de ce vieux projet de liaison Meuse- Moselle…
Ceci dit, je vous avertis : la vallée de
l’Ourthe a été très touchée par les inondations et on en verra des traces
encore très longtemps. Mais sans tomber dans le tourisme noir et une curiosité
malsaine pour la misère des autres, on peut observer ces aspects-là d’une
manière positive. Comme le disait Berthold Brecht, on dit d’un fleuve emportant
tout qu’il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui
l’enserrent.
Rivage-en-Pot
J’ai décrit les quelques vestiges que le
projet Depuydt a laissé : quelques maisons éclusières, quelques
barrages-déversoirs et une
écluse ébauchée et des pierres travaillées sur les berges.
Les vestiges du canal de la CGL sont autrement
plus visibles, entre Angleur et Comblain-la-Tour. Le canal commence au
Rivage-en-Pot. Quand on passe sur le Ravel entre le pont de Fragnée et le pont
ferroviaire du Val Benoit, en bordure d’une autoroute urbaine à quatre bandes,
on ne se rend plus compte qu’on est sur les berges à guinguettes du le
Rivage-en-Pot, qui accueillaient il y a un siècle les familles bourgeoises le dimanche.
Rien ne t’interdit de croire que le terme Pot fait allusion à ces guingettes,
même si ce n’est pas correct étymologiquement.
 |
| pont Marcotty © Philippe Vienne |
Aujourd’hui l’accès
par la rue des Aguesses n’est pas évident. La première
écluse, mise en service en 1847, est la seule qui a gardé ses portes et qui est
encore en état de fonctionnement. Certains l’ont montré du doigt lors des
inondations, parce qu’elle est restée fermée. La maison éclusière, détruite lors des
bombardements de 1944, a été reconstruite en 1945. Entre
l’écluse N°1 et 2, au lieu-dit « Moulins Marcotty », un tout
pittoresque pont-levis avec derrière
la demeure du pontonnier.
De l’écluse une piste cyclable longe le chemin
de fer pour aboutir dans le quartier des Vennes, sous-produit d’une exposition
universelle de 1905. Le lan
communal « Canal de l’Ourthe »
de 2007 a créé un
maillage mobilité douce assez intéressant entre les Aguesses, le centre
commercial de Belle-Ile, la gare d’Angleur, l’échangeur des Grosses-Battes, et l’Ile aux Corsaires.
Mais continuons notre chemin le long du canal,
dont les premiers kilomètres sont marqués
par des friches industrielles d’entreprises historiques, comme la Compagnie
Générale des Conduites d’eau (héritière de la fonderie des Vennes) fondée en
1865. Elle installa des réseaux d’eau à Paris, Santander, Montréal, Hollande et
en Roumanie. Déclarée en faillite en 1980, le site est resté désaffecté
jusqu’en 1995. On y a implante le complexe commercial de Belle-Île qui est
presque redevenu une friche suite à une menace de fermeture du Carrefour.
A la jonction du canal avec l’Ourthe, point
kilométrique (PK) 1,53, un deuxième pont-levis avec habitation et tête de
garde. Au début des années 1960, il y avait encore des pénichettes qui
déchargeaient au comptoir des matériaux (à côté du pont). L’écluse N° 2 Angleur
Grosses-Battes a fonctionné jusqu’à la fin des années 1980.
Umicore, anciennement la Vieille Montagne, et sa pollution au
zinc
 |
| La VM à Angleur |
L’île aux corsaires, en fait une presqu’île
entre l’Ourthe et le canal, est un beau nom pour un ancien crassier (ou terril)
de poussières de zinc et de plomb. Une flore riche en zinc, notamment la pensée
calaminaire et le gazon d’Olympe calaminaire, s’y est développée. Umicore, anciennement
la Vieille Montagne, se trouve juste en face de la réserve, de l’autre côté du
Canal. On y produit toujours de la poudre de zinc. Umicore a trouvé un moyen
commode pour ne pas dépolluer le site.
Carpe, je te baptise lapin : un crassier est baptisé réserve naturelle… En
2005, Umicore e pose d’une clôture, réalise un caillebotis en bois, installe
deux panneaux informatifs et des bancs et en confie la gestion à Natagora. Le
site est seulement accessible pour des
visites guidées.
En 1806 Napoléon concédait l’exploitation du
gisement de zinc de la « Vieille-Montagne » à la Calamine (calamine= un
silicate hydraté de zinc) au chanoine Jean-Jacques Dony. Celui-ci construit une
usine à zinc à Saint-Léonard. En 1856, l’usine rend particulièrement insalubres
les conditions d’habitation dans ce quartier. Une campagne se développe pour
l’expulsion de cette « nouvelle oligarchie qui menace de tout
arranger à son profit ». En octobre 1857, le comité provoque et gagne
une élection par la démission de son porte-parole au conseil communal : « la république démocratique et sociale
vient de battre … les libéraux ». L’usine de Vieille-Montagne s’est
installée à Angleur en 1838.
Une liaison avec le Ravel de la ligne 38
 |
| la ligne 38 |
Juste après le canal, en rejoignant l’Ourthe, on
a accès au RAVeL de la Ligne 38, via la passerelle du chemin de fer. Cette
liaison a été inaugurée en avril 2019, en compensation paysagère pour la ligne
TGV qui passe sur l’emprise originelle de cette ancienne ligne de chemin de fer qui traverse le Pays de Herve et reliait
autrefois Chênée à Plombières. En 1872, Chênée devient la gare de bifurcation de
cette nouvelle ligne qui est ensuite prolongée jusque Herve (1873) puis Battice
(1875), puis, en 1895, vers Plombières puis vers Aachen.
Streupas, son écluse, son île, son Panê-Cou-Plage
 |
| pont barrage remplaçant l’écluse de Streupas |
A Streupas on rentrait dans le canal latéral
par l’écluse 3 jusqu’à l’écluse 4 de Sauheid ; puis on réutilisait la
rivière jusqu’à Colonster. Une page wikipedia remonte l’Ourthe sur base des 17 écluses.
L’ écluse N° 3 PK 3,77 a été remplacée par une
digue pour maintenir le niveau d’eau dans le bief amont. De 1888 jusqu’en 1965
il y avait là un passage d’eau. Le droit de passage était de 2 centimes par
personne et à 5 centimes lorsque le niveau de la rivière atteint 80 cm
au-dessus du niveau normal. Sur
une photo, on voit Pierre Noirfalise, passeur depuis 1904, à la tâche en 1931, avec à la main la poignée coulissante
avec laquelle il tire sur le câble pour faire avancer sa « betchète ». Streupassignifie : Passage étroit (du wallon streût) L’Ourthe se divise en
deux bras d’une largeur d’environ 20 m formant ainsi l’île de Streupas, 3
hectares et une longueur de 325 m.
Depuis le quai Saint-Paul-de-Sinçay un pont
piétonnier donne accès à l’île entre l’Ourthe et le bief du canal.
Le « Panê-Cou-Plage » connaît un boom
avec la loi des congés payés du 27 juin 1936. En wallon, le « panê » est
un pan de chemise, « panê-cou » est « la chemise au
vent », mais aussi quelqu’un de
peureux ou couillon. En 2015, le Conseil communal de Liège a officialisé le nom
« Panê-Cou-Plage », donc « plage des couillons » ? Aujourd’hui,
il est interdit de s’y baigner.
Une lande calaminaire
Nous venons de laisser derrière nous le site
de Vieille Montagne. Cette usine a laissé partout des traces. Si vous remontez
la rue de Streupas, et puis revenez 400 m vers le centre d’Angleur, vous avez à
hauteur du N° 176 sur votre gauche, au lieu-dit la Minière, une petite plaine
de jeux, avec la discrète issue de la mine de la Diguette. Cette mine fut exploitée de 1836 jusqu’à
1882. Elle a atteint la profondeur de 105m. Il y avait aussi la mine de Kinkempois
dont l’entrée se trouve de l’autre côté de la colline. Entre 1853 et 1882, le
gisement de la Faille de Streupas a fourni 1.900 tonnes de minerai de zinc,
ainsi que 2.300 tonnes de minerai de
plomb et 17.500 tonnes de pyrite (FeS2) pour la production de l’acide
sulfurique. Les retombées ont à leur tour contaminé le sol. D’où les pelouses
calaminaires avec la «pensée calaminaire»,
du nom de ce minerai que l’on trouve aussi à La Calamine. Aujourd’hui la nature reprend ses droits : une couche
de sol non pollué recouvre petit à petit le sol pollué. On assiste alors à un
mouvement contraire : dans les années 80 l’université lance un plan de
sauvegarde de cette lande polluée…
L’île de Campana, ses kayaks, son fourneau, sa fenderie et
son laminoir à tôles.
 |
| Campana inondé juillet 2021 Rhansenne.photos |
La chambre de l’écluse N° 4 de Sauheid PK 4,59
existe toujours, mais les portes font défaut et le niveau d’eau est réglé au
moyen de madriers. Sur l’île de Campana le Mava club et l’ADEPS initient au
kayak. Il y avait là un complexe industriel, avec d’abord un simple fourneau en
1564, puis un laminoir à tôles et
fenderie. Au début du XVIIIe siècle, la vallée de l’Ourthe, de Chênée à Tilff,
était une des régions industrielles les plus actives du pays de Liège, avec les
usines de Sauheid en rive droite, les établissements de Colonster en rive
gauche et une fenderie au Saucy, à l’entrée de Tilff.
L’écluse N° 5 de Colonster PK 6,03 a été
remplacée par un barrage mobile avec pont. Là se trouvait en 1530 le Maka
PHILIPPE, un lourd marteau actionné grâce à un moulin à eau. Au cours des
années s’y ajoutent un fourneau, une forge, une fenderie, un laminoir.
https://www.researchgate.net/figure/Le-rocher-du-Bout-du-Monde-Colonster-Au-dessus-le-paysage-tel-quil-apparait-de-la_fig3_269697886
Le rocher du Bout du Monde est un empilement de grosses dalles, d’une épaisseur
totale de 63 mètres. C’est une structure géologique très spéciale: un synclinal
perché, où affleurent, de bas en haut les calcaires frasniens riches en
stromatopores et en coraux; des schistes friables, peu résistants et des grès
durs et résistants. Les grès restent dès lors en relief.
À Lhonneux, transbordement des chevaux de halage et l’abri du
passeur.
Par l’écluse 6 de Sainval PK 7,83 on
rejoignait le canal latéral jusqu’à écluse 7 de Tilff. Lors de la construction
du chemin de fer le bief amont a été remblayé et porte maintenant une route et
le RAVeL jusqu’à la piscine de Tilff (en friche depuis un bon moment).
 |
| pk 8,88 |
L’écluse N° 7 Tilff PK 8,88 a aussi été
remblayée mais le mur de soutènement du bief existe toujours, ainsi que la
maison de l’éclusier. La digue en biais à la tête de garde de même que la digue
dans le cours de la rivière quelque cent mètres en amont sont toujours là.
Le tronçon de canal de Méry à Hony aussi a fait place au le chemin de
fer. Les écluses N° 8 St.Anne et N° 9 Méry ont disparu. A Hony l’écluse n° 10 et
le bief amont ont été remblayés. La maison de l’éclusier existe toujours et
était un commerce jusqu’il y a peu.
À la sortie du bief de Hony les betchetes
naviguaient de nouveau sur l’Ourthe. À Lhonneux, le chemin de halage changeait
de rive en amont du barrage. Il fallait donc transborder les chevaux de halage
dans un ponton, une longue barque à fond plat.
La sécurité du ponton était assurée par un câble aérien de retenue et la
traction se faisait sur un câble immergé
que le passeur saisissait dans une manette de bois crantée. À cet endroit on
voit encore l’abri du passeur.
Dans la traversée de Tilff et Esneux, on naviguait
en rivière canalisée entre l’île du Moulin et le Monceau, entre Lhonneux et
Fêchereux et à Esneux, dans un court tronçon compris entre Lavaux et le milieu
de l’avenue de la Station. Les maisons de l’éclusiers du N°11 Fêchereux et N°12
devant Rosières existent toujours et sont toujours habitées. Les écluses ont
été remblayées mais on en voit encore les vestiges.
La Roche-aux-Faucons, précédée d’un
gigantesque éboulis, domine l’Ourthe d’environ 120 mètres. Sur ce site
mésolithique on a retrouvé des couteaux, des haches, des perçoirs ainsi que des
grattoirs en silex. Elle est classée au Patrimoine exceptionnel de Wallonie
depuis 1947 et porte le tout nouveau label « Grand Site Paysager ».
Mais on n’y voit plus de faucons pèlerins depuis 1958.
L’écluse N°14 d’Evieux est remblayée, la
maison de l’éclusier est toujours habitée. À la Gombe on voit encore des traces
de la tête de garde du bief.
Jusqu’à Poulseur les péniches naviguaient de
nouveau sur l’Ourthe. Le bief aval long de quelque 300
 |
| N°15 poulseur |
mètres existe toujours
de même que l’écluse N°15. La maison de l’éclusier est habitée. On rentre dans
le dernier tronçon du canal par l’écluse de Poulseur N°15 et Chanxhe N° 16
(Embierir), restaurée, mais sans portes. La maison de l’éclusier est toujours habitée.
Une curiosité géologique : les Tartines
L’écluse N°17, en aval du pont de Scay, est
atteinte en 1857. Ca s’avère le terminus: en 1862 la Compagnie était exonéré de
l’obligation de poursuivre la canalisation jusqu’à La Roche.
Près du pont la curiosité géologique des
Tartines est classé site de Grand Intérêt Biologique. Ces Tartines sont des
calcaires très redressés qui ont subi une érosion différentielle suite à
alternance de couches très résistantes et sensibles à l’érosion.
Nous sommes ici dans le pays des carrières qui
ont le canal pendant très longtemps. Un peu avant Poulseur la carrière
désaffectée de la Gombe abrite un centre de plongée. En face de Poulseur, les anciennes carrières
de Monfort étaient déjà citées en 1477. Leur exploitation a cessé
définitivement en 1962. Ces carrières bénéficient du statut de réserve
naturelle privée, propriété de la Société coopérative de Montfort. Lorsqu’on a voulu combler la carrière avec
des déchets d’exploitation industrielle une soixantaine de familles du coin ont
investi 4 millions de FB (des parts de
100.000 FB) pour racheter les 30 ha de carrières. Plus loin, il y a aussi la
carrière d’Evieux, autre réserve naturelle.
Le roi Pahaut, monté sur un grand cheval blanc
Vers la fin du 19e siècle, l’industrie de la
pierre occupait plusieurs milliers d’ouvriers avec ses ateliers de taille,
d’outillage, de sculpture et ses forges. Ces carrières profitaient du canal.
Le 18 mars 1886, du quinzième anniversaire de
la commune de Paris, un vent de révolte souffle sur le pays. Début avril 1886 le
carrier Jean-Hubert Pahaut rédige un cahier de revendications :
– Journée de 12 heures au lieu de 16 heures
– Suppression des boutiques patronales
– Paiement par quinzaine plutôt que mensuel
– Salaire à l’heure et non plus à la journée,
de manière à assurer le travail supplémentaire.
Suivi de 200 hommes, il pénétra dans les
différentes carrières de la région (Florzé, Chanxe, …). Le bourgmestre
d’Aywaille le fait arrêter mais lorsque la grève prend de l’extension, on le relâche
en espérant qu’il conseillera la reprise du travail. Mais les carriers de
Sprimont continuent. Pahaut accorde à « Messieurs les maîtres de carrière
jusqu’au 22 mai courant pour prendre une décision relative à l’amélioration du
sort des pauvres ouvriers ». Les patrons de carrières répondent par voie
d’affiches :
– Pas de suite aux revendications tant que la
grève perdure. Dès la reprise du travail, nouvelles assemblée pour examiner la
possibilité d’améliorer le sort des ouvriers
– Démarche auprès du gouvernement pour obtenir
des mesures favorables à l’industrie des carrières.
Le 20 avril 1886, les ouvriers des carrières
de l’Ourthe reprennent le travail. Monté sur un grand cheval blanc, Pahaut se
rend à Liège auprès du gouverneur de la province, le 24 mai 1886, suivi de quatre
cents hommes. Le 26 mai il est condamné à un mois de prison. Le 31 juin il est
acquitté en appel (source : le Roi Pahaut, G.Laport, la vie walonne N°303 et MP
Collin, Les Emeutes de 1886 en Belgique et à Sprimont, travail de fin d’année,
78-79, Sainte-Croix). Dans les années 70 Jean Lambert crée un grand
spectacle déambulatoire sur la vie du Roi Pahaut, avec le Théâtre de
la Communauté. Plus dans http://hachhachhh.blogspot.com/2014/02/les-heros-des-cent-mille-briques-la.html
Le Ravel de Comblain à Houffalize
Comblain, Hamoir, Barvaux, Durbuy… L’Ourthe est de moins en moins profonde,
son lit parsemé de gros blocs de rocher. Les rives, régulièrement inondées, se
prêtent mal à l’aménagement de chemins. C’était le cas aussi pour le canal.
Seuls des bateaux à fond très plat pouvaient encore remonter le cours de
l’Ourthe à la hauteur de Durbuy. Et
c’est le cas aussi pour le Ravel, même si les travaux avancent bien. Pour relier sans interruption Liège à Durbuy
par le Ravel un tronçon d’un 500 mètres posait problème : une zone Natura2000 borde le chemin entre Comblain-la-Tour et Fairon, à Hamoir. J’ai
l’impression que la solution est toute proche. Cela fera partie d’un autre blog
où j’essaye de voir les possibilités d’une piste vélo qui suivrait +- le trajet
prévu pour la liaison Meuse-Moselle de Guillaume I.
Ce n’est pas pour rien que la GCL a jeté l’éponge
ici. Après La Roche, l’Ourthe se transforme en torrent de fond de vallée,
rendant l’aménagement d’un chemin de halage et donc aussi un Ravel extrêmement
difficile. Mais je ne veux pas me
braquer sur un Ravel. Le réseau points-nœuds aussi est en plein développement
et permet plus de souplesse. J’ai suivi en vélo la Sûre d’Exhternach à Wasserbillig,
sur la Moselle. On y a même l’embarras du choix, entre une piste du côté
allemand et la côté Grand Duché. Le Sauerradweg va même jusque Ettelbrück. Mais entre Ettelbruck et Durbuy c’est un peu le
nomansland et il y a probablement des trajets autrement intéressants que de
suivre les chimères d’un roi qui voulait relier son Royaume à son Grand Duché.
Biblio
Sans
remonter mille ans en arrière, l’œuvre de référence pour l’Ourthe est R Dalem
et A Nelissen « Mille ans de navigation sur l’Ourthe », éd. Petitpas, 1973)
http://idefix.skynetblogs.be/archive/2014/09/24/canal-de-l-ourthe-8289695.html
Lucienne Viellevoye Balade le long du canal.
http://pierre-lemoine-parcourshydro.blogspot.be/2014/03/lourthe-liege.html
Mes parcours des voies d’eau par Pierre Lemoine
https://canalmeusemoselle.wordpress.com/
site du Cercle d’Etudes du Canal de Bernistap-Hoffelt –
sur l’Ile aux Corsaires http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/90354
et
http://www.natagora.org/files/author/rudi.vanherck/Article%20Ile%20Corsaires.pdf
http://users.belgacom.net/claude.warzee/fragnee/fragnee.htm
http://meuse-moselle1830.be/cmm5.html https://histoiresdeliege.wordpress.com/2016/02/23/la-rectification-de-lourthe-dans-le-quartier-vennes-fetinne/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/L%27Ourthe_au_fil_du_temps.pdf
https://www.binnenvaartinbeeld.com/nl/canal_de_ourthe/canal_de_l_ourthe
belles photos de Michel Hensens